www.initiative-communiste.fr site web du PRCF vous propose de lire l’entretien que notre camarade, l’historienne Annie Lacroix-Riz a accordé au journal bordelais Poils à Gratter (n°4)
Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris VII, s’est fait connaître des internautes au moyen de ses conférences (sur Youtube, les films de l’an 2, son site, etc.). Elle y détaille notamment comment les milieux d’affaires français ont choisi de collaborer avec l’impérialisme allemand sans considération de nos intérêts nationaux. Spécialiste de l’histoire du capitalisme, elle est aussi membre du Pôle de Renaissance Communiste en France. « Poil à Gratter ! » a souhaité lui donner la parole :
Bonjour Annie, vous avez la double casquette d’universitaire et de militante. Est-il aisé de pouvoir dissocier ses idéaux d’une lecture à froid de l’histoire de notre pays pour un(e) historien(e) ?
On ne précise pas la qualité politique et idéologique de mes collègues, dont les choix s’étendent de la gauche non communiste à l’extrême droite.
Ayant établi son hégémonie dans le cadre de la liquidation (momentanée) du marxisme, l’historiographie dominante, aidée des médias, qui lui accordent volontiers la parole ou exaltent ses travaux, peut sans risquer la contradiction ‑ vu le non-accès des accusés aux tribunes multiples dont elle dispose ‑pratiquer à l’encontre des historiens « critiques » diverses méthodes de réduction au silence ou de dépréciation. Enterrer leurs recherches, ce qui est depuis les années 2000 la tactique la plus utilisée, ou affirmer que le marxisme des intéressés les rend inaptes à l’« objectivité ». Sans souci des contradictions, puisque les mêmes, le plus souvent, ont cédé à la grande mode du relativisme, c’est à dire contestent le concept de « vérité historique » et brocardent « la religion des archives » au motif que celles-ci ne nous apprendraient rien ou pas grand-chose. J’ai dit à maintes reprises ce que je pensais de ces pratiques, et y ai même consacré un petit ouvrage, auquel je renvoie vos lecteurs, L’histoire contemporaine toujours sous influence, Paris, Delga-Le temps des cerises,2012.
Je fais de l’histoire, d’une part, avec des sources originales, toujours contrôlables vu la précision des notes infra-paginales jointes à tous mes textes et, d’autre part, en toute indépendance à l’égard des objets que j’étudie (même quand j’éprouve pour ces derniers une vive sympathie). Qu’on juge du bilan sur ces pièces, sans procès d’intention.
Je reproche pour ma part à l’historiographie dominante de dissimuler à son public sa dépendance, financière, médiatique et de carrière à l’égard des puissants, publics ou privés
Je reproche pour ma part à l’historiographie dominante de dissimuler à son public sa dépendance, financière, médiatique et de carrière à l’égard des puissants, publics ou privés. Bref, la formule de « double casquette » n’a pour moi aucun sens. J’ai d’ailleurs observé, à la lecture de tel débat en ligne me concernant, que les plus déchaînés de mes détracteurs, interrogés par des lecteurs-défenseurs qui leur demandent, tant les griefs invoqués sont éloignés du contenu de mes textes, s’ils m’ont vraiment lue, finissent par avouer qu’ils n’ont jamais jugé nécessaire de le faire. La rumeur de mes méfaits leur suffit.
Comment votre intérêt pour l’histoire vous est apparu, et vos connaissances accumulées en ce domaine, vous donnent-elles l’impression d’avoir un regard plus aigu sur notre présent ?
J’ai aimé l’histoire très jeune, parce que mon enfance a été imbibée du souvenir des événements de la Deuxième Guerre mondiale. J’ai eu au surplus la chance d’avoir, dans le secondaire, en 4e, puis en 1e et en Terminale, deux professeurs qui m’ont profondément impressionnée, et orientée vers l’histoire.
La connaissance historique a la vertu de rendre imperméable à la propagande mensongère parce qu’elle en démonte tous les mécanismes. Elle a résisté en France tant qu’ont tenu bon les organisations de défense, syndicales et politiques, des salariés, qui faisaient grand cas de la formation historique de leurs membres ou de leurs sympathisants. Leur effondrement a rendu particulièrement efficace, pendant ces dernières décennies,l’entreprise de démolition systématique dont l’histoire scientifique a toujours fait l’objet. Ce qui est nouveau, ce n’est pas que les élites, publiques et privées, transforment l’histoire en propagande mensongère, c’est qu’il n’y ait presque plus rien en face pour y faire barrage, et que l’historiographie dominante, qui a toujours activement participé à l’élaboration et à l’entretien de l’idéologie dominante mais en respectant certaines règles méthodologiques et déontologiques, rende désormais au grand patronat et à l’État les mêmes services directs que ces derniers ne pouvaient avant-guerre demander qu’aux facultés de Droit et de Sciences économiques.
Dans votre conférence « le choix de la défaite », vous évoquez régulièrement le mot « synarchie ». Pouvez-vous en expliquer la signification à nos lecteurs ?
Le « Mouvement synarchique d’empire » ou « synarchie »,issu d’une société secrète fondée dans les années 1880 par le polytechnicien Saint Yves d’Alveydre, fut (re)fondé en 1922 par une poignée de financiers français souvent issus des grands « corps » de la haute fonction publique (inspection des Finances,Conseil d’État, Polytechnique).
Ce regroupement secret avait pour but de se débarrasser de la république au profit d’une solution fasciste qui assurerait au Capital le plus concentré le contrôle exclusif de la politique intérieure et extérieure française. Les luttes ouvrières avaient donné à la population certains moyens de défense, parlement, jugé trop sensible aux « caprices » des électeurs, partis, syndicats ouvriers, etc. :c’était autant d’entraves à la prise de décisions immédiates sur toutes les questions, impératif aggravé en temps de crise, c’est-à-dire de (risque de) baisse des profits et de guerre redoublée contre le salaire.
 Les douze « fondateurs de la synarchie », cléricaux liés à l’Action française, noyau du fascisme français, détestaient donc la république « judéo-maçonnique », si serviable à leur égard, presque autant que la révolution bolchevique, leur hantise suprême (on impute volontiers à l’« idéologie » ce qui relevait d’intérêts matériels : l’impérialisme français, qui exerçait depuis les années 1890 la mainmise sur l’économie moderne de la Russie,avait en novembre 1917 perdu très gros). Ayant participé directement, par la voie financière et politique, au succès d’une solution fasciste en Italie (1922) et en Allemagne (1933), ils planifièrent la même issue pour la France.
Les douze « fondateurs de la synarchie », cléricaux liés à l’Action française, noyau du fascisme français, détestaient donc la république « judéo-maçonnique », si serviable à leur égard, presque autant que la révolution bolchevique, leur hantise suprême (on impute volontiers à l’« idéologie » ce qui relevait d’intérêts matériels : l’impérialisme français, qui exerçait depuis les années 1890 la mainmise sur l’économie moderne de la Russie,avait en novembre 1917 perdu très gros). Ayant participé directement, par la voie financière et politique, au succès d’une solution fasciste en Italie (1922) et en Allemagne (1933), ils planifièrent la même issue pour la France.
Une liste de 1945 des Renseignements généraux de la Sûreté nationale recense onze de ces douze « fondateurs », représentatifs du trio qui règne sur la France depuis les Premier et Second empires :la haute banque, regroupée au sein de la Banque de France (1802), et les Comités des houillères et des forges fondés sous Napoléon III. Ce noyau financier continua à diriger la synarchie, avec des effectifs un peu augmentés au fil de l’entre-deux-guerres. La liste des 46 « principaux affiliés » que le chef de la police française Henri Chavin, un des prédécesseurs de Bousquet, remit à Pétain en juin 1941 désignait les vrais dirigeants du pays ou leurs principaux lieutenants, désormais placés directement à la tête de l’État. Les décisionnaires du lot se bornaient aux possesseurs ou grands actionnaires des banques et grandes industries, quelle que fût l’importance des « idéologues » stipendiés pour tenir en laisse la population.
Mes collègues, Olivier Dard en tête, dont les éléments les plus célébrés de notre corporation ont fait le héraut de la destruction scientifique du « mythe de la synarchie », clament que Chavin est un fou et la synarchie une chimère. Sachez seulement qu’O. Dard, par ailleurs notoirement lié à l’Action française, ce que ce chœur académique omet de signaler, combat la présumée marotte de la « complotiste » Lacroix-Riz sans recourir à une source originale contemporaine des faits et événements décrits[1]; et que « le complot de la synarchie » contre la 3e République constitua le chef d’accusation majeur des ministres de Vichy quand furent mis au point, à Londres puis Alger, des projets gaullistes d’épuration. Les synarques, toujours en place, y compris dans l’entourage direct de de Gaulle, obtinrent cependant précocement la mise de l’enquête sous le boisseau et, dès le procès Pétain, l’abandon des poursuites pour ce crime d’« intelligence avec l’ennemi » puni de la peine de mort par les articles 75 et suivants du Code pénal[2].
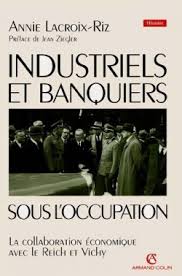 Ce dossier judiciaire prolongeait celui de la Cagoule, bras armé de la synarchie, que la police et la justice avaient rempli et saboté allègrement de 1936 à 1939-1940, tandis que les influents comploteurs,assurés de la complicité active ou passive de la gauche de gouvernement et de la droite dite « républicaine »,marchaient vers le pouvoir que leur garantirait une défaite militaire face au Reich. De 1941 (avec « le scandale de la synarchie » surgi entre mai et l’été) à 1948, l’enquête sur la synarchie généra des milliers de documents, français et (sous l’Occupation) allemands. Ceux qui ont lu Le choix de la défaite, De Munich à Vichy et Industriels et banquiers français sous l’Occupation peuvent juger de l’ampleur et du sérieux de la correspondance policière, judiciaire et administrative qui établit la réalité de la synarchie et de son pouvoir.
Ce dossier judiciaire prolongeait celui de la Cagoule, bras armé de la synarchie, que la police et la justice avaient rempli et saboté allègrement de 1936 à 1939-1940, tandis que les influents comploteurs,assurés de la complicité active ou passive de la gauche de gouvernement et de la droite dite « républicaine »,marchaient vers le pouvoir que leur garantirait une défaite militaire face au Reich. De 1941 (avec « le scandale de la synarchie » surgi entre mai et l’été) à 1948, l’enquête sur la synarchie généra des milliers de documents, français et (sous l’Occupation) allemands. Ceux qui ont lu Le choix de la défaite, De Munich à Vichy et Industriels et banquiers français sous l’Occupation peuvent juger de l’ampleur et du sérieux de la correspondance policière, judiciaire et administrative qui établit la réalité de la synarchie et de son pouvoir.
La « synarchie n’existe pas »? Si peu que les Renseignements généraux de la Préfecture de police ou de la Sûreté nationale continuaient dans les années 1960 (et vraisemblablement au-delà) à présenter telle personnalité comme« membre influent de la “synarchie”. »[3]
De nombreux historiens amateurs ou diplômés, de gauche comme de droite, sont accusés de révisionnisme lorsqu’ils s’attaquent à des sujets sensibles de la seconde guerre mondiale, ou encore à certaines vérités assénées concernant la Révolution Française. Ceux qui s’intéressent à leurs travaux considèrent à ce titre qu’au-delà de l’univers médiatique et de certaines considérations politiques sur l’histoire, le principal problème viendrait d’une sclérose dans les milieux universitaires empêchant d’ouvrir réellement ces débats dans un souci de vérité historique. Quel est votre point de vue tant d’historienne, que d’universitaire ou d’être politique sur la question ? L’histoire n’est-elle pas amenée à être constamment révisée en fonction du temps qui passe ? Enfin, que pensez-vous de la loi Gayssot ?
Je crois vous avoir répondu sur la « sclérose » et sur le veto organisé depuis une vingtaine d’années contre tout débat académique, notamment sur la Collaboration et sur l’existence de la synarchie.
Je me sens « révisionniste » au sens où toute histoire scientifique tend à réviser, compléter, confirmer ou infirmer les découvertes antérieures : je me révise d’ailleurs beaucoup, comme le montre la récente réécriture d’Industriels et banquiers français sous l’Occupation. Les bien-pensants font mine de confondre les « négationnistes » (qui nient l’existence des chambres à gaz) et les historiens « révisionnistes », école très à gauche née aux États-Unis au tournant des années 1950 pour démonter l’histoire antisoviétique de la Guerre froide au profit d’une analyse de la politique extérieure de l’impérialisme américain depuis sa naissance (les années 1890).
J’ai apprécié la loi Gayssot en son temps, parce que me suis réjouie de voir frapper le négationnisme à la caisse. La tentative, désormais avérée, d’en faire usage contre la liberté de la recherche historique stricto sensu est pour moi naturellement irrecevable.
Parlons un peu de votre engagement politique. Le parti communiste a été longtemps une formation politique très influente en France, très engagée aux côtés des Gaullistes historiques, à la défense des intérêts nationaux. Que s’est-il passé pour qu’en quelques années à peine, pour que le PCF se fasse complaisant voire véritablement activiste vis à vis de la « construction européenne » ?
Ce qui s’est passé dans la crise systémique qui a précédé la Première Guerre mondiale et qui a transformé le premier mouvement marxiste de France, le guesdisme, élément constitutif de la SFIO (née en 1905), en ectoplasme, et son chef Jules Guesde en détenteur d’un strapontin gouvernemental dans le gouvernement d’Union sacrée de l’été 1914. L’affaire s’est jouée dans les deux cas en bien plus de « quelques années ».
Vous êtes adhérente au Pôle de Renaissance Communiste en France, pouvez-vous nous parler de votre engagement dans cette formation politique ?
Je suis marxiste au sens où Marx l’entendait dans la 11e thèse sur Feuerbach : « Les philosophes » ou, précisera-t-on, les intellectuels critiques, « n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières; il s’agit désormais de de le transformer. »
Cette aspiration a longtemps été satisfaite par l’adhésion au PCF, puis, quand j’ai estimé que celui-ci avait suivi la voie guesdiste, par l’adhésion à une organisation (qui n’est pas un parti) soutenant une ligne susceptible de reconstituer cet indispensable outil.
Le PRCF milite notamment pour la sortie de l’Union Européenne, l’euro et l’OTAN. Est-ce contradictoire avec la pensée internationaliste véhiculée par les communistes ?
L’histoire de l’intégration européenne et de la colonisation de l’Europe par les États-Unis, première puissance impérialiste depuis la naissance de cette phase du capitalisme (1880-1913), est celle du pillage des ressources matérielles et humaines des pays concernés et des guerres consécutives. L’internationalisme naguère qualifié de « prolétarien » n’a rien à voir avec une telle entreprise. La réalité des faits, commeil ressort de mon récent ouvrage sur l’intégration française des capitaux (Aux origines du carcan européen, 1900-1960), inflige un démenti sévère à l’argument, seriné sans répit, que « l’Europe » serait un facteur de paix, et la tutelle américaine une garantie de « liberté » des peuples. [NDLR voir la conférence d’Annie Lacroix Riz Aux origines du carcan européen en vidéo]
 C’était déjà vrai quand les rivalités inter-impérialistes qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale n’avaient pas encore porté la guerre sur le continent européen et se bornaient à ravager la « périphérie », c’est-à-dire les vastes et riches régions pour la maîtrise desquelles se concurrencent, depuis la fin du 19e siècle, tous les grands impérialismes, anglais, américain, allemand et français (sans parler des impérialismes secondaires depuis les origines, tel le belge ou le néerlandais, ou devenus secondaires, tel l’anglais et le français).
C’était déjà vrai quand les rivalités inter-impérialistes qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale n’avaient pas encore porté la guerre sur le continent européen et se bornaient à ravager la « périphérie », c’est-à-dire les vastes et riches régions pour la maîtrise desquelles se concurrencent, depuis la fin du 19e siècle, tous les grands impérialismes, anglais, américain, allemand et français (sans parler des impérialismes secondaires depuis les origines, tel le belge ou le néerlandais, ou devenus secondaires, tel l’anglais et le français).
Depuis la chute de l’URSS, les guerres de conquête de l’impérialisme américain et de ses auxiliaires et rivaux ont connu un rythme plus soutenu encore que dans les phases de crise systémique qui ont précédé les deux guerres mondiales. Elles ont, depuis les années 1990, frappé directement le continent européen
Depuis la chute de l’URSS, les guerres de conquête de l’impérialisme américain et de ses auxiliaires et rivaux ont connu un rythme plus soutenu encore que dans les phases de crise systémique qui ont précédé les deux guerres mondiales. Elles ont, depuis les années 1990, frappé directement le continent européen : la Yougoslavie d’abord, sachant que les conflits dans les Balkans, zone stratégique disputée entre impérialismes rivaux, ont, tant avant 1914 qu’avant 1939, annoncé l’embrasement générale. Elles arrivent désormais aux portes mêmes de la Russie, dont l’Ukraine fait partie depuis les prémices médiévales de l’empire. Je cite dans Aux origines du carcan un texte polonais de 1930 sur cette caverne d’AliBaba que convoitaient, au premier chef, les impérialistes allemands et américains (et tous les autres). En 2014, il n’est pas un mot à retrancher à ce jugement de Roman Dmowski : « L’Ukraine indépendante serait un État où domineraient les influences allemandes »; « Arracher cette Ukraine de la Russie serait lui arracher les dents; on se protégerait ainsi de sa concurrence et on la condamnerait au rôle de consommateur éternel des produits d’une industrie étrangère »[4]. L’Ukraine fut un des buts de guerre essentiels des deux guerres précédentes, et tout confirme, dans cette phase aiguë de la crise, qu’elle le demeure.
La méfaits de la tutelle qu’exerce sur les Français leur grand capital national‑ notamment en terme de baisse drastique des salaires –, dans le cadre d’une crise systémique plus longue et plus profonde que les deux précédentes (1873-1914; 1929-1939),sont considérablement aggravés par l’influence dont disposent simultanément les grands partenaires, américains et allemands, de ce cercle de privilégiés. Et ce qui vaut pour la France vaut pour tous les pays appartenant à « l’Union européenne ». Faut-il faire une démonstration concernant l’évolution respective du salaire réel et du profit monopoliste depuis une vingtaine d’années?
 Vous me demandez donc si le soutien apporté un tel système, dirigé par les impérialismes américain et allemand auxquels l’impérialisme français, féroce envers son propre peuple,se soumet perindeaccadaver depuis les années 1920, relèverait de « l’internationalisme prolétarien »? C’est un carcan, et toute libération du carcan, en l’occurrence tout progrès vers le rétablissement d’un cadre national des luttes populaires, crée de meilleures conditions pour leur succès. La frénésie du grand patronat pour « l’Europe » et pour les États-Unis (y compris la langue de ces maîtres), c’est-à-dire sa tendance à l’abdication nationale, comme naguère au profit du modèle hitlérien,fournit une preuve supplémentaire que cette voie a placé les peuples dans une impasse : les hauts fonctionnaires français ont d’ailleurs dès la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l’acier qualifié l’intégration européenne de pur « alibi », indispensable à la mise en place d’un carcan des salaires.
Vous me demandez donc si le soutien apporté un tel système, dirigé par les impérialismes américain et allemand auxquels l’impérialisme français, féroce envers son propre peuple,se soumet perindeaccadaver depuis les années 1920, relèverait de « l’internationalisme prolétarien »? C’est un carcan, et toute libération du carcan, en l’occurrence tout progrès vers le rétablissement d’un cadre national des luttes populaires, crée de meilleures conditions pour leur succès. La frénésie du grand patronat pour « l’Europe » et pour les États-Unis (y compris la langue de ces maîtres), c’est-à-dire sa tendance à l’abdication nationale, comme naguère au profit du modèle hitlérien,fournit une preuve supplémentaire que cette voie a placé les peuples dans une impasse : les hauts fonctionnaires français ont d’ailleurs dès la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l’acier qualifié l’intégration européenne de pur « alibi », indispensable à la mise en place d’un carcan des salaires.
On lutte en effet plus aisément contre une dictature nationale que contre une dictature à plusieurs. Le sort pitoyable, depuis les années 1990 des pays pétroliers et gaziers du Moyen-Orient, soumis au bon vouloir américain avec l’aval de « l’Europe » (y compris dans l’organisation secrète des tortures de « suspects »), le démontre formellement. Les policiers de Vichy déclaraient froidement début 1943, après la victoire soviétique de Stalingrad, que la bourgeoisie française comptait désormais sur les États-Unis pour sauver son coffre-fort,après avoir misé sur l’Allemagne, par malheur vouée à la défaite. Elle est en effet parvenue à ses fins, et elle compte toujours sur les mêmes soutiens pour se battre au mieux.
Cette ligne fixe la ligne du camp adverse, auquel j’appartiens : l’Internationale du Travail n’a pas à s’aligner sur l’Internationale du Capital mais à la combattre.« L’internationalisme » vise le soutien aux peuples, pas à ceux qui, comme le clamaient les chefs militaires américains dès 1942, ne peuvent « tolérer des restrictions à notre capacité à faire stationner et opérer l’aviation militaire dans et au-dessus de certains territoires sous souveraineté étrangère »[5]; et qui estiment que, pour « le commun », le bol de riz, c’est encore beaucoup trop. Cette analyse de la guerre aux revenus non monopolistes semblait encore excessive il y a quelques années. Qui peut encore le penser?
En 2014, être communiste en France, c’est défendre strictement la même vision du communisme que dans les années 30, ou y a-t-il désormais des évolutions dans les idées qui sont intervenues ?
Me poseriez-vous cette question à propos du capitalisme? Le communisme me paraît aussi indispensable que Lénine en jugeait dans son texte de 1916 si utile à lire aujourd’hui, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme. On en est resté au même stade historique de la « crise générale de l’impérialisme », très aggravé, puisqu’on atteint le stade du verrouillage du développement des forces productives, ce qui rend plus aigu qu’il y a un siècle l’impératif de propriété collective des grands moyens de production et d’échange.
La crise du mode de production féodal a duré 300 ans avant que la Révolution française ne mît à bas ce système.La chute a été possible non pas en vertu d’une miraculeuse implosion du système, mais parce que la bourgeoisie s’était sérieusement organisée en vue de prendre le pouvoir pour transformer profondément l’économie et la société. Le communisme s’est depuis le 19e siècle assigné la même mission pour passer d’une société verrouillée au bénéfice d’une minorité de plus en plus étroite à une société libérant à la fois les forces productives et les peuples. Il demeure confronté à cette obligation. D’ailleurs, à écouter quotidiennement la télévision, alors même que l’URSS est présumée morte et enterrée, doutez-vous que « le spectre du communisme hante l’Europe », comme l’écrivait Marx dans Le Manifeste du parti communiste en 1848?
Certains communistes pensent que l’histoire de l’URSS a été diabolisée à outrance. En tant qu’historienne, quelles contre-vérités mériteraient d’être dénoncées, et quelles réalités méritent effectivement de faire consensus sur cette période de l’histoire de la Russie ?
J’ai passé et passe une partie de mes recherches à constater et à montrer, comme l’a fait Arno Mayer dans Les Furies, 1789, 1917, Violence, vengeance, terreur aux temps de la révolution française et de la révolution russe (Paris, Fayard, 2002), que l’URSS a été une « forteresse assiégée »par l’impérialisme de sa naissance à sa mort. Vos lecteurs pourront en juger en lisant ma préface à l’important livre de Geoffrey Roberts, enfin traduit, Les guerres de Staline, qui paraîtra en septembre 2014 (Paris, Delga), et en se reportant aux références fournies.
La chape de plomb qui pèse sur la recherche relative à l’URSS depuis quarante ans au moins a réduit l’histoire française de celle-ci aux fulminations de Nicolas Werth, qui croissent au fil de ses livres successifs – et contrastent avec le regard empathique qu’a posé son père Alexander sur La Russie en guerre. L’ouvrage de Michael Sayers et Albert Kahn, The Great Conspiracy: The Secret War Against Soviet Russia publié en 1946 (Little, Boni &Gaer, New York) a généré une foule de commentaires élogieux d’Américains prestigieux. Traduit l’année suivante en français sous le titre La grande conspiration contre la Russie, actuellement disponible en ligne[6], il fournit, pièces à l’appui, des détails proprement incroyables sur trente ans de complots impérialistes contre ce pays.En 1995, Pierre Vidal-Naquet, cédant à la mode antisoviétique du temps, l’a assailli comme « un modèle du genre […] des versions libérales et érudites […] de l’histoire stalinienne » comparable à « L’histoire du parti communiste (bolchevique) du temps de Staline », posée en « monument durable du mensonge historique le plus meurtrier »[7]. L’antisoviétisme aigu n’a même pas épargné les esprits considérés comme les plus indépendants.
Ma longue expérience des archives occidentales s’inscrit en faux contre pareille charge. On ne peut imaginer ce que les impérialismes divers ont inventé pour se débarrasser de la première expérience de propriété collective des grands moyens de production et d’échange.Nombre d’historiens honnêtes, en particulier les « révisionnistes » américains, jamais traduits en français, l’ont montré depuis plus de cinquante ans, non seulement à propos de l’URSS, mais aussi de toutes les expériences socialistes, Cuba, le Vietnam, etc.Quand la chape de plomb sera enfin levée, les « versions libérales [au sens américain du terme, plutôt progressistes] et érudites » retrouveront droit de cité. Pour parler clair, on pourra enfin refaire de l’histoire sérieuse de l’URSS sans risquer sa carrière universitaire. Il faudra à l’évidence pour y parvenir que beaucoup de choses changent…
Quel message aimeriez-vous adresser à l’attention de nos lecteurs pour conclure cet interview ?
L’histoire est « l’histoire de la lutte des classes », Marx ne l’a pas inventé mais constaté, et la consultation des archives originales démontre cette réalité implacable. C’est pourquoi l’histoire bien-pensante et dépendante de ceux qui conduisent cette lutte et en bénéficient ne veut pas en entendre parler.
[1]Olivier Dard, La synarchie ou le mythe du complot permanent, Paris, Perrin, 1998, nouvelle édition, 2012; « Mythologies conspirationnistes et figures du discours antipatronal », Vingtième Siècle, n° 114, avril-juin 2012, p. 137-151.
[2]Annie Lacroix-Riz, « Le procès Pétain, modèle de la “farce” de l’épuration », Faites entrer l’Infini, n° 51, 2011, p. 12-21, www.historiographie.info.
[3] Henry Dhavernas, inspecteur des Finances, intime de Jean Jardin, Renseignements généraux de la Préfecture de police (PP), 24 janvier 1967, GA, I 3, Banque de l’Indochine,archives de la PP.
[4]Chap. « La question ukrainienne » de,L’avenir de la Pologne,traduction annexée à lettre 396 de Jules Laroche, Varsovie, 24 août 1930, URSS 1918-40, 678, archives du ministère des Affaires étrangères.
[5]Général Henry Arnold, chef d’état-major de l’Air, en novembre 1943, cité par Michael Sherry, Preparation for the nextwar, American Plans for postwardefense, 1941-1945, New Haven, Yale UniversityPress, 1977, p. 47.Voir« Le débarquement du 6 juin 1944 du mythe d’aujourd’hui à la réalité historique », juin2014,
[6] http://www.communisme-bolchevisme.net/download/autres/La_grande_conspiration_contre_la_Russie.pdf
[7] Les Assassins de la mémoire, Paris, Seuil, 1995, p. 34.







