Le 8 avril dernier, Bernard Friot accordait un entretien à propos de son ouvrage Emanciper le travail au journal Etincelles du PRCF. Abonnez vous à Etincelles ! www.initiative-communiste.fr vous propose en avant première cet entretien à retrouver en intégralité en achetant (et en vous abonnant) à la presse du PRCF ! Achetez, soutenir les médias du PRCF c’est indispensable !
Initiative Communiste : tu insistes à juste titre sur l’importance de la lutte pour le salaire dans la construction des rapports de forces entre classes sociales. Peux-tu en dire plus à nos lecteurs ?
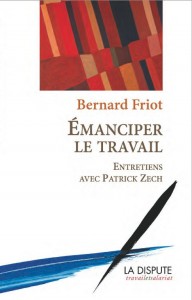 De 1920 à 1980, période que j’ai étudiée dans Puissances du salariat[1], la lutte de classes en France a été victorieuse pour les travailleurs parce qu’elle a porté en priorité sur le salaire, auquel elle a commencé à donner une signification anticapitaliste sous trois angles principaux.
De 1920 à 1980, période que j’ai étudiée dans Puissances du salariat[1], la lutte de classes en France a été victorieuse pour les travailleurs parce qu’elle a porté en priorité sur le salaire, auquel elle a commencé à donner une signification anticapitaliste sous trois angles principaux.
Premièrement, avec le statut de la fonction publique conquis en 1946 après 40 ans de lutte et mis en place par Maurice Thorez, ou dans un moindre mesure avec celui des électriciens-gaziers mis en place par Marcel Paul, le salaire à vie commence à s’instituer contre le salaire du marché du travail : s’il n’y a pas de chômage chez les fonctionnaires, c’est parce que leur salaire est un attribut de leur personne à travers leur grade. Même sans poste, même à la fin de leur service quand ils sont en retraite, ils sont payés pour leur grade. La pension est la « poursuite du traitement » chez les fonctionnaires (poursuite donc du meilleur salaire, celui de fin de carrière), c’est le « salaire d’inactivité » à l’EDF. Du coup, les fonctionnaires d’Etat n’ont pas d’employeur, au sens où un propriétaire peut dire à un travailleur nu, sans salaire parce que sans poste de travail, « aujourd’hui je t’embauche sur un poste dont je suis le propriétaire, avec le droit donc d’embaucher qui je veux quand je veux, je paie ton poste (je ne te pais pas toi, évidemment) et demain je te licencie de ce poste et tu te retrouves nu ». Quand on sait combien le fait d’attacher le salaire au poste de travail et non à la personne est au cœur de l’exploitation capitaliste, combien la peur de perdre son poste ou d’être changé autoritairement de poste est décisive dans la domination des propriétaires, une telle bataille, gagnée, pour le salaire à vie des fonctionnaires et des salariés à statut est le tremplin de conquêtes ultérieures que la bourgeoisie combat sans cesse et qui ne pourra être préservé que si une bataille est engagée pour que le salaire à vie soit généralisé à tous : il faut supprimer le marché du travail et la fonction d’employeur en faisant du salaire un droit politique attribué automatiquement et de façon irrévocable à 18 ans à tout le monde au premier niveau de qualification (par exemple à 1500 euros nets mensuels), avec ouverture d’une carrière salariale permettant de monter en qualification par exemple jusqu’à un maximum de 6000 euros, si, comme le préconise la CGT, il y a quatre niveaux de qualification.
Deuxièmement, les conventions collectives ont été au centre de la mobilisation syndicale dans le privé à partir de 1950. Outre des éléments portant sur les conditions de travail ou les droits des représentants des travailleurs, les conventions collectives sont d’abord des grilles de salaire qui font correspondre à chaque poste de travail un niveau de qualification (OP2, etc…) et un niveau de salaire. Ce fondement du salaire sur la qualification est aussi une importante victoire sur la logique du capital, même si elle est moins décisive que celle du salaire à vie parce qu’elle continue à lier le salaire au poste de travail et non pas à la personne. Fonder le salaire sur la qualification, c’est commencer à sortir du déni de qualification dont sont victimes les travailleurs réduits à des forces de travail dans le capitalisme. Le capitalisme réserve la définition de la valeur économique et la maîtrise de sa production aux propriétaires (et aux prêteurs qui se partagent avec eux, de plus en plus d’ailleurs avec la globalisation financière du capital, le profit). L’exploitation du travail des non propriétaires passe par leur réduction à des forces de travail demandeuses d’un poste de travail sur un marché où les propriétaires les achètent pour leur prix, c’est-à-dire pour la satisfaction des besoins nécessaires à leur reproduction. La violence capitaliste réduit les travailleurs à des êtres de besoin à qui il suffit de concéder du pouvoir d’achat, elle s’exprime dans le déni que ces travailleurs produisent la valeur et doivent être reconnus en tant que producteurs et non pas en tant que consommateurs. Récuser que le salaire soit du pouvoir d’achat et imposer la qualification (et donc la contribution à la production de valeur) comme fondement du salaire en qualifiant les postes, c’est sortir de ce déni. C’est faire du salaire non plus cette institution centrale du capitalisme qu’est le prix de la force de travail, c’est-à-dire le revenu d’un être de besoin, mais la reconnaissance d’une production (on voit, par parenthèse, que la revendication de « hausse du pouvoir d’achat » est totalement aliénée et tourne le dos à la bataille pour la qualification). Certes cette subversion du salaire capitaliste n’est pas aussi accomplie que dans le salaire à vie puisque c’est le poste qui est qualifié par la convention collective, mais cette qualification, bien qu’elle maintienne le marché du travail, a rencontré une hostilité constante du patronat. Pour la contrer, le patronat déploie aujourd’hui deux stratégies que j’ai décrites dans L’enjeu du salaire[2].
D’une part, il fait du SMIC – un salaire spécifiquement capitaliste puisqu’il nie la qualification et est construit à partir d’un « panier de consommation » – le salaire de référence d’une part de plus en plus grande des salariés (et là encore, la revendication isolée de « hausse du SMIC » manifeste l’abandon de la bataille pour la qualification). D’autre part, le Medef et ses partenaires emmenés par la CFDT (CFTC, CGC, UNSA et sauf exception FO) négocient depuis une vingtaine d’années le remplacement de la qualification du poste par la sécurisation des parcours professionnels : le salaire ne serait plus lié à la qualification, et en contrepartie les salariés seraient dotés d’une série de comptes liés à leur personne au prorata de leur temps d’emploi (compte temps, compte formation, compte pénibilité, compte retraite complémentaire, compte maladie complémentaire), des comptes portables, c’est-à-dire que les employeurs successifs doivent alimenter (et honorer s’il s’agit par exemple d’utiliser un compte de formation). Cette entreprise extrêmement nocive de changement capitaliste du salaire, par suppression de la qualification du poste et attachement à la personne de comptes qui se substituent au salaire socialisé des cotisations de sécurité sociale, ne peut pas être contrée par le retour à la qualification du poste, pour la raison sur laquelle j’ai insisté qu’elle maintient le marché du travail. Il s’agit de mener campagne pour l’on passe bien d’un salaire lié au poste à un salaire lié à la personne, mais pas par les dangereux comptes qui portent sur tout sauf sur la qualification et qui enchaînent encore davantage des salariés au marché du travail : encore une fois, il s’agit de sortir de la logique d’emploi par l’attribution de la qualification elle-même à la personne du salarié. La qualification doit devenir personnelle, et donc le salaire doit être attaché au salarié. On retrouve la revendication centrale de la généralisation du salaire à vie.
Initiative Communiste : statut de la fonction publique, qualification dans les conventions collectives, nous supposons que la troisième dimension de la bataille pour le salaire a été la cotisation sociale ?
Effectivement, la période que j’ai étudiée est celle de l’invention et de la montée en puissance spectaculaire de la partie socialisée du salaire dans la cotisation sociale. La cotisation interprofessionnelle s’impose, après l’échec de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910, avec les assurances sociales de 1930 et les allocations familiales qui les suivent de peu. Les cartes sont rebattues en 1945 dans la sécurité sociale que met en place Ambroise Croizat. A la fin des années soixante-dix, la cotisation sociale, partie de zéro cinquante ans plus tôt, représente plus de 60% du salaire brut, un taux qui n’a hélas pratiquement pas augmenté depuis 35 ans, et qui n’est conservé que pour les salaires les plus élevés. Car d’une part le taux de cotisation est gelé depuis le début des années 1980 alors qu’il avait doublé entre 1945 et la fin des années 1970. D’autre part, aux exonérations Aubry-Fillon sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic se sont ajoutés depuis Ayraud des remboursements de cotisation (à hauteur de 6% de la masse salariale) sous forme de crédit d’impôt jusqu’à 2,5 Smic. Et le pacte de responsabilité ajoute encore une couche : lorsqu’il sera arrivé à maturité, les employeurs ne paieront plus de cotisations sociales sur le Smic et des exonération/remboursements supplémentaires concerneront les salaires jusqu’à 3,5 Smic. Quand on sait que le salaire moyen est d’à peine 2 Smic, on voit que l’attaque contre la cotisation est généralisée. L’incapacité à s’y opposer n’est pas due seulement à la force de nos adversaires, elle est aussi un témoignage supplémentaire, avec les reculs du salaire à vie de la fonction publique et de la qualification comme fondement du salaire, des échecs auxquels a conduit l’abandon du centrage de l’action syndicale et politique sur le salaire.
Qu’est-ce qu’ont de révolutionnaire les cotisations sociales ? Attention, toutes les cotisations ne sont pas révolutionnaires, et il faut ici bien prendre garde à opposer cotisations capitalistes et cotisations anticapitalistes, comme je le fais dans Emanciper le travail[3]. La cotisation-prévoyance du salaire différé, ou l’impôt-solidarité de l’assistance, sont des institutions capitalistes combattues par le mouvement ouvrier révolutionnaire qui a, contre elles, promu la cotisation-salaire dans une lutte acharnée contre le pouvoir, le patronat et ses partenaires.
La cotisation-prévoyance, c’est l’AGIRC-ARRCO : mes cotisations sont consignées dans un compte qui sera la mesure de ma pension viagère quand je le liquiderai. Le patronat et ses partenaires tentent en permanence d’étendre cette logique du salaire différé à toute les prestations dites contributives, comme en témoignent les récentes conventions UNEDIC édictant qu’un jour cotisé = un jour presté, ou le projet d’alignement du régime général des retraites sur l’Arrco, ou l’obligation de complémentaires-santé dont les prestations sont fonction des cotisations choisies dans un menu. Le salaire différé correspond ainsi à la définition capitaliste de la valeur : je ne produits que lorsque je suis soumis à un employeur pour mettre en valeur du capital, et pour assurer mes besoins (encore eux) lorsque je suis chômeur, malade ou retraité, je diffère la partie de mon salaire que je n’ai pas consommée quand j’étais occupé.
Quant à l’impôt-solidarité, c’est la CSG et ses avatars : les besoins (toujours eux !) des personnes dont le temps d’emploi ou le niveau de salaire ne permettent pas qu’elles aient des droits contributifs suffisants sont couverts par une solidarité fiscale qui assure un « panier de soins »[4] ou un « minimum vieillesse », qui « lutte contre la pauvreté » des familles, qui favorise « l’insertion dans l’emploi » des chômeurs.
Contre cette rhétorique et ces institutions du capital que sont la cotisation-prévoyance et l’impôt-solidarité, le mouvement ouvrier révolutionnaire a combattu pour une cotisation-salaire, c’est-à-dire une cotisation qui finance un salaire à la qualification pour les travailleurs sans marché du travail et sans actionnaires que sont les retraités, les soignants (de la fonction publique hospitalière ou libéraux conventionnés), les parents et les chômeurs. Il est essentiel de bien voir que, comme les combats menés sur les deux autres terrains déjà analysés du salaire à vie et de la qualification, la cotisation-salaire, loin d’être du pouvoir d’achat couvrant des besoins des retraités, des malades, des parents et des chômeurs, subvertit le salaire capitaliste en payant des travailleurs qui produisent une autre valeur économique que la valeur d’échange capitaliste : retraités, parents, chômeurs et soignants produisent de la valeur sans emploi, sans employeur, sans actionnaires. Ce salaire attaché à la personne institue, comme dans la fonction publique, la qualification personnelle comme matrice du travail productif, contre l’emploi qui remplit cette fonction dans la pratique capitaliste de la valeur.
Poursuivre l’œuvre victorieuse de nos anciens, poursuivre cette mutation du salaire par sa socialisation, c’est mener un combat immédiat et un combat de moyen terme. Dans l’immédiat, revendiquer qu’à 55 ans[5] tous les salariés aient une pension de 100% de leur meilleur salaire brut quelle que soit la durée de leur carrière, que le chômage soit indemnisé sans limite de temps à 100% du salaire net de l’emploi perdu, que les parents puissent prendre du temps pour éduquer leurs enfants en conservant leur salaire à temps plein. A moyen terme, que la cotisation-salaire concerne aussi les salaires directs : le salaire à vie suppose que les entreprises ne paient plus leurs salariés mais cotisent à une caisse qui assurera non seulement la part des salaires qu’assure aujourd’hui la sécurité sociale, mais aussi les actuels salaires nets. La suppression des employeurs suppose que plus personne ne paie « ses » salariés. Aujourd’hui, sur 100 de valeur ajoutée par ses salariés, le propriétaire de l’entreprise en affecte 40 au profit (y compris le remboursement des prêteurs), 35 aux salaires directs et 25 aux cotisations : poursuivons en revendiquant qu’il en affecte 60 à une cotisation salaire qui ira à des caisses qui paieront les salaires à vie[6]. Les 40% restants iront pour partie à l’autofinancement décidé par les salariés copropriétaires, et le reste à une cotisation économique versée à des caisses qui subventionneront le reste de l’investissement (y compris par création monétaire, s’agissant de l’investissement net) et les dépenses courantes des services publics.
Initiative Communiste : ainsi, selon toi, il faut non seulement remplacer les salaires directs par la cotisation, mais aussi créer une cotisation pour financer l’investissement ?
Oui, car la cotisation a une autre vertu révolutionnaire que la possibilité de supprimer les employeurs : elle rend possible la suppression de la propriété lucrative de l’outil de travail et instaure un financement non capitaliste de l’investissement. Les centaines de milliards d’euros mobilisés dans les caisses ont permis de financer la production de santé sans appel au marché des capitaux, y compris l’investissement hospitalier, avant que le gel du taux de cotisation-maladie ne conduise à la désastreuse création par Juppé de la CADES en 1997, qui emprunte des capitaux et a fait des hôpitaux des débiteurs insolvables. Avant ce désastre, le subventionnement de l’investissement hospitalier par des caisses de maladie alimentées par une cotisation dont le taux augmentait régulièrement pour assumer la production croissante de santé a fait la preuve que c’est en mutualisant une partie du PIB dans des caisses d’investissement que nous allons pouvoir subventionner l’investissement en supprimant les prêteurs. Le constat est le même pour le financement par subvention des équipements collectifs grâce à la croissance de l’impôt. Les malheureux 400 milliards investis chaque année ne sont prêtés que parce qu’ils ont été au préalables ponctionnés : notre travail produit 2000 milliards, les propriétaires lucratifs en ponctionnent 700, dont ils affectent 300 à la spéculation et aux dépenses somptuaires et 400 seulement à l’investissement… que nous devons leur rembourser avec en plus un retour sur investissement de 15% alors que la production n’augmente que d’un ou deux pour cent. Or on peut en finir avec cette rapine et financer l’investissement sans crédit, comme je viens de le montrer avec la subvention des équipements publics par l’impôt ou la cotisation.
Au lieu de nous laisser dépouiller de 700 milliards par des propriétaires lucratifs qui ensuite nous imposent de leur rembourser la part de leur ponction sur notre travail qu’ils décident d’investir à notre place, affectons 600 milliards de ce que nous produisons à l’investissement : par exemple la moitié par l’affectation de 15% de la valeur ajoutée à un autofinancement décidé par les salariés copropriétaires de l’entreprise, et les 300 autres milliards par une cotisation investissement de 15% : les caisses d’investissement, gérées par les travailleurs, subventionneront les projets présentés par les entreprises, y compris par création monétaire pour les projets intéressants excédant leur encaisse. L’investissement doit devenir le fait du salaire socialisé.
Il en est de même pour les dépenses courantes des services publics. Actuellement déjà, la cotisation-maladie finance les dépenses courantes des producteurs de santé comme l’hôpital. Nous pouvons généraliser cette modalité de financement à toutes les dépenses courantes des services gratuits, qui doivent être étendus au logement, aux transports de proximité et aux premières consommations d’eau et d’électricité. Ainsi, les salaires des services publics seraient assurés, comme tous les salaires, par les caisses de salaires ; leur investissements par les caisses d’investissement ; et leur dépenses courantes par des caisses de fonctionnement percevant les 10% restant de la valeur ajoutée.
Tout le PIB irait ainsi à la socialisation salariale de la valeur pour financer, par des caisses gérées par les salariés, les salaires (60%), l’investissement (30%) et la gratuité (10%). On le voit, en finir avec la propriété lucrative, le marché du travail et le crédit, bref avec la production capitaliste, devient possible si on assume toute la portée révolutionnaire du changement du salaire qu’institue 1945 et si on le poursuit résolument.
Initiative Communiste : pourquoi selon toi la taxation des revenus financiers, type Tobin/Attac, est-elle une fausse piste dangereuse ?
La taxe Tobin est une plaisanterie et n’est pas, fort heureusement, le cœur de la mobilisation des groupes Attac même si elle a été l’occasion de leur constitution (mais pas la raison de leur impact) il y a près de vingt ans.
Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c’est l’audience de propositions de taxation du capital, dont témoigne le consensus autour d’un auteur comme Piketty ou le succès à gauche des mots d’ordre de « révolution fiscale ». Je viens de montrer que la cotisation-salaire, cette invention prodigieuse du mouvement ouvrier révolutionnaire, ne taxe pas le capital, elle le remplace dans le financement de la production d’une part aujourd’hui considérable du PIB. Contre cette dynamique, taxer le capital, c’est renoncer à le supprimer. C’est même le légitimer : si le mal du profit finance le bien de la sécu, il n’est plus tout à fait un mal, en tout cas il devient un mal nécessaire. Il ne s’agit plus de remplacer la classe capitaliste dans la production de la valeur, mais de changer le partage d’une valeur dont les capitalistes restent les maîtres, certes dénoncés pour leur excessive rémunération à combattre par une fiscalité davantage redistributive, mais non contestés comme dirigeants de la production.
Or les attaques contre la sécurité sociale n’ont ni comme but ni comme résultat premiers d’augmenter la prédation des capitalistes et de baisser le pouvoir d’achat de ceux qu’ils exploitent. La lutte de classes n’est pas d’abord une lutte pour le partage de la valeur, mais une lutte pour la maîtrise de sa définition et de sa production. Si les attaques contre la fonction publique et la cotisation-salaire sont si déterminées depuis 30 ans, ce n’est pas d’abord à cause de la baisse du taux de profit, ni parce qu’un prétendu « néolibéralisme » assoiffé d’or et de finance aurait remplacé un capitalisme plus raisonnable et industriel, c’est parce que la classe capitaliste entend réoccuper le terrain conquis par la pratique salariale de la valeur, réaffirmer que seules produisent des forces de travail mettant en valeur du capital, et qu’il importe pour ce faire d’intensifier la soumission des populations au chantage de l’emploi et de la dette. La lecture de la réforme dans les termes fumeux du « tournant néolibéral » Reagan-Thatcher ou dans les termes économicistes d’une crise du capital confronté à la baisse du taux de profit (crise au demeurant incontestable) fait l’impasse sur la lutte de classes et sur la dimension d’abord politique de l’économie : l’économie est d’abord une affaire de pouvoir sur la valeur, et la classe dirigeante a l’œil rivé non pas d’abord sur son porte monnaie mais sur sa souveraineté sur la production. La lutte pour un partage moins injuste de la valeur grâce à une fiscalité juste, qui est toujours une faute stratégique, devient une impasse dramatique quand la classe capitaliste est à l’offensive pour reconquérir des terrains perdus en termes de pratique de la valeur. Les opposants aux réformateurs sont condamnés à continuer de perdre si leur contre-offensive n’est pas menée sur le terrain du salaire à vie contre le marché du travail, de la copropriété d’usage de l’outil de travail contre la propriété lucrative, de la cotisation investissement contre le crédit, de la mesure de la valeur par la qualification du producteur contre sa mesure par le temps de travail.
On voit que placer les revendications sur le terrain de la fiscalité n’est pas la seule des « conduites d’évitement » que j’analyse dans Emanciper le travail. J’entends par conduites d’évitement des mots d’ordre qui évitent de mener la lutte de classes parce qu’ils se situent sur le terrain du partage d’une valeur capitaliste qui, elle, n’est pas combattue, au lieu de se situer sur le terrain de l’affirmation d’une autre production de valeur que la valeur capitaliste. J’insiste dans l’ouvrage sur l’évitement de la lutte de classes qu’il y a à revendiquer le plein emploi (et donc plein d’employeurs), un pôle public du crédit (et donc la légitimité du crédit) ou une allocation d’autonomie pour la jeunesse (qui continue à réduire le droit au salaire à la présence sur le marché du travail).
Initiative Communiste : Quelles revendications formuler pour contrer les attaques contre les diverses branches de la Sécu ?
Et si nous arrêtions de « formuler des revendications » ? Revendiquer, c’est reconnaître la légitimité des capitalistes, c’est accepter notre position de demandeurs, certes dans l’espoir de conquérir des droits nouveaux, mais sans mise en cause fondamentale de la règle du jeu. Or la classe dirigeante n’a strictement plus rien à négocier dans les pays anciennement capitalistes où elle est décidée à réduire les droits salariaux en jouant sur la disparité des droits populaires à l’échelle mondiale. La seule réponse à cette offensive est de partir des tremplins conquis par une lutte de classes anticapitaliste riche de deux siècles pour nous passer des capitalistes et produire autrement. En poussant plus loin le « déjà-là » anticapitaliste d’une production de valeur libérée de la propriété lucrative, du marché du travail, du crédit, de la mesure de la valeur par le temps de travail, comme c’est déjà le cas pour le tiers du PIB, mais un tiers fort malmené ou perverti tant qu’il n’est pas généralisé.
Notre temps militant se perd beaucoup trop en parlotes avec des patrons, des élus et des responsables d’administrations qui sont des adversaires à disqualifier et non des interlocuteurs à qui présenter des revendications. Nos seuls interlocuteurs sont les travailleurs, et le temps militant, qu’il soit syndical, politique ou associatif, doit être consacré pour l’essentiel à leur auto-organisation. Généraliser le salaire à vie et la copropriété d’usage de l’outil de travail par les salariés – et donc maîtriser l’investissement, cela suppose un combat constant pour disqualifier le marché du travail et les employeurs, les propriétaires lucratifs et les prêteurs, pour rendre populaires la responsabilité exclusive des travailleurs sur ce qui est produit, l’élection des directions, l’affectation de la valeur ajoutée aux cotisations pour payer les salaires à vie et subventionner l’investissement. Le temps n’est plus aux revendications mais à la popularisation de mots d’ordre d’auto-organisation, et leur réalisation partout où c’est possible. J’en ai déjà évoqué quelques-uns mais je prends des exemples supplémentaires.
Reprise des entreprises par les salariés : la situation se présente des milliers de fois chaque année, et il faut que se multiplient les preuves que des entreprises marchandes peuvent fonctionner sans employeur, sans actionnaire et sans prêteur. Cela suppose que les entreprises récupérées soient effectivement gérées par les salariés, tous associés aux décisions de l’amont à l’aval de la production et à la désignation de la hiérarchie, qu’elles fonctionnent en réseau et mutualisent leur valeur ajoutée pour financer salaires et investissements, qu’elles mobilisent parmi leurs salariés des retraités qui ne demandent qu’à participer au bien commun autrement que par le bénévolat associatif et qu’elles n’auront pas à payer, puisqu’ils le sont par leur pension. Cela suppose aussi, comme le préconise Pierre Rimbert à propos du financement de la presse d’information générale[7], que soit popularisé un mot d’ordre de cotisation sur la valeur ajoutée de toutes les entreprises pour soutenir l’activité des entreprises autogérées.
Gestion par les salariés, réseau de mutualisation de la valeur ajoutée, cotisation universelle, mobilisation des retraités : ce que je viens de dire à propos de la reprise des entreprises par les salariés vaut aussi pour toutes les coopératives et les initiatives de production alternative qui se multiplient et qui ne pourront tenir face au capital que si elles s’inscrivent dans une logique macroéconomique de mutualisation de la valeur.
Autre pratique à porter : l’exclusivité des marchés publics aux entreprises autogérées et sans propriété lucrative. La mutualisation de la valeur qu’opère l’impôt pour la construction d’une piscine municipale ou du réseau ferré et qu’opère la cotisation pour la production des médicaments va à des groupes capitalistes qui n’existent que par les marchés publics. Le scandale que provoquent ces profits doit être saisi pour populariser, au contraire, une mutualisation de la valeur au seul service de la généralisation de la copropriété d’usage des entreprises.
Le mot d’ordre, absolument urgent, de hausse massive des taux de cotisation, porté pendant des décennies par la classe ouvrière (le taux de cotisation a plus que doublé de 1945 au début des années 1980), et abandonné depuis plus de trente ans alors que les réformateurs mènent contre la cotisation-salaire une bataille acharnée qui est la cause unique des difficultés des régimes de sécurité sociale, ne peut redevenir central que si nous montrons que la cotisation-salaire reconnaît la production, et non pas la dépense, des soignants, des retraités. Et c’est la même chose pour l’impôt qui paie les fonctionnaires ou les salariés des associations de service public. Ces derniers produisent la valeur correspondant à la subvention qu’ils reçoivent, ils ne dépensent pas de l’argent produit par d’autres. Le mot d’ordre de gestion du Trésor public et des caisses de sécurité sociale par les seuls salariés, avec élection des directions par les administrateurs salariés –comme c’était le cas avant l’étatisation antidémocratique du dispositif- doit être accompagné d’un déplacement de la pratique syndicale dans les services publics et la sécurité sociale, et plus généralement partout où il n’y a pas de propriétaire lucratif, vers l’auto-organisation des salariés, la délibération par les intéressés de l’objet et des moyens du travail. Que les fonctionnaires soient à la hauteur des libertés que leur offre leur statut et en conquièrent collectivement d’autres est la condition pour rendre attractives des entreprises sans actionnaires et sans employeurs.
Je voudrais insister sur un point rarement abordé, la convergence à construire avec les travailleurs indépendants, qu’ils soient protégés du capital par les règles des professions libérales que le gouvernement actuel est décidé à faire sauter, comme en témoigne la loi Macron pour les professions judiciaires, ou qu’ils soient livrés à lui sans défense, comme les paysans ou les artisans et commerçants. Ces travailleurs ont une expérience de la maîtrise de l’outil de travail et se battent de fait contre le capital pour ne pas être dépossédés de toute la chaîne de production d’un bien ou service. Qu’ils aient en général une idéologie de droite n’est pas un obstacle insurmontable si nous savons mettre les mots sur leur expérience de fait de la nocivité du capital et si nous déplaçons l’objet de notre action syndicale vers la maîtrise de l’outil de travail.
Oui, c’est là un vrai déplacement de l’activité militante, et je renvoie aux développements que je consacre aux mots d’ordre immédiats possibles dans Emanciper le travail.
Initiative Communiste : nous nous doutons bien à IC que les attaques contre la Sécu et les autres acquis de 45-47 ne changeraient pas de nature si la France sortait de l’UE et de l’euro, mais nous pensons que la construction supranationale euro-atlantique, éventuellement coiffée par une Union transatlantique couplée à l’O.T.A.N., est une arme sociopolitique (et potentiellement, militaire) de premier plan contre les travailleurs et les peuples souverains. Qu’en penses-tu de ton côté ?
 La lutte contre l’UE, inamendable syndicat du capital contre les peuples, doit être de tous les instants. Sur le fait que l’UE et l’euro sont des outils capitalistes contre l’émancipation des travailleurs, je ne saurais trop recommander la lecture des remarquables travaux à la fois historiques et lexicométriques de Corinne Gobin, une collègue spécialiste de sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles. Elle a d’ailleurs écrit une importante contribution à l’ouvrage collectif que j’ai édité avec Bernadette Clasquin[8] sur les effets destructeurs en matière de droits salariaux des politiques de l’emploi impulsées par l’UE depuis les années 1990. Quant au côté potentiellement militaire, pour reprendre vos termes, de l’arme contre les peuples souverains que sont l’UE et l’OTAN, il a une telle évidence aujourd’hui, joint à la militarisation de notre quotidien et à la criminalisation de l’action militante sous prétexte de lutte contre le terrorisme, qu’il est clair que la classe dirigeante est en train de mettre en selle l’extrême-droite et de construire l’arsenal de sa riposte violente aux mobilisations populaires que son échec économique suscite.
La lutte contre l’UE, inamendable syndicat du capital contre les peuples, doit être de tous les instants. Sur le fait que l’UE et l’euro sont des outils capitalistes contre l’émancipation des travailleurs, je ne saurais trop recommander la lecture des remarquables travaux à la fois historiques et lexicométriques de Corinne Gobin, une collègue spécialiste de sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles. Elle a d’ailleurs écrit une importante contribution à l’ouvrage collectif que j’ai édité avec Bernadette Clasquin[8] sur les effets destructeurs en matière de droits salariaux des politiques de l’emploi impulsées par l’UE depuis les années 1990. Quant au côté potentiellement militaire, pour reprendre vos termes, de l’arme contre les peuples souverains que sont l’UE et l’OTAN, il a une telle évidence aujourd’hui, joint à la militarisation de notre quotidien et à la criminalisation de l’action militante sous prétexte de lutte contre le terrorisme, qu’il est clair que la classe dirigeante est en train de mettre en selle l’extrême-droite et de construire l’arsenal de sa riposte violente aux mobilisations populaires que son échec économique suscite.
Bref, l’enjeu de la lutte de classes est devenu aujourd’hui si lourd qu’il est essentiel de se souvenir qu’on ne construit pas une classe révolutionnaire par une lutte contre, mais par une lutte pour. Les épreuves, les souffrances qu’entraînera l’affrontement au capital à la hauteur où il doit être maintenant mené ne pourront être acceptées que si le projet est enthousiasmant et mobilise pour construire l’alternative et non pas simplement pour en finir avec des élites abhorrées. Le programme du CNR s’appelle « Les jours heureux », pas « Mort au nazisme » (même si une partie est consacrée à cette nécessaire dimension de la bataille). Et donc la nécessaire bataille contre l’UE et l’euro comme monnaie unique (et contre l’illusion de leur possible démocratisation hélas répandue dans la gauche de gauche sous l’invocation d’une « autre Europe ») n’est qu’une composante d’une bataille pour la maîtrise populaire de la valeur, y compris à l’international, dans toutes les dimensions que j’ai développées. Autrement dit, la lutte contre l’UE n’a de sens qu’au service de la mobilisation pour le salaire à vie ou la copropriété d’usage de tous les outils de travail. Par exemple, pour la crédibilité même d’un projet qui conduira le premier peuple qui le mettra en œuvre à sortir de la zone euro et fort vraisemblablement de l’UE (sauf contagion révolutionnaire permettant une rapide reconstruction), il faut dès maintenant montrer comment nous allons recréer le franc et l’articuler à l’euro comme monnaie commune, comment nous allons récuser les directives de la Commission et la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, pour m’en tenir à ces seuls exemples. Mais ces démonstrations concrètes doivent être en permanence rapportées à un projet de salaire à vie ou de subvention de l’investissement qui n’est aujourd’hui pas popularisé alors qu’il doit devenir le cœur de notre action militante.
[1] Bernard Friot, Puissances du salariat, nouvelle édition augmentée, Paris, La Dispute, 2012 (première édition 1998)
[2] Bernard Friot, L’enjeu du salaire, Paris, La Dispute, 2012
[3] Bernard Friot, Emanciper le travail, entretiens avec Patrick Zech, Paris, La Dispute, 2014, second entretien
[4] Pour éviter la stigmatisation de ses bénéficiaires, le panier de soins peut être universel. Mais cette universalité ne change rien au fond du projet des réformateurs : les régimes complémentaires de salaire différé doivent voir leur place augmenter au détriment d’un régime général maladie fiscalisé.
[5] Quel congrès de la CGT a décidé de renoncer à la retraite à 55 ans pour la retraite à 60 ans ? Je n’en trouve pas.
[6] Pour financer aux 50 millions de résidents de plus de 18 ans un salaire à vie moyen net de 25000 euros par an, il faut 1250 milliards, soit les montants déjà consacrés à la rémunération du travail.
[7] Pierre Rimbert, Le Monde diplomatique, décembre 2014
[8] Bernadette Clasquin et Bernard Friot, dir, The Wage under Attack : Employment Policies in Europe, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2014. Cet ouvrage reprend les résultats d’une équipe de chercheurs de 7 pays de l’ouest-européen.





