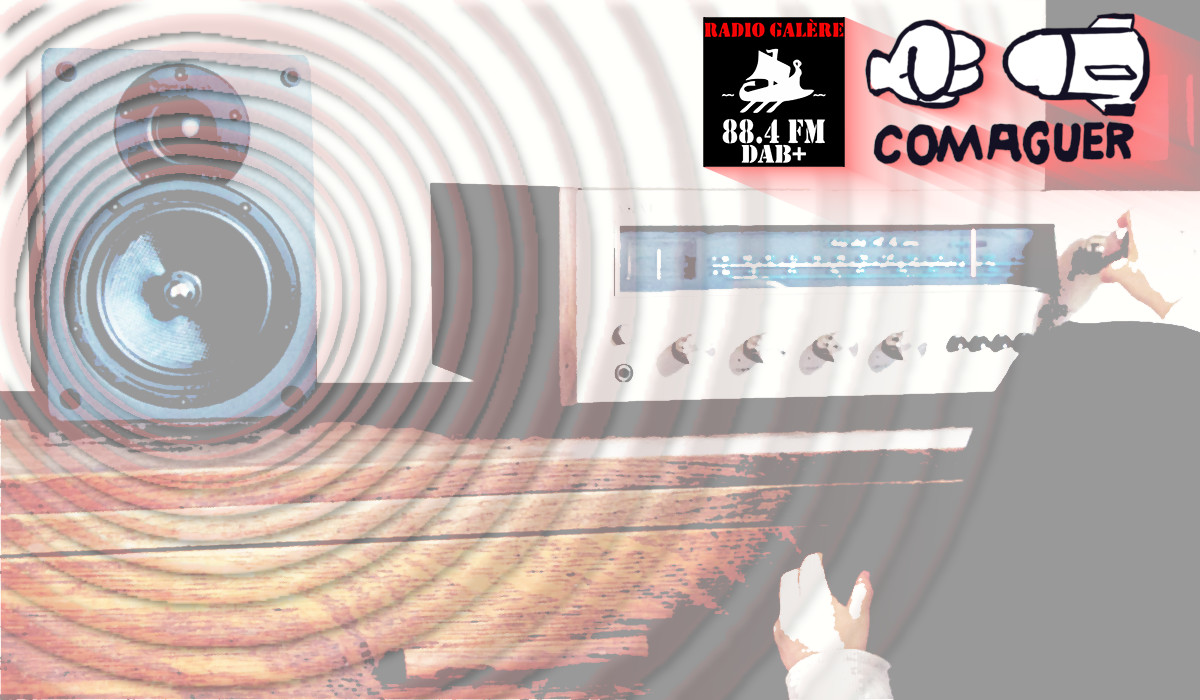Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l’Université de Rennes, a publié sur aoc.media le 27 janvier 2020 la tribune ci-dessous sur la future « Loi de Programmation Pluriannuelle pour la Recherche » (LPPR) qui, avec la contre-réforme des retraites, se heurte à l’opposition grandissante des universitaires. La LPPR menace en effet de mort immédiate, entre autres, le statut d’« indépendance » universitaire, fruit d’une longue histoire depuis les « libertés académiques » universitaires du Moyen Âge concédées par l’Église romaine dans le cadre de son conflit avec l’État national.
La liberté accordée à la réflexion et à la recherche des personnels laïques a grandi dans les périodes de progrès. Après la Libération, elle a été renforcée par le statut de la fonction publique dit Statut Maurice Thorez (1946) qui, non seulement a confirmé, pour l’Université, l’indépendance formelle que la dictature de Vichy avait balayée par les décrets de l’été 1940 (autorisant révocation immédiate des fonctionnaires, juifs, progressistes, républicains), mais l’a octroyée à tous les fonctionnaires enseignants.

Le pouvoir, officiellement de droite ou présumé de gauche, au service du capital financier s’appuie depuis plus de 20 ans sur les prescriptions successives de l’Union européenne pour casser l’Université : la casse a été organisée par la « convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la régioneuropéenne » dite de Lisbonne (1997) ensuite codifiée en processus de Bologne (1999). Il s’agit de fabriquer une docile main-d’œuvre privée de formation générale, nourrie à la sauce historique et philosophique des manuels « européens », et adaptée aux tâches d’exécution strictes.
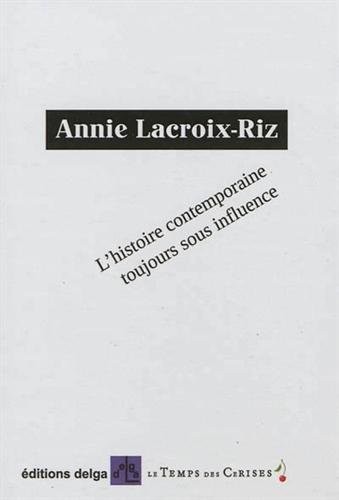
Philippe Blanchet expose ci-dessous les grandes étapes de cette mise à mort de « l’indépendance » universitaire depuis le statut de 1984, sous Mitterrand, où de premières atteintes aux conditions d’enseignement et de recherche avaient été « compensées » par le renforcement constitutionnel des libertés académiques. Le grignotage n’a jamais cessé depuis lors, mais on est entré depuis 2007, sous Sarkozy, dans l’ère de la violation caractérisée du rejet majoritaire de mai 2005 de la « constitution européenne », dans un processus ininterrompu de mise en œuvre autoritaire du « processus de Bologne ».
Freinée par les résistances, et notamment le grand mouvement universitaire de 2008-2009 contre la loi Pécresse-Sarkozy dite « de Responsabilisation des Universités » (LRU), poursuivie sans répit sous la présidence Hollande, aussi « européiste » que la précédente et la suivante, la casse du statut connaît, sous la présidence Macron, une étape décisive.
Les droits des personnels ont déjà été profondément réduits par la dégradation continue des conditions de travail, le manque dramatique de moyens, la casse accélérée de la formation des enseignants et des étudiants, la mise sous tutelle financière de la recherche et la précarisation massive de la profession qui tarit le recrutement de personnels titulaires et multiplie les contrats courts excluant toute liberté en matière de recherche. La privatisation générale de l’Université en cours s’appuie sur des présidents d’université érigés, depuis la LRU, en patrons-managers : personnellement intéressés à la casse par l’augmentation substantielle de leurs revenus, sous forme de primes notamment, qui les sépare de leurs pairs, ils violent allègrement toutes les instances statutaires constituées d’universitaires. L’étape actuelle prétend achever le « processus de Bologne », c’est-à-dire liquider, avec les statuts, tout ce qui reste de l’autonomie intellectuelle des enseignants-chercheurs. Les liens de la LPPR avec la casse des retraites sont si évidents que, partout en France, les personnels universitaires, de plus en plus largement mobilisés, placent sur le même plan le rejet formel des deux prétendues « réformes ».
Universitaires, la fin de l’indépendance ?
Universitaires, la fin de l’indépendance, Philippe Blanchet, Sociolinguiste
La future « Loi de Programmation Pluriannuelle pour la Recherche » suscite une très vive opposition au sein de l’enseignement supérieur. Elle semble en effet vouloir poursuivre les attaques menées depuis plusieurs années contre le statut particulier des universitaires. Un statut qui garantit leur indépendance, à la différence des autres fonctionnaires, et constitue l’une des meilleures défenses face aux appétits des prédateurs économiques, et aux pressions politiques.
Le projet de Loi de Programmation Pluriannuelle pour la Recherche (LPPR), annoncée pour le printemps 2020, suscite de très vives contestations dans le monde universitaire. Son inspiration clairement « néolibérale » est critiquée. Elle est perçue comme visant un renforcement du mode concurrentiel d’exercice de la recherche « sur projets », que ne supportent plus les chercheur·e·s à l’Université et dans les grands organismes de recherche (type CNRS), au bout d’environ vingt ans de mise en place croissante.
Elle appliquerait même cette mise en compétition aux universitaires dont les missions et rémunérations dépendraient de leurs « performances » à court terme. Elle prévoit également des embauches sous contrats privés en contournant le système de validation paritaire des universitaires par les universitaires. Elle renforce ainsi un « management » de la recherche et des chercheur·e·s, façon entreprise privée à but lucratif, appelé « pilotage stratégique », qui est en opposition avec le statut protégé d’indépendance académique et de service public des universitaires.
Les universitaires[1] sont en effet des fonctionnaires d’État à statut particulier. Cette indépendance est fondée sur la nécessité impérative d’indépendance et de liberté de production des connaissances scientifiques (par la recherche), de la diffusion de ces connaissances (par l’enseignement et les publications), des modalités de ces missions (auto-organisation), qui doivent être protégées des censures ou instrumentalisations politiques, économiques, religieuses, etc. Cette indépendance s’inscrit dans une longue tradition de « franchises universitaires » et de « libertés académiques », mises en place dès le Moyen-Âge (protection par le Pape de La Sorbonne contre le pouvoir temporel en 1229). Émile Durkheim le rappelait en 1918[2]. Ce statut particulier était déjà inscrit dans la loi Faure de novembre 1968 et il a été confirmé par le Conseil d’État dans une décision de 1975.
Ce statut est défini, aujourd’hui, par un décret de 1984 « portant statut particulier », dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le Conseil Constitutionnel[3]. Il a été régulièrement confirmé par différents décrets, par différents jugements (par exemple du Conseil d’État en 1992[4]), et intégré dans le Code de l’Éducation[5]. Ce statut déroge au droit commun de la fonction publique. Il s’agit donc d’un statut supra-législatif, auquel même une loi ne peut porter atteinte.
Les franchises universitaires incluent jusqu’à l’interdiction aux forces de polices ou militaires (dirigées par le pouvoir exécutif) de pénétrer dans une université, sauf sur demande ou autorisation de la communauté universitaire représentée par le/la président·e élu.e de l’université.
Depuis 2007, avec la loi dite « de Responsabilisation des Universités », les gouvernements ont cherché à imposer frontalement le projet politique dit « néolibéral » aux universités.
Grâce à ce statut fortement protecteur, les universitaires « jouissent d’une pleine indépendance ». Ils ou elles n’ont pas de supérieur hiérarchique et sont pour cela nommé·e·s par le ou la Président·e de la République pour les Professeur·e·s, et par le ou la Ministre de l’enseignement supérieur et la recherche pour les Maitres de Conférences – et non pas par les Recteurs ou Rectrices d’académie, ni par les Président·e·s d’universités qui ne sont ni leurs patrons, ni leurs employeurs. L’ensemble des procédures et décisions de recrutement, de suivi de carrière, d’évaluation, de mesures disciplinaires éventuelles, ne peut être effectué que par des pairs et en toute indépendance. Les universitaires sont « inamovibles », ce qui signifie qu’ils ou elles ne peuvent pas être déplacé·e·s, rétrogradé·e·s, révoqué·e·s ou suspendu·e·s de leurs fonctions, sans la mise en œuvre de procédures lourdes et complexes, différentes du droit commun disciplinaire[6].
Les universitaires jouissent aussi « d’une entière liberté d’expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l’éducation, les principes de tolérance et d’objectivité ». Les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheures ne sont donc pas soumis à l’obligation de neutralité[7] dans l’exercice de leur fonction, contrairement aux autres fonctionnaires, sachant que cette fonction inclut des prises de paroles publiques et des écrits au delà des cercles scientifiques (mission de diffusion publique des connaissances).
Depuis 2007, avec la loi dite « de Responsabilisation des Universités » (LRU), les gouvernements ont cherché à imposer frontalement le projet politique dit « néolibéral » aux universités. D’autres tentatives avaient eu lieu précédemment mais n’avaient pas réussi (projet de loi Devaquet en 1986, projet Raffarin en 2003, retirés face aux vives contestations) ou n’avaient réussi à infiltrer l’Université que de façon indirecte (processus de Bologne 1999, loi Villepin 2006).
En 2018 et 2019, le gouvernement Philippe et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal ont accentué cette offensive. D’abord avec la loi dite « Orientation et Réussite des Étudiants » (ORE), qui met en place une sélection à l’entrée en première année d’université. Ensuite avec l’ordonnance de décembre 2018 sur les « expérimentations » afin de créer des universités dérogatoires au Code de l’Éducation. Avec l’annonce enfin, en 2019, du projet de LPPR… Il est utile de noter que toutes ces mesures ont été contestées par l’ensemble des syndicats de l’ESR (Enseignement Supérieur et Recherche), y compris les syndicats réputés enclins à négocier ces réformes pour les accepter.
Parmi les arguments développés par les opposants à ces mesures, il y a toujours celui des attaques menées contre le statut des universitaires. L’indépendance des universitaires et leur liberté d’expression pose un problème majeur à l’autoritarisme « néolibéral ». D’une part, les gouvernements craignent la force des mouvements étudiants et universitaires au moins depuis Mai 68 : ces mouvements obtiennent régulièrement gain de cause (cf. projets Devaquet et Raffarin ci-dessus) et pas seulement sur des questions universitaires (comme en Mai 68 ou contre le Contrat Première Embauche en 2006). Quand certains des principaux acteurs potentiels de ces « réformes » prennent publiquement la parole pour les critiquer avec des méthodes efficaces d’analyse et d’exposé, l’effet de contestation est puissant.
D’autre part, les universitaires, s’appuyant sur leur indépendance, peuvent refuser de réaliser des tâches qui ne figurent pas explicitement et précisément dans leurs obligations statutaires protégées par le décret de 1984. C’est ce qui s’est passé avec le refus collectif de centaines de départements, d’UFR (de facultés) et parfois d’universités entières de participer au dispositif Parcoursup instauré par la loi ORE en 2018. Il en a été de même pour l’augmentation des frais d’inscription des étrangers et étrangères hors Union Européenne décidée en 2018 par le Premier Ministre : la quasi totalité des universités a refusé de l’appliquer[8].
Beaucoup de président·e·s d’universités se sont engouffré·e·s dans le nouveau rôle de Grand Patron que leur a donné la loi de 2007
Parmi les attaques menées directement ou indirectement, administrativement ou symboliquement, contre le statut des universitaires ces deux dernières décennies, on trouve les « dérogations expérimentales » prévues par l’ordonnance de décembre 2018, qui permettent de réduire à une minorité, sans pouvoir de décision, les représentations des personnels et des étudiant·e·s dans les instances de direction de ces regroupements d’universités. D’autres que des universitaires pourraient désormais gouverner une université et imposer, de l’intérieur des instances, des modalités d’exercice de leur mission à des universitaires.
Un article de la « Loi de transformation de la fonction publique » (2019) dispose que, quand il siège en formation disciplinaire liées à des accusations de faute professionnelle, le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (composés d’universitaires élu·e·s) n’est plus présidé par un professeur des universités élu mais « par un Conseiller d’État désigné par le Vice-président du Conseil d’État », qui ne sont pas indépendants du pouvoir exécutif.
L’incitation à recourir massivement à des emplois contractuels pour effectuer les missions d’enseignement et de recherche des universitaires (LRU, projet de LPPR), permet de contourner les emplois statutaires et même de contourner les instances de recrutement et de suivi de carrière, exclusivement composées d’universitaires pour les postes de statut universitaire. Cela va jusqu’au projet de suppression, dans la LPPR, du Conseil National des Universités, instance nationale de validation des candidatures sur les postes d’universitaires et de suivi de carrière, exclusivement composée d’universitaires élu·e·s et nommé·e·s.
Beaucoup de président·e·s d’universités se sont engouffré·e·s dans le nouveau rôle de Grand Patron que leur a donné la loi de 2007. Ils et elles ne se pensent parfois plus comme des élu·e·s chargé·e·s d’administration par leurs pairs mais comme des « supérieurs hiérarchiques » (qu’ils et elles ne sont pas). Certain·e·s président·e·s ou responsables de composantes, comme des directeurs·trices d’UFR aussi appelés parfois « doyen de faculté », ont prétendu imposer aux universitaires des contraintes contradictoires avec le statut de 1984. De nombreuses saisines des tribunaux administratifs et du conseil d’État par des universitaires ont assez rapidement établi une jurisprudence limitant ces pouvoirs.
Les universitaires font, depuis quelques années, l’objet de menaces ou de poursuites pour « diffamation » par des organismes privés mis en question à l’issue de recherches ou des groupes de pression politiques. Cela arrive même de la part d’un président d’université, comme en 2015 contre un universitaire qui avait ironisé sur une liste de diffusion interne en commentant l’accueil du Premier ministre M. Valls à l’université. Il s’agit de « procédures bâillons » destinées à limiter la liberté d’expression des universitaires.
On assiste même à une remise en question au plus haut niveau de l’indépendance des universitaires. C’est la ministre Frédérique Vidal qui déclare le 16 janvier 2019 au Sénat : « Les présidents d’universités sont fonctionnaires de l’État et à ce titre, tenus à un devoir d’obéissance et de loyauté ».
L’asphyxie de l’université facilite le chantage aux moyens et provoque le dilemme moral des personnels
Il y a, enfin, un moyen indirect efficace pour réduire l’indépendance des universitaires, pour réduire les franchises universitaires en général et avancer dans l’asservissement de l’Université au pouvoir autoritaire « néolibéral » : la mise en difficulté quotidienne voire la mise en faillite financière. La LRU a permis aux gouvernements de lâcher financièrement les universités. Nombre d’entre elles se sont retrouvées en grande difficulté (environ 25 dès 2015) voire carrément en déficit, ce qui a conduit des recteurs et rectrices, représentant les ministres de l’enseignement supérieur et la recherche, à prendre la main sur ces universités. Presque toutes, en tout cas, se sont retrouvées en situations difficiles en termes de moyens, qu’il s’agisse de personnels administratifs et techniques, enseignants et enseignants-chercheurs, ou de moyens financiers, pour assurer leurs missions. Et ceci dans une période d’accroissement démographique des effectifs étudiants (en augmentation de 25% en moyenne).
Cette asphyxie provoque deux choses. D’une part, la facilité pour le pouvoir de faire du chantage aux moyens : « appliquez notre politique et nous vous donnerons davantage de moyens » (par exemple les postes liés à l’application de la loi ORE). D’autre part, la mise en dilemme moral des personnels : soit ils se laissent happer par la surcharge de travail qui permet de répondre tant bien que mal aux besoins des étudiant·e·s et de faire fonctionner à peu près l’université, soit ils et elles vont au blocage en laissant les étudiant·e·s subir les conséquences de l’abandon de l’université par un État lointain qui sera plus rarement estimé fautif que les personnels.
Cela conduit les universitaires à accepter de « jouer le jeu » de l’université néolibérale en acceptant de multiplier les heures d’enseignement sous-payées voire pas payées du tout, en acceptant de multiples tâches administratives non statutaires. Et ces tâches sont multipliées par une politique « de projets », de candidatures à des labels et à des financements précaires, d’évaluation incessante qui conduit à remplir toutes sortes de tableaux et dossiers pour obtenir les moyens de travailler. L’exercice de l’indépendance académique et de la liberté d’expression devient de plus en plus contraint, difficile, secondaire, dans un tel contexte.
Le statut particulier des universitaires est méconnu du grand public. Pourtant, cette indépendance statutaire, historique et liée à leurs missions, constitue l’une des meilleures défenses de l’Université comme lieu d’élaboration, de renouvellement et d’enseignement des connaissances scientifiques, face aux appétits des prédateurs économiques et aux pressions politiques. Ce statut très protecteur des universitaires constitue un obstacle majeur pour la mise en place d’une politique « néolibérale » autoritaire en matière d’universités. Faute de pouvoir s’attaquer frontalement aux universitaires, les gouvernements « néolibéraux » cherchent à les contourner, à rogner leur indépendance, à remettre en question leur liberté d’expression et d’exercice de leurs missions de service public.
NDLR : Philippe Blanchet publie Main basse sur l’Université chez Textuel
[1] Le terme officiel les désignant est « enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheures ».
[2] dans La vie universitaire à Paris, publié en 1918 par le Conseil de l’université de Paris.
[3] Décret du 6 juin 1984, d’abord réservé aux professeurs des universités, puis élargi en 1987 à l’ensemble des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheures incluant donc les maitres et maitresses de conférences.
[4] Les décision du CE utilisent toujours l’une de ces deux mentions : « le principe constitutionnel d’indépendance des professeurs des universités » ou « le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance des professeurs des universités ».
[5] Article L-952.
[6] D’autres corps de fonctionnaires bénéficient de cette protection.
[7] Qu’on appelle souvent, à tort, « devoir… » ou « obligation de réserve », notion qui n’existe pas en tant que telle en droit français.
[8] Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs fini par leur donner raison.