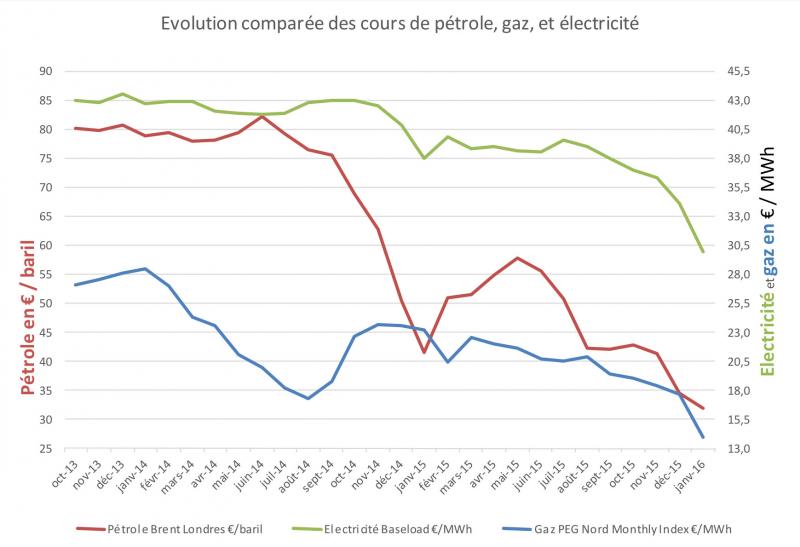A lire certaines analyses – même bien intentionnées, les moins nombreuses, certes – des relations entre la Révolution cubaine et l’Empire étasunien, on a l’impression que leurs auteurs font une fixation sur l’époque la plus immédiatement contemporaine, à savoir les huit années de George W. Bush (2001-2009). Attention ! Il ne faudrait quand même pas faire retomber toutes les fautes sur ce président, aussi pervers et exécrables qu’ils aient été, lui et son gang de mafieux et de tortionnaires par sous-fifres interposés, sinon on risque de s’interdire une vraie compréhension des rapports ayant TOUJOURS existé entre la Révolution cubaine et les administrations étasuniennes, toutes tendances confondues, depuis maintenant cinquante ans. La « marque de fabrique » de Bush, pour ainsi dire, c’est d’avoir exacerbé à l’extrême tous les facteurs ayant servi de soubassement à la politique obsessionnellement maladive de Washington depuis 1959 envers son petit et plus proche voisin.
Pour ne prendre qu’un exemple très récent, l’inscription pour la nième fois de Cuba sur la liste du State Department épinglant les « pays parrainant le terrorisme » n’est pas une invention de Colin Powell ni de Condoleezza Rice, les deux secrétaires d’État de Bush. Ni sur les moultes autres listes similaires. Ce genre de jeu remonte à bien avant. J’avoue avoir oublié qui les a inventées pour poser le gouvernement étasunien en juge de l’univers (l’Etat terroriste par excellence jugeant ses victimes !), mais là n’est pas l’important. Je tiens à rappeler que Clinton a régné lui aussi huit années à la Maison-Blanche (1993-2001), et que les relations avec La Havane, loin de s’améliorer, se sont dégradées, alors que, pourtant, l’ « ennemi communiste » avait disparu, que l’avenir souriait de toutes ses dents au capitalisme triomphant (la fameuse « fin de l’Histoire »), que les tensions internationales étaient donc moindres et que la donne stratégique mondiale avait changé du tout au tout, devenant infiniment favorable aux ennemis des « forces de progrès », comme on disait quand il existait encore un mouvement communiste international digne de ce nom.
Trois ans à peine après son entrée à la Maison-Blanche (1996), Clinton signait la fameuse Loi Helms-Burton, l’une des plus punitives et des plus extraterritoriales qui soient, concoctée et rédigée par la mafia terroriste cubano-américaine (FNAC ou Fondation nationale cubano-américaine) et par les avocats de Bacardi, pour faire rendre gorge au trublion qui, six ans après l’effondrement du communisme est-européen, s’entêtait à croire qu’il pouvait exister de meilleurs lendemains hors du capitalisme.
Du néoconservateur Bush père au néolibéral Clinton, rien n’avait changé pour Cuba : les terroristes de Miami continuaient d’avoir les coudées franches pour agir, la mafia de Miami continuait de faire la loi et le droit en matière cubaine ; la Loi d’ajustement cubain continuait d’engloutir son lot de victimes dans le golfe du Mexique ; la loi Torricelli, votée en 1992, continuait de sévir et d’empêcher, entre autres rétorsions, les filiales étrangères de sociétés étasuniennes de faire du commerce avec Cuba ; le département d’État maintenait intacte la manœuvre annuelle de ses prédécesseurs à la Commission des droits de l’homme de Genève pour y faire condamner Cuba. Etc., etc., etc., comme dirait Raúl et Fidel… La liste serait interminable. Bref, tout était à l’identique.
Ce n’est pas non plus Bush qui a inventé « l’après-Castro » avec sa fameuse « Commission présidentielle pour aider à libérer Cuba » (le vrai sens de son intitulé officiel : « Commission présidentielle d’aide à Cuba libre »), son proconsul chargé de veiller à son implantation une fois les carottes cuites, et son énorme Rapport de 2004 qui détaille jusque dans ses moindres détails sur cinq cents pages ce que devra redevenir l’île que les médias ne pourraient plus qualifier – ouf ! – de « communiste » pour être réintégrée dans le giron de la civilisation politique judéo-chrétienne. Non, là encore, Bush n’a fait que pousser jusqu’à la caricature la plus ridicule et la plus cruelle la politique que Clinton (et ses prédécesseurs) avait mise en place avant lui. Car la loi Helms-Burton contenait non seulement un durcissement du blocus économique, commercial et financier en place depuis 1962, mais aussi une sorte de première mouture de ce que Cuba devait être après la chute du castrisme : le « rapport Clinton » de 1996 n’est pas aussi détaillé que le « Rapport Bush » de 2004 (avec sa version corrigée et révisée 2006), mais il partait des mêmes tenants et cherchait les mêmes aboutissants.
Sous Clinton tout comme sous Bush Jr., la mafia terroriste cubano-américaine de Miami continuait de faire la loi et de dicter la politique cubaine (ou plutôt « anticubaine ») de la Maison-Blanche. C’est justement à cause de cette latitude de manœuvre qu’elle s’arrangea pour, ainsi dire, « coincer » Clinton au tournant. Elle peaufina l’épisode des avionnettes de « Hermanos al rescate » (Frères à la rescousse) du 24 février 1996 – date historique choisie à dessein, puisque c’est ce jour-là de 1895 que reprenait la guerre d’Indépendance cubaine organisée par José Martí – pour pousser Clinton dans ses derniers retranchements, parce qu’elle s’était bien rendue compte que le bonhomme ne risquerait pas sa vie à défendre les derniers remparts de ses principes et qu’il lui serait assez facile de lui faire manger au râtelier de l’aile terroriste de Miami le picotin d’avoine dont il avait dit ne pas vouloir.
Son épouse d’alors et de maintenant et actuelle secrétaire d’État d’Obama vient d’ailleurs d’évoquer cet épisode, le 22 avril dernier, devant une sous-commission du Sénat : « Je me rappelle bien quand ces deux petits avions, désarmés, qui ne faisaient rien d’autre que de larguer des tracts, ont été abattus par le régime castriste. » La mémoire fortement sélective ou oublieuse d’Hillary Clinton prêterait à rire si les choses n’étaient pas si sérieuses : car le département d’Etat, la Maison-Blanche, les autorités pertinentes et les organes chargés de faire respecter la loi (comme on dit en anglais) étaient parfaitement au courant de la provocation absolument « annoncée » que Basulto, chef de Frères à la rescousse, préparait avec deux autres « petits avions désarmés » contre La Havane. Je ne vais pas retracer l’épisode. Toujours est-il que si l’administration Clinton n’avait pas été si tolérante envers les terroristes de Miami et avait interdit le décollage des trois Cessna (à usage militaire), d’autant que le « régime castriste » l’avait avertie, à bout de patience (ce n’était pas le premier vol, loin de là), des conséquences si la bande à Basulto survolait une nouvelle fois La Havane, les relations entre les deux pays auraient poursuivi sans plus leur mauvais train-train habituel.
La mafia de Miami n’attendait que ça : criant au crime, poussant des cris de putois, elle exerça de très fortes pressions sur l’administration et le beau Bill – sans trop rechigner, ma foi – signa la Loi Helms-Burton. Si violatrice du droit international que l’Union européenne (encore Communauté) fit semblant de prendre la mouche et de montrer les dents, menaça de présenter le cas devant le tribunal de l’OMC, puis y renonça après que Clinton lui passa la main dans le sens du poil et promis – juré craché – qu’il allait tout faire pour arranger les choses… Ce qu’il ne fit jamais, bien entendu. La Communauté européenne n’allait tout de même pas se fâcher avec la « Grande Démocratie », alliée et amie, pour un « régime communiste » qui refuse, qui plus est, de passer sous les fourches caudines… !
Et les choses empirèrent tant et la mafia terroriste de Miami avait à ce point les coudées franches que les infiltrations armées à Cuba reprirent et que Posada Carriles et les siens purent préparer « en toute quiétude » en 1997 leur campagne de sabotages et de plasticages contre les hôtels de La Havane.
Je rappelle (et j’ai bien plus de mémoire qu’Hillary Clinton) que ce n’est pas Bush, mais Clinton qui a fait arrêter, juger et condamner les cinq Cubains infiltrés dans les groupes terroristes de Miami justement pour les empêcher – puisque la police étasunienne ne le faisait pas – de poser des bombes et de causer de nouvelles victimes.
Une arrestation d’autant plus ignominieuse que Clinton était parfaitement au courant de tout et qu’il a agi avec, dirai-je, un manque de noblesse étonnant. Mais qu’attendre d’un politicien du sérail étasunien ? Je reprends donc brièvement les faits.
Les Cinq avaient informé les autorités cubaines que des groupes de la mafia terroriste de Miami – dont Orlando Bosch, gracié par Bush père, l’auteur intellectuel avec Posada Carriles du sabotage en plein vol, le 6 octobre 1976, d’un avion de passagers cubain (le premier attentat de ce genre dans le monde occidental ; bilan : 73 morts) – avaient décidé de saboter les avions – étasuniens, donc – qui assuraient les rares vols avec La Havane. L’affaire était si grave et les menaces si sérieuses que, dans le droit fil d’une politique dont la Révolution cubaine ne s’est jamais départie : pas de morts d’innocents, Fidel décida d’en avertir les autorités étasuniennes au plus haut niveau : le président en personne. Il écrivit personnellement à Clinton pour le mettre au courant des faits et demanda à Gabriel García Márquez, qui devait justement se rendre à Washington pour être reçu à la Maison-Blanche, de tout faire pour remettre la lettre à son destinataire, sinon en mains propres, du moins aux meilleures mains possibles. García Márquez s’acquitta de sa mission le 6 mai 1998, remettant le message urgent de Fidel à l’un des proches conseillers de Clinton, lequel l’assura qu’il lui en parlerait. En fait, poussant l’élégance politique à un degré peu courant de nos jours, Fidel se ravisa et décida finalement, non d’écrire une lettre en bonne et due forme à Clinton mais de lui faire parvenir, pour ne pas le compromettre et le contraindre à une réponse, une sorte de mémorandum officieux.
Plus de 14 professeurs de droit et 18 avocats britanniques ; Federico Mayor Zaragoza, ancien directeur général de l’Unesco ; en Espagne : 6 organisations légales et des droits de l’homme, 6 professeurs de droit, 94 avocats ; en Belgique, l’Association des avocats flamands et celle des avocats francophones et germanophones ; en Allemagne, le barreau berlinois ; la Ligue des droits de l’homme et l’Association des avocats de la défense de Berlin ; et d’autres noms et organisations au Mexique, en Argentine, au Portugal, au Japon, au Chili (dont le juge Juan Guzmán Tapia , le premier magistrat à avoir instruit un procès contre Pinochet) ; en Équateur, en Colombie, au Panama. Bref, la liste est énorme et de poids. Et pourtant, les médias transnationaux, comme un seul homme, ont fait de nouveau le black-out, malgré l’intervention de gens du Premier Monde qui sont par définition, on le sait, toujours plus sérieux et plus crédibles que ceux du Tiers-monde…
Tiens, il y aurait là encore une bonne occasion pour Barack Obama de faire un petit geste peu coûteux : à défaut de gracier les Cinq, exercer des pressions pour que la Cour suprême accepte de réviser leur cas puisque cette noble institution ne le fait que dans 2 p. 100 des affaires qui lui sont soumises. Et qu’on ne vienne pas me parler de l’indépendance du pouvoir judiciaire, parce que personne ne croit à cette sornette après avoir vu comment l’administration Bush a contraint la cour d’appel d’Atlanta à réviser la décision de sa troïka puis à l’annuler purement et simplement… Il lui reste d’ailleurs peu de temps puisque la Cour suprême doit se prononcer en principe avant ses vacances de juin.
Je rappelle aussi que c’est encore sous le règne de Bill Clinton que s’est déroulé l’épisode du petit Elián González, un Cubain de cinq ans séquestré par une partie de sa famille à Miami après que sa mère fut décédée dans un naufrage au cours d’une traversée illégale à travers le détroit de la Floride. Une situation qui, en toutes autres circonstances, aurait été réglée dans les meilleurs délais par un gouvernement et sa justice – le père légitimer vivant à Cuba réclamant le retour de l’enfant que sa mère, alors divorcée, avait fait partir avec elle sans son consentement – mit sept mois (autant que le procès des Cinq), du 25 novembre 1999 (date du naufrage) au 28 juin 2000 (retour d’Elián à La Havane) à trouver un dénouement, tout simplement parce qu’il s’agissait de Cuba et que rien ne peut être fait en ce cas dans les règles ni la loi aux USA.
Là oui, la Cour suprême dut intervenir ! Et si cet enlèvement d’enfant s’éternisa ainsi, c’est que parce que l’Attorney General de Clinton, Janet Reno, craignait – et son administration avec elle – de se mettre à dos la mafia terroriste cubano-américaine de Miami, qui avait littéralement séquestré de force le gosse et en faisait un instrument de chantage pour obtenir la victoire sur leurs ennemis jurés, la Révolution cubaine et « Castro », et que les atermoiements des autorités politiques et juridiques, bref, de l’administration en soi, ne cessaient d’enhardir au point que Janet Reno dut finalement monter une véritable opération de police, armes au poing, pour arracher l’enfant à ses kidnappeurs. Et je suis convaincu que si le peuple cubain, conduit par la direction révolutionnaire, ne s’était pas mobilisé comme un seul homme d’un bout à l’autre de l’île (avec, entre autres, des marches de plus d??un million d’Havanais devant la Section des intérêts des États-Unis) et mené un campagne qui dura autant que le kidnapping d’Elián, celui-ci n’aurait jamais été rendu à son père, parce que dans le fond, Janet Reno et les autres étaient persuadés qu’il valait mieux pour lui vivre dans une famille éloignée dans le fameux « pays libre » que se croient les États-Unis, qu’auprès de son père en « régime communiste ». Elle a d’ailleurs fini par l’avouer.
Je n’ai évoqué ces deux événements (il en est d’autres, et je m’en tiens à la seule administration Clinton) que pour rappeler que Bush fils n’a été que l’un des onze présidents (Obama compris) à avoir mené peu ou prou la même politique face à la Révolution cubaine avec pour seul objectif : la liquider.
En fait, là où je veux en venir, c’est à cette conclusion : quand on dresse le bilan de cinquante ans de relations « à torchon brûlé » entre la Révolution cubaine et la superpuissance aux capacités incommensurablement supérieures aux siennes, qui n’a lésiné sur aucun moyen (dont l’assassinat pur et simple) pour en venir à bout, on se dit – outre le démenti que cette résistance incroyable apporte à ceux qui y voient le résultat de la volonté entêtée d’un sinistre dictateur, et non de celle de tout un peuple dont elle a changé la vie y qui y tient – qu’Obama est bien mal renseigné personnellement et aussi bien mal conseillé s’il croit s’en tirer à si bon compte (la pirouette de l??annulation des nouvelles restrictions que Bush avait superposées aux anciennes) vis-à-vis du peuple que ses prédécesseurs ont traité de la pire manière et dont le contentieux historique avec les USA remonte à plus de deux siècles ! Si la Révolution cubaine s’était laissée prendre, fût-ce un instant dans son histoire, au miroir aux alouettes que lui tendait son voisin, il y a belle lurette qu’on n’en parlerait plus qu’au passé.
A ce jour, Obama a agi comme ce que sont généralement, en fin de compte, les présidents étasuniens : des politiciens à raisonnements électoraux. Auraient-il beau être les maîtres de l’Empire dont le moindre éternuement a des répercussions sur toute la planète, ils fonctionnent la plupart du temps, non comme des gens qui seraient soi-disant investis d’un mission mondiale, mais selon ce qu’ils supposent que seront les actions et réactions de leurs électeurs. J’ai d’ailleurs été sidéré de retrouver précisément cette approche « électorale » dans la conférence de presse qu’Obama a donné à la fin du Sommet du G-20 à Londres ou de celui de l’OTAN à Prague (je ne me rappelle plus exactement) : à une question d’un journaliste sur je ne sais plus quel point, il répond en gros qu’il doit tenir compte de ses électeurs ! Que le président de la superpuissance qui vient d’obliger – sans trop de mal, apparemment – les plus importantes économies à donner de nouveau carte blanche aux USA pour réparer leurs propres dégâts et à leur reconduire tous les privilèges de Bretton Woods continue de penser à « ses » électeurs, et non aux intérêts du monde que les agissements des capitalistes néolibéraux et du système en soi ont entraîné au bord du gouffre en dit long, et mieux qu’une analyse fouillée, sur le manque d’envergure politique des « élèves du sérail » étasunien !
Je retrouve ces mêmes relents électoralistes dans le geste d’Obama juste avant le Sommet des Amériques : en bon politicien, il savait qu’il ne pouvait arriver les mains vides et il a fait comme font tous les politiciens : s’abriter derrière des promesses, tendre une sucette. Vis-à-vis de Cuba, la levée des sanctions bushiennes ; vis-à-vis de l’Amérique latine et des Caraïbes, un discours creux ; sur le fond, rien de nouveau (il suffit de lire la rhétorique éculée de la Déclaration finale, surtout quand on la compare avec celle du Sommet extraordinaire de l’ALBA…).
Là aussi, il pense s’en être tiré à bon compte, comme si les poignées de main et les sourires colgatés pouvaient balayer le contentieux historique ô combien sanglant de l’Empire envers son arrière-cour.
En fait, je me demande : Obama va-t-il continuer de « penser à ses électeurs », ou va-t-il enfin se décider à endosser une bonne fois pour toutes le costume dont il nous a dit pendant des mois de campagne assortie de toutes sortes de promesses qu’il ne se trouvait pas dans les vieilles penderies de la Maison-Blanche et qu’il allait se faire tailler sur mesure ?
Pour l’instant, en politique étrangère, par exemple, les choses n’ont guère changé, que ce soit en Iraq, en Afghanistan : la force prime le droit, les toges continuent de céder devant les armes ; Israël reste indéfectiblement l’allié et le protégé essentiels. Malgré la rhétorique du dialogue, la Maison-Blanche continue de menacer, de massacrer des civils au nom de la lutte mondiale contre le terrorisme (cf. la centaine de morts sous les bombes de ses avions en Afghanistan). Comme si Bush avait fait des disciples !
Par ailleurs, en bon politicien, Obama continue de dire tout et son contraire et de se dé-mentir : après avoir promis de punir les tortionnaires, il décide de ne plus le faire ; après avoir promis de montrer les photos de torturés, il vient d’y renoncer ; il continuera de juger par les mêmes procédures légales que Bush les « non-accusés » de Guantánamo…
Et il attend en plus des gestes de la Révolution cubaine ! Celle-ci ne s’est pas fait prier pour lui dire qu’en tant qu’agressée, elle n’avait absolument aucun geste à faire, que c’était au tortionnaire d’arrêter de sévir sur le torturé, et non au torturé d’arrêter de crier sous la douleur.
Il faudra donc qu’Obama marche tout seul à la rencontre du peuple que ses prédécesseurs n’ont cessé d’agresser s’il veut, comme il paraît le prétendre, rabibocher un tant soit peu les choses entre les deux pays.
Qu’il commence, par exemple – et c’est tout bête, tout simple, ça ne lui coûterait rien là non plus, à l’instar de la levée des restrictions bushiennes – par « changer » le chef de la Section des intérêts. Ça, oui, ce serait un bon « change », selon le mot que nous l’avons entendu ressasser tout au long de sa campagne. Car, comment peut-il prétendre mener une nouvelle politique envers la Révolution cubaine en conservant le même personnel, chef y compris, nommé par Bush pour mener la guerre contre Cuba à la tête de la représentation étasunienne à La Havane, convertie en huit ans, selon l’heureuse formule de Fidel, en « quartier général » ou « poste de commandement » de la contre-révolution dans l’île ? Mais Obama, pensant en termes électoraux, autrement dit soucieux de ratisser long dans le parti unique à deux volets qui règne aux États-Unis depuis au moins un siècle, et non en chef de gouvernement à retombées mondiales, n’en est pas à une contradiction près : n’a-t-il pas maintenu le secrétaire à la Guerre (secrétaire à la Défense est vraiment un euphémisme que j’ai du mal à avaler…) de Bush pour suivre une politique censément différente en Iraq et surtout en Afghanistan ?
Bref, le mal essentiel de l’Empire est, sauf rarissimes exceptions, de n’avoir pas pour le diriger d’hommes politiques à la hauteur de ses ambitions ni à celle des attentes du reste du monde ; par « reste du monde », j’entends, non les élites, mais les peuples et les petites gens broyés par des problèmes que justement les « élites des sérails » sont incapables de régler. Avoir des ambitions planétaires est une chose ; en être capable en est une autre. Pour l’instant, malgré le battage « non stop » que les médias transnationaux orchestrent en sa faveur, Obama n’a rien fait qui prouve qu’il soit en mesure de se colleter avec les gravissimes problèmes mondiaux que chacun connaît et dans lesquels son pays a une très grosse part de responsabilité.
Il serait toutefois injuste que je le lui reproche : après tout, il n’a pas été élu au poste qu’il occupe pour régler les problèmes vitaux du monde, mais pour défendre les intérêts de l’Empire. Et, l’Histoire le dit, ce sont là deux choix foncièrement incompatibles.
Juste deux petites réflexions avant de conclure. La première sur un fait tout récent : une procureure de Virginie – le gouvernement, donc – vient de retirer toutes ses accusations contre deux espions qui s’étaient emparés de documents du Pentagone entre avril 1999 et août 2004 et dont l’un, passé aux aveux, avait été condamné en 2006 à plus de douze ans de prison, mais se trouvait pourtant à ce jour en libération conditionnelle. Les accusations ont été retirées, parce que, selon cette procureure, « le gouvernement doutait de pouvoir remporter le cas ». Décidément, on délivre une drôle de justice aux États-Unis : une juge protège des terroristes avérés de l’action éventuelle d’un antiterroriste ; et maintenant, la justice n’accuse plus que si elle est sûre de gagner… Ah, j’allais oublier : les deux espions travaillaient pour… Israël. Comparez maintenant avec la situation des Cinq, qui ne faisaient pas d’espionnage et dont le procureur n’a rien pu prouver à ce sujet, mais qui défendaient leurs concitoyens d’actes terroristes : ils moisissent en prison depuis plus de dix ans. Ils travaillaient, eux, il est vrai, pour… Cuba, Sans commentaires.
Quand, le 19 mai 2005, j’ai dû traduire l’intervention dans laquelle Fidel révélait au monde, le lendemain, sur la place publique, ses tentatives pour alerter Clinton, j’ai pensé qu’elle allait avoir une grande répercussion médiatique à double titre du fait des documents déclassifiés hors normes qu’elle contenait : le « memo » de Fidel à Clinton et surtout le rapport de García Márquez. Fichtre, me suis-je dit, un inédit de Gabo, surtout dans un tel rôle, ça va faire du bruit, d’autant qu’il n’écrit plus tellement… Naïf que j’étais. Là encore, le rideau du silence des médias bien pensants s’est abattu. C’est sans doute – j’en mettrai ma main au feu – le texte de l’auteur de Cent ans de solitude qui a connu le moins de répercussion…
Un autre tout petit geste que pourrait faire Obama, à défaut de gracier les Cinq : ordonner à son département d’Etat de délivrer un visa d’entrée à Olga Salanueva (femme de René González) et à Adriana Pérez (femme de Gerardo Hernández) qui le réclament en vain depuis dix longues années durant lesquels les deux couples n’ont jamais pu se réunir !! N’allez pas croire que les tortures étasuniennes sont toutes dans le style d’Abou Ghraib ou de Guantánamo??? Le 2 avril dernier, ces deux femmes ont présenté à la Section des intérêts des Etats-Unis à La Havane une lettre adressée à Obama et les lettres envoyées à Hillary Clinton par 170 personnalités de 27 pays faisant partie du Comité international pour la liberté des Cinq, pour demander la délivrance de visas humanitaires. Aujourd’hui, 14 mai 2009, soit presque un mois et demi plus tard, aucun signe n’est venu de la Maison-Blanche ou de son département d’État.
Pour le moment, Barack Obama ne dépare pas la collection du « toutes tendances confondues »…