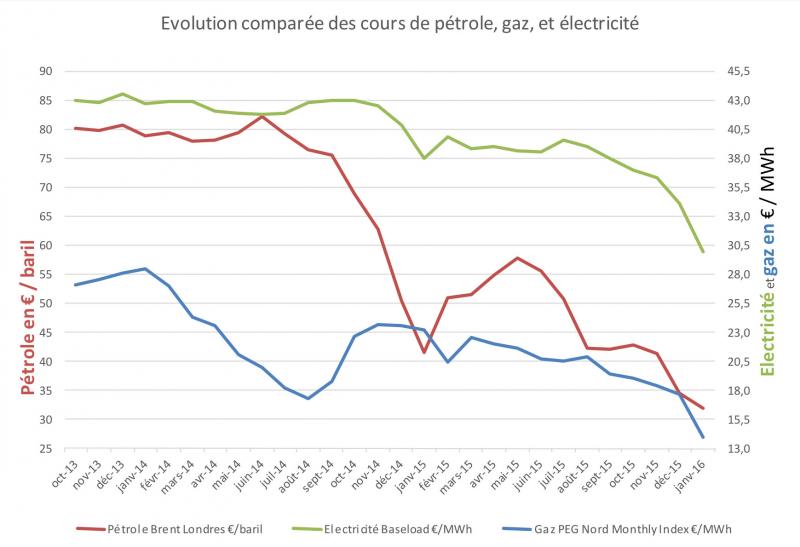Cinquante années de résistance et de fermeté populaires
Interview du président du Conseil d’Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, le général d’armée Raul Castro, réalisée par la journaliste Talia Gonzalez Pérez, des services d’information de la télévision cubaine, le 31 décembre 2008, «Année du 50e anniversaire de la Révolution»
(Traduction de la version sténographique du Conseil d’Etat)
Photos Geovani Fernandez et Raul Abreu.
Journaliste: Pendant les premiers jours du triomphe de la Révolution cubaine, le commandant en chef Fidel Castro Ruz signalait au peuple que même si la Révolution avait émergé victorieuse, il ne fallait pas s’imaginer que dorénavant tout serait plus facile ; au contraire, il était probable que les choses seraient désormais plus difficiles. Quelles ont été les difficultés rencontrées au fil de ces cinquante ans pour édifier une Révolution socialiste face aux agressions impérialistes et à un panorama international complexe ?
Raul Castro: Je me souviens très nettement de cette phrase du commandant en chef prononcée le 8 janvier 1959 à son arrivée dans la capitale, à l’ancienne caserne Columbia, principal bastion militaire de la dictature, parce que j’ai été fortement impressionné par sa vision de l’avenir, et je le suis maintenant encore plus, après cinquante ans, par la justesse de ses prévisions.
Il avait déclaré: «La tyrannie a été renversée. La liesse est immense. Ne nous leurrons pas en pensant que tout sera désormais plus facile. Il se peut que tout soit dorénavant plus difficile».
Et c’est ce qui s’est passé, depuis le début. Les premières mesures adoptées pour assurer la défense de la Révolution, la capture et le jugement des pires assassins et tortionnaires de la tyrannie inaugurèrent une ère de confrontation avec les médias et les éléments au service des forces dominantes du continent et de la planète. Ou du moins d’une partie de la planète, à l’époque.
Je me souviens de la campagne gigantesque qui fut orchestrée pendant les premiers mois du triomphe la Révolution. Peu de temps s’était écoulé, la Révolution était en marche. Le 17 mai, c’est-à-dire quatre mois et demi après le triomphe de la Révolution, fut adoptée la première Loi de Réforme agraire, au siège du commandement de La Plata, par Fidel, dans la Sierra Maestra où se tint le premier Conseil des ministres. Cette loi portait atteinte à de nombreux intérêts étasuniens, car ce sont eux qui détenaient les meilleures terres: ils s’en étaient appropriés à la faveur de l’occupation qui leur assurait des avantages, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle; dans certains cas ils avaient versé, pour obtenir des hectares des meilleures terres, une somme symbolique de 10 cents l’hectare. Et naturellement, leurs intérêts furent mis à mal lorsque Cuba décida de récupérer cette richesse fondamentale qu’est la terre.
Je pense que cette mesure a été comme le Rubicon de la Révolution cubaine. Le Rubicon est un fleuve qui séparait l’Italie de la province romaine de la Gaule cisalpine. Lorsque Jules César entreprit de le franchir malgré l’interdiction du Sénat romain, une phrase devint célèbre: «César a traversé le Rubicon». Autrement dit, il prit une décision irréversible. Et ce fut notre Rubicon à nous, lorsque ces intérêts US furent lésés et que se déclenchèrent, dans toute leur virulence, la lutte de classes et l’agressivité de l’impérialisme contre Cuba.
On peut dire que ce fut le premier pas important. D’autres vinrent ensuite.
Les agressions constantes, le coup qu’ils nous ont porté en refusant de raffiner le pétrole que nous achetions à meilleur marché à l’Union soviétique, nos mises en garde les exhortant à le raffiner puisque c’était leur obligation, leur refus obstiné et notre décision de nationaliser leurs raffineries, et ainsi de suite, donnèrent lieu à une série de coups et de contrecoups. A l’été 1960, une autre étape importante était franchie, car nous ne pouvions nous arrêter sans courir le risque de voir la Révolution renversée: la nationalisation de toutes ces grandes entreprises nord-américaines. Nous avons profité de la tenue à La Havane d’un Congrès de jeunes latino-américains et avons improvisé un meeting à l’ancien stade du Cerro, aujourd’hui rebaptisé Latinoamericano. Je me souviens que nous avons monté une petite estrade sur le terrain, sur le champ-centre, et devant les jeunes latino-américains et cubains, et le peuple en général, Fidel a proclamé la nationalisation de toutes ces entreprises.
La transition d’un système social à l’autre ne saurait se produire en un jour. C’est impossible. C’est un processus qui comporte de nombreuses étapes et qui s’achève par la remise de la majorité des biens de production aux mains de la population.
Dans le cas de Cuba, s’il y a un jour où cela s’est produit, c’est précisément ce jour-là, à cause du poids économique que représentait l’ensemble de tous ces biens, ces propriétés privées étasuniennes devenues propriétés de tout le peuple, c’est-à-dire du jeune Etat cubain.
C’est aussi l’époque, en 1960, où commencèrent à proliférer les bandes contre-révolutionnaires, qui se concentrèrent dans les montagnes de l’Escambray où elles nous donnèrent du fil à retordre, tout en tentant d’opérer dans plusieurs provinces, surtout dans les régions montagneuses.
Il ne faut pas oublier que le gouvernement du président des Etats-Unis, Dwight Eisenhower (1953-1961), avait à son actif l’invasion en 1954 du Guatemala –sept ans plus tôt-; du Guatemala progressiste du colonel Jacobo Arbenz, un homme honnête qui avait accédé à la présidence par la voie des urnes et qui, confronté à la misère de la grande masse d’Indiens et de paysans guatémaltèques, avait procédé à une petite réforme agraire –je dis petite si on la compare à la nôtre, en envergure et en profondeur-, ce qui fut suffisant pour que son projet révolutionnaire soit condamné à mort. Eisenhower, John Foster Dulles, son secrétaire d’Etat, et son frère Allan Dulles, qui était le chef de la CIA, en prirent la décision.
Ce fut une plus petite invasion que celle de Playa Giron, une invasion par terre, mais il n’y eut aucune résistance, le président Arbenz hésita, il ne remit pas les armes au peuple qui était résolu à lutter, d’après les manifestations que l’on observait. Nous avions pu suivre ces événements dans les journaux qui nous parvenaient au pénitencier de l’Île des Pins, où nous étions emprisonnés depuis un an après l’attaque de la caserne Moncada.
Dans les premières années du triomphe de la Révolution cubaine, ces personnages constituaient la troïka qui décidait de la politique des Etats-Unis (Eisenhower et les frères Foster et Allan Dulles), même s’ils partageaient leurs informations avec la future administration qui venait d’être élue, celle de John F. Kennedy (1961-1963).
Ainsi, en 1960, ils planifient cette opération et en accélèrent les préparatifs car ils savaient que nous formions des pilotes d’avions Mig dans les pays socialistes, et ils voulaient la déclencher au plus vite, surtout quand ils ont appris que nous faisions l’acquisition d’armes pour assurer la défense de la Révolution.
Cependant, le mandat d’Eisenhower, du Parti républicain, s’achève et le 20 janvier 1961 le démocrate John F. Kennedy prend les rênes du pays.
Avant de continuer, j’aimerais signaler qu’il ne faut pas oublier que Foster Dulles –le secrétaire d’Etat d’Eisenhower- était avocat de la United Fruit Company, qui encouragea et appuya dans une large mesure l’intervention au Guatemala. Ils détenaient de grandes bananeraies et d’autres propriétés dans ce pays comme dans d’autres républiques d’Amérique centrale. La United Fruit Company était la même qui opérait à Cuba sous le nom de United Sugar Company. Là-bas c’était la banane, ici le sucre. Ils avaient tiré profit de l’aventure de 1954 contre le Guatemala, si bien qu’ils tentèrent de faire la même chose chez nous, avec un peu plus de forces, davantage d’avions, davantage de bateaux, car nous sommes une île et les troupes d’invasion devaient être acheminées en bateau. Mais ce furent les mêmes qui organisèrent l’agression de Playa Giron, au nom des mêmes intérêts, bien avant qu’on ne parle de socialisme à Cuba.
Le 2 janvier 1961, sous le prétexte du discours prononcé par Fidel le 1er Janvier sur la Place de la Révolution, ils décident de rompre leurs relations diplomatiques avec Cuba. C’était un prétexte, l’invasion ayant déjà été planifiée. L’agression contre notre pays avait été décidée avant la proclamation du caractère socialiste de la Révolution cubaine qui, comme chacun sait, eut lieu le 16 avril 1961, ce qui prouve qu’ils avaient créé les conditions pour rompre les relations diplomatiques et nous agresser.
Deux mois et demi après avoir accédé à la présidence, Kennedy lance l’invasion de Playa Giron qui commence par les bombardements du 15 avril.
Voici l’une des raisons –et elles sont nombreuses- pour lesquelles j’affirme qu’aux Etats-Unis il n’y a qu’un seul parti. A cette occasion, l’invasion avait été planifiée par les républicains, et ce sont les démocrates qui l’ont exécutée. C’est comme si à Cuba il y avait deux partis: l’un dirigé par Fidel et l’autre par Raul; c’est la même chose à quelques nuances près.
Il faut dire que pour cette opération de Playa Giron, un jeune officier de la CIA qui promettait s’est chargé de recruter la plupart des mercenaires enrôlés notamment en Floride et envoyés par la suite en Amérique centrale pour y suivre un entraînement avant de se lancer sur Cuba. Ce jeune officier qui fut ensuite chef de la CIA et plus tard président des Etats-Unis, n’est autre que George H. Bush (1989-1993), le père de l’actuel président George W. Bush (2001-2009). Voyez comme c’est tout le même pouvoir, une même élite qui alterne au pouvoir, au gré des circonstances.
Au moment de l’invasion de Playa Giron, nous menions notre campagne d’alphabétisation dans l’ensemble du pays. Nous avions déjà porté un rude coup aux bandes contre-révolutionnaires avec la mobilisation de dizaines de milliers d’ouvriers, de La Havane notamment, chargés de ce que nous avions appelé le «Nettoyage de l’Escambray». Dans un premier temps, les mercenaires avaient pensé débarquer par Trinidad, et si l’opération échouait ils se trouveraient tout près du massif de l’Escambray, dont le vrai nom est Guamuhaya.
Comme ils avaient reçu ces coups en 1960, ils ont étudié la variante de Playa Giron, qui n’était pas mauvaise car cette région qui abrite la plus importante zone marécageuse de la Caraïbe –je veux dire de la Caraïbe insulaire- est d’un accès difficile, avec pour principale voie d’accès une route qui traverse les marais. C’est au lieudit Palpite, en plein milieu des marais mais là où la terre est un peu plus ferme, qu’ils ont lancé leurs parachutistes, et ils nous a fallu déclencher l’offensive en file indienne: chars, artillerie, infanterie… il était impossible aux troupes de se replier et c’est une des raisons pour lesquelles nous avons essuyé plus de pertes que les agresseurs.
La mise en garde de Fidel et l’ordre de liquider l’invasion en 72 heures sont connus. Il fallait la liquider en 72 heures, car Fidel avait prévu avec une grande lucidité qu’une fois que l’ennemi aurait consolidé sa tête de pont, il aurait fait venir le gouvernement fantoche présidé par Miro Cardona qui attendait dans une base militaire US de la Floride.
Le gouvernement fantoche s’installerait sur la terre ferme et serait reconnu par les Etats-Unis et par l’OEA, à laquelle il demanderait une aide d’urgence; les bâtiments de guerre US se trouvaient déjà au large des côtes cubaines, tout devenait plus facile et il fallait logiquement s’attendre à un débarquement de troupes afin de prêter main-forte aux mercenaires. C’est pourquoi cette invasion a lieu en 1961.
Faisons maintenant un saut opérationnel, comme on dit dans le jargon militaire: en janvier 1962, sous le diktat du gouvernement des Etats-Unis, nous avons été expulsés de l’OEA et tous les pays latino-américains, à l’honorable exception du Mexique, ont rompu leurs relations diplomatiques avec Cuba. Le pays qui avait fait l’objet d’une agression quelques mois auparavant à Playa Giron était maintenant expulsé de l’OEA sur l’injonction des Etats-Unis auprès de son ministère des colonies, comme l’appelait notre ministre des Relations extérieures, Raul Roa.
Pourquoi? Parce que, vaincus à Playa Giron, les Kennedy, l’administration US et le système ne pouvaient tolérer un tel affront, une telle humiliation, une telle défaite imposée à leur puissance par un tout petit pays, et cette expulsion de l’OEA avait pour but de créer les conditions. Tout comme ils avaient rompu leurs relations avec Cuba au mois de janvier pour avoir les mains libres et nous attaquer en avril à Giron, les yankees font en sorte que l’OEA nous expulse en janvier, notre système étant soi-disant incompatible avec leur «système démocratique». L’objectif était l’invasion directe, probablement en cette même année 1962, et elle n’a pu être évitée que grâce à la présence des missiles nucléaires soviétiques à Cuba; autrement, nous aurions été envahis. Certains avaient des doutes, mais les doutes se sont dissipés quelques années plus tard. Comme l’ont prouvé des documents secrets déclassifiés, il est évident qu’ils préparaient l’agression.
Je fais allusion aux aspects les plus visibles, les plus connus et les plus importants de ces années. Ce furent cinq ou six années très dures. Le blocus était entré en vigueur, mais il y avait l’Union soviétique, sous la direction du Parti communiste soviétique et de Khrouchtchev, qui eurent une attitude très positive et jouèrent un rôle très important dans la préservation et la résistance de la Révolution. Notamment en nous dotant d’une bonne quantité d’armements en tout genre, jusqu’à ce que nous ayons acquis la force qui est la nôtre aujourd’hui, du point de vue militaire.
Autrement dit, il y a Giron, il y a l’accord entre deux présidents, l’un assassiné et l’autre limogé, un accord verbal sur le retrait des missiles accompagné de l’engagement de ne pas agresser Cuba. C’est alors qu’a lieu l’Opération Mangouste, dirigée par le frère du président, ou placée sous le contrôle ou la supervision de Robert Kennedy, procureur du gouvernement des Etats-Unis, qui participa aussi aux contacts établis avec la mafia étasunienne en vue de projets d’attentats -connus et rendus publics-, parmi tant d’autres, contre Fidel.
Ce furent cinq années d’une lutte interne constante, avec des morts et de blessés par milliers, victimes du terrorisme d’Etat organisé et dirigé par les Etats-Unis.
Ils ont alors créé à Miami un centre de la CIA, le plus grand après ses bureaux de Langley. Des centaines d’officiers de la CIA ont été chargés de diriger des actions contre Cuba, d’abord Playa Giron et ensuite l’Opération Mangouste. Ce centre de la CIA ne céda en importance qu’à celui qui allait être créé des années plus tard dans l’ancienne Saïgon, aujourd’hui Ho-Chi-Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, pendant l’agression lancée contre ce pays. La CIA avait un centre très important là-bas, et c’est le seul à dépasser en importance celui qu’ils avaient installé à Miami pour lutter contre nous.
Comme chacun sait, à un moment donné il y a eu à Cuba 179 bandes contre-révolutionnaires armées, plus ou moins importantes, disséminées dans tout le pays. Parfois elles s’unissaient pour frapper et se fragmentaient à nouveau. A deux reprises elles ont opéré dans les six provinces que comptait le pays avant l’actuelle division politique et administrative, y compris dans le sud de La Havane, qui constituait alors une seule province.
Et au bout de six années, c’était vers 1965 ou en janvier 1966, nous avons liquidé la dernière bande de cette étape. Plus tard il y en a eu d’autres, à différentes périodes, qui étaient rapidement neutralisées. La Révolution s’est graduellement renforcée, il y avait les milices paysannes, les compagnies de montagnards.
Comme je le disais tout à l’heure, ce n’est que dans les montagnes de l’Escambray que ces bandes se dotèrent d’une certaine force. L’Oriente, l’est du pays, était un endroit très dangereux, c’était la province la plus grande –aujourd’hui cette région compte cinq provinces-, où se trouvait la base navale de Guantanamo. Et dans les années 60, Fidel me dit lorsque les choses commencent à se compliquer: «Ecoute, va dans l’Oriente et je me charge du ministère des Forces armées avec le chef de l’Etat-major» –c’était Sergio del Valle, aujourd’hui décédé-, «Va sur place. A toi d’organiser l’armée orientale, car si nous parvenons à sauver l’Oriente, nous aurons sauvé la Révolution». Telle est la confiance qu’il avait dans la force de l’Oriente, dans l’importance de l’Oriente, et dans les gens de cette région; cette confiance que nous avons toujours eue dans leur tradition de lutte. C’est ainsi que j’ai passé un an et demi là-bas et que j’ai créé l’Armée orientale. Je venais régulièrement à La Havane pour participer aux réunions les plus importantes. Et c’est aussi à partir de là que Fidel dépêcha par la suite le Che dans la province de Pinar del Rio, Almeida dans le centre du pays et moi, encore et encore, dans l’Oriente, chaque fois qu’il y avait une crise d’envergure: la Crise d’octobre, Playa Giron… Mais dans ce cas précis j’ai passé un an et demi dans l’Oriente.
Ceci sans compter le blocus, les sabotages en permanence… J’ai raconté qu’à certains moments, lorsque j’arrivais au siège du ministère des Forces armées, j’étais littéralement assailli par quatre ou cinq adjoints, mes agents de liaison avec plusieurs territoires, armées et régions du pays, et pour aller plus vite ils ne me présentaient pas de rapport. Ils venaient avec une liste des événements survenus dans les 24 dernières heures, ou du moins dans les 12 dernières heures: des dizaines de séchoirs à tabac incendiés à Pinar del Rio, tant de dizaines de cannaies en flammes dans tout le pays, selon la saison, tant d’attentats à la bombe dans des villes ou ailleurs, tant de sabotages contre le réseau électrique… Parfois je leur disais: «Donnez-moi la nouvelle la plus importante!» Voilà plus ou moins comment cela s’est passé pendant ces cinq ou six ans.
Ce fut une époque chargée d’activité et de beaucoup d’agressivité de la part de l’ennemi. Avec plus ou moins d’intensité, c’est aussi ce que nous avons vécu pendant ces cinquante ans. Les dommages ont été grands, mais les avantages l’ont été également.
Journaliste: A partir de ce survol historique, comment pourriez-vous caractériser la participation du peuple cubain à ce combat pour repousser toutes ces agressions pendant ces cinquante ans?
Raul Castro: Je te dirais que ces cinquante dernières années furent des années de résistance, des années de lutte pour la survie, des années où le peuple a démontré sa fermeté, où l’immense majorité de la population est demeurée ferme.
Puis, survint un coup extrêmement dur, celui de la dissolution du camp socialiste, en particulier de l’Union soviétique, avec laquelle s’effectuaient 85% de nos échanges commerciaux. Le PIB, qui représente la valeur de toute la production d’un pays, a chuté de 33%; le transport a commencé à péricliter, et tout le reste avec. Heureusement, nous avions dans nos entrepôts suffisamment de pièces de rechange. C’est alors que débuta une nouvelle période pour notre Révolution, une période spéciale : il s’agit d’un terme que nous, militaires, utilisons lorsqu’il s’agit de dresser des plans dans l’éventualité du déclenchement d’une guerre; l’économie entre alors en « période spéciale ». Dix ans après le début de cette période spéciale, Fidel soutenait que c’était la plus glorieuse de ces cinquante années de Révolution. Pourquoi? Parce que notre pays a su résister.
Nous ne pouvons pas oublier les actions terroristes et les crimes comme celui commis contre l’avion cubain de la Barbade. Nous ne pouvons pas oublier nos adolescents partis alphabétiser la population dans les montagnes de notre pays et qui furent assassinés par des bandes criminelles, dans les premières années de notre Révolution. Nous ne pouvons pas oublier toutes les personnes qui ont été victimes d’actes criminels au cours de ces cinquante dernières années, ces 3 478 morts et ces 2 099 personnes handicapées à vie.
Nous ne pouvons pas non plus oublier ces 101 enfants morts des suites de la dengue hémorragique. Selon les organisations internationales de santé, une telle épidémie n’a pu être déclenchée de façon naturelle à Cuba. En l’espace de quelques heures seulement, il a fallu hospitaliser 344 203 personnes. Quelque 11 400 nouveaux cas de dengue furent signalés en un seul jour, le 6 juillet 1981: un véritable record!
Ces sont des faits qui me reviennent ainsi à l’esprit, comme un film qu’on repasse rapidement dans sa tête, surtout en une journée comme aujourd’hui où, il y a cinquante ans, l’armée de Batista, retranchée dans les casernes militaires de Santiago, se rendait à Fidel; voilà les moments que nous vivions il y a cinquante ans. Je me rappelle ce Premier janvier où nous avons assisté à l’effondrement de cette armée mise sur pied par les Nord-américains lorsqu’ils ont dissout l’armée indépendantiste, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Je me rappelle cette Garde rurale qu’ils nous ont laissée en héritage, cette armée qu’ils ont eux-mêmes instruite et que l’Armée rebelle a vaincue.
Qu’est-ce que l’Armée rebelle? Ni plus ni moins que l’armée indépendantiste. Elle a repris les armes de l’armée indépendantiste, que l’impérialisme avait désarmée, cet impérialisme qui en était à ses premiers balbutiements, qui commençait à prendre des forces. Lénine avait reconnu dans cette guerre hispano-cubano-nord-américaine la première guerre impérialiste. Déjà, dans le dernier quart du 19e siècle, au cours d’une réunion à Berlin, les grandes puissances s’étaient partagé le monde. Pour obtenir de nouvelles terres, il fallait les prendre aux autres puissances coloniales. Ce fut le prétexte dont ils usèrent pour garder Cuba, Porto Rico et les Philippines. Comme Cuba s’était battue farouchement pendant presque 30 ans, avec ses hauts et ses bas, on lui permit d’avoir son propre hymne national, son drapeau, ses écussons et une Constitution, dans laquelle fut inséré un amendement, l’Amendement Platt, du nom du sénateur qui le proposa.
Cet amendement autorisait les Etats-Unis à intervenir à Cuba lorsqu’ils le jugeraient nécessaire, et ils ne se gênèrent pas pour le faire plus d’une fois.
L’Amendement Platt demeura en vigueur jusqu’à la chute de la dictature de Machado, dans les années 1930, et rien ne changea après. En réalité, car l’histoire nous réserve parfois des surprises, le premier soldat américain entra à La Havane le premier janvier 1899. Cette guerre s’était déroulée dans la région orientale du pays et c’est la raison pour laquelle les Nord-américains font leur entrée à La Havane, une fois que les troupes espagnoles se sont rendues, le premier janvier 1899. Ironie du destin: les premières colonnes de la guérilla envoyées par Fidel, celles du Che et de Camilo, entrèrent elles aussi à La Havane un premier janvier, mais en 1959.
Ce rappel historique montre que la domination totale des Etats-Unis sur Cuba dura exactement soixante ans. Bien évidemment, des capitaux nord-américains avaient déjà pénétré dans notre pays bien avant ces événements, mais ce que je veux dire, c’est que la domination absolue de l’impérialisme nord-américain sur Cuba dura exactement soixante ans, d’un premier janvier à un autre.
Ces soixante ans de domination connurent des hauts et des bas, ils ont laissé une grande blessure dans notre pays, une grande confusion, une grande douleur. Mais cela n’empêchera pas les mouvements populaires de renaître des cendres encore chaudes des combats précédents. En 1925, le premier parti communiste est fondé par Mella et Baliño, un jeune homme brillant, un vieux compagnon de Marti qui avait lutté pour l’indépendance. L’impérialisme, qui tenait les rênes du pays, instaura la dictature de Machado et fit échouer la révolution qui tentait de la renverser. C’est alors que surgit Batista, un sergent de l’Etat-major très aux faits des jeux de coulisses. Avec un groupe de sergents de l’armée, il organise un coup d’Etat. Quelques jours plus, le voilà promu colonel. De 1933 aux élections de 1940, il sera au pouvoir et deviendra le nouvel instrument de l’impérialisme. Élu président en 1940, il gouvernera le pays jusqu’en 1944, avant de se retirer à l’étranger. Jusqu’en 1952, le pays sera gouverné par Grau San Martin et Prio Socarras, des gouvernements corrompus qui s’autoproclamaient « authentiques ». C’est le 10 mars 1952 que Batista revient à l’avant-plan de la scène politique, sous le parrainage, comme toujours, du gouvernement nord-américain. Cette fois-ci, la dictature allait durer sept ans.
A cette époque, l’Amérique latine était la proie de dictateurs du même acabit que Batista. C’était la bonne vieille méthode utilisée par les Etats-Unis pour asseoir leur pouvoir absolu sur ce continent. Cette situation prévalait également dans les Caraïbes, sauf pour les Caraïbes anglaises qui étaient toujours des colonies de la Grande-Bretagne. Ainsi en République dominicaine et en Haïti, cette île appelée l’Hispaniola, la seconde en importance par sa taille dans les Grandes Antilles, les dictatures de service étaient rien moins que celles de Trujillo et de Duvalier. Telle était la situation à travers le continent.
C’est dans ce contexte que se produisit l’attaque de la Moncada, un fait d’armes que notre peuple connaît parfaitement. À Cuba, la dictature dura environ sept ans, du 10 mars 1952 au premier janvier 1959. Cinq ans, cinq mois, cinq jours après l’attaque de la Moncada, la Révolution triomphait. Encore une coïncidence que ces trois chiffres cinq.
Journaliste: Les principaux leaders du processus révolutionnaire cubain sont encore là pour apprécier, cinquante ans plus tard, le triomphe des idées pour lesquelles ils ont lutté et continuent de lutter. Il s’agit d’un fait inédit dans l’histoire de l’humanité. Sur le plan personnel, quels sentiments éprouvez-vous aujourd’hui ?
Raul Castro: Tant de choses, d’événements se sont produits, au cours des 55 dernières années, tant de sentiments, tant d’expériences diverses aussi, depuis la Moncada. Nous avons pu vivre cette époque, la plus glorieuse de notre histoire, une époque de fortes tensions. Aujourd’hui, on nous respecte partout dans le monde.
Le peuple de Cuba se sent fier, sûr de lui, il est fier de sa Révolution; il a un sentiment d’appartenance envers sa Révolution.
Journaliste: Vous avez parlé à maintes reprises du blocus économique des Etats-Unis contre Cuba, qui a coûté au gouvernement et au peuple des années de résistance. Vous avez aussi abordé le contexte international fort complexe, marqué par les guerres, la désunion et les catastrophes naturelles. Cinquante ans après le triomphe de la Révolution, quelles stratégies pensez-vous mettre en œuvre, au plan interne, pour continuer de défendre la Révolution socialiste ?
Raul Castro: Avant tout, il faut apprendre à ne compter que sur nos propres moyens. Fidel l’a dit il y a un certain temps déjà, depuis la dissolution du camp socialiste, depuis que nous nous sommes retrouvés seuls. Nous ne pouvons compter que sur notre propre travail. Fidel a expliqué ce concept de façon merveilleuse lors du rassemblement du Premier Mai 2000, sur la Place de la Révolution, à La Havane.
Il est vital de développer notre capacité de production, d’augmenter nos exportations, de produire tous les aliments que ce pays peut produire et d’économiser au maximum. Personne, aucun gouvernement ne peut dépenser plus qu’il ne produit. Sinon, nous risquons de laisser en héritage à nos enfants et à nos petits-enfants une dette immense. Rien de moins éthique. Nous n’en avons pas le droit.
Nous avons réussi à résoudre de nombreux problèmes. Mais notre propre croissance nous en pose de nouveaux.
Le taux de natalité est très bas. Vers la fin de 2008, nous avons connu une légère hausse, avec 10 000 naissances de plus que l’année précédente, mais c’est encore bien peu.
L’espérance de vie a augmenté. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes ont atteint le troisième âge. Tout comme il faut ouvrir des jardins d’enfants pour les petits – comme vous le savez, nous en manquons, plusieurs ont dû fermer leurs portes, d’autres fonctionnent plus ou moins -, il faut aussi nous occuper des personnes qui ont atteint un certain âge, prévoir des maisons spécialisées où ces personnes peuvent passer une partie de la journée et retourner auprès de leurs familles le soir. Mais dans bien des cas, cela n’est pas possible en raison de leur âge avancé. Ces personnes doivent rester auprès de leurs familles mais celles-ci ne peuvent plus s’en occuper lorsqu’ils arrivent à un âge trop avancé. Alors, il faudra construire davantage des maisons pour personnes âgées.
L’espérance de vie représente un immense progrès. Lorsque nous avons attaqué la caserne de La Moncada, elle tournait autour de 59 ans, alors qu’aujourd’hui, elle est de 77,97 ans. Le taux de mortalité infantile a aussi diminué.
Nous avons faits de nombreux progrès mais ceux-ci posent à leur tour de nouveaux problèmes auxquels nous devons faire face.
Nous n’avons jamais connu la paix, nous n’avons jamais connu la tranquillité. Nos ennemis disent que le socialisme est un échec. Pourquoi ne nous laissent-ils pas en paix pour que nous puissions les concurrencer sur un pied d’égalité ? Pour nous, le socialisme n’est pas un échec, même dans des conditions aussi difficiles. Mais cela a représenté un combat de tous les instants.
Nous avons dû consacrer des sommes colossales à la défense de notre pays. Comme nous l’avons déjà dit en d’autres occasions, pour nous, éviter la guerre équivaut à la gagner. Mais nous avons aussi précisé que pour l’éviter, cette guerre, pour la gagner, il faut nous dépenser sans compter et investir les sommes nécessaires dans la construction de milliers de kilomètres de tunnels. Mis à part nos navires de guerre, toutes nos unités de défense sont sous terre. Cela nous coûte énormément mais notre sécurité est à ce prix.
Ils auront beau nous bombarder, ils auront beau nous assiéger, le problème est qu’ici, pour faire quelque chose il faut débarquer, et c’est là que nous serons sur un pied d’égalité, soldat contre soldat, et cela change tout.
Je ne voudrais pas voir, même en laboratoire, ce que serait une agression des Etats-Unis contre Cuba, car le prix que devrait payer notre peuple serait très lourd, très élevé. Marti l’a dit: la liberté coûte très cher et il faut se résigner à vivre sans elle ou être disposé à payer le prix nécessaire. Et on sait bien que nous avons fait: pendant plus d’un siècle nous avons été prêts à payer le prix nécessaire, et nous l’avons payé.
Mais nous devons faire des économies, nous devons éliminer des gratuités. Si nous voulons équilibrer les salaires pour qu’ils jouent le rôle qu’il leur revient, il faut, progressivement, ou simultanément, éliminer petit à petit les gratuités injustifiées, qui ont surgi ici ou là, et les subsides excessifs. L’Etat a toujours besoin d’accorder des subsides pour rétablir un certain équilibre en aidant ceux dont le revenu est le plus faible; pour une raison ou une autre, certaines subventions doivent se maintenir, mais il ne faut pas en abuser. Personne n’est conscient de ce qu’il perçoit au titre de subsides ou de gratuités, on n’a en tête que son salaire mensuel, et ce compte-là n’est pas bon. Nous devons apprendre que deux et deux font quatre, pas cinq; parfois, dans le socialisme, deux et deux font peut-être trois. Ce sont des questions fondamentales.
Nous devons savoir que nous avons vécu et que nous devons continuer de vivre dans une situation tendue et difficile; nous vivons dans un monde ébranlé par une crise économique et financière dont on connaît le début, mais dont nous ignorons comment et quand elle va se terminer; on sait seulement qu’elle est pire et beaucoup plus grave que celle d’il y a 80 ans, dans les années 20 du siècle dernier; elle touchera tout le monde, et bien sûr, les pays les plus pauvres, tout comme les citoyens les plus pauvres des pays riches. Peut-être serons-nous, sous certains aspects, moins touchés que d’autres. Nous avons un peuple entraîné, plus de 70% de la population est née sous l’emprise du blocus; s’il existe un pays qui est entraîné pour résister à des situations de ce type, c’est bien nous et le fait que nous ayons survécu en est la preuve.
Nous devons restituer au travail sa vraie valeur, et nous aurons beau nous égosiller à pêcher le travail, nous ne nous en sortirons pas tant que nous n’aurons pas pris des mesures pour que les gens éprouvent le besoin vital de travailler pour satisfaire leurs besoins, mais je vous le dis: nous nous en sortirons.
Nous ne pourrons peut-être pas résoudre tous les problèmes aussi rapidement que nous le voulons. Il faut travailler, il faut mettre en pratique ces idées de travail, de production et d’économies. C’est la situation actuelle que le veut, je crois qu’on le comprendra. Ce sont des vérités; aussi dures qu’elles soient, nous ne pouvons pas les édulcorer, nous devons les dire.
De grandes tâches nous attendent pour 2009: continuer la distribution en usufruit des terres; nous avons déjà avancé, nous avons déjà franchi les premiers obstacles que nous avons rencontrés à cause de la sempiternelle bureaucratie. Nous sortons, au moins en partie, des dégâts causés dans la production agricole par les trois terribles ouragans qui nous ont frappés.
Ces ouragans nous ont coûté un peu plus de 9 milliards 700 millions de dollars –il est impossible de connaître le chiffre exact des dommages occasionnés–, soit environ 20% du Produit intérieur brut du pays. On a utilisé les réserves disponibles pour nourrir la population, personne ne se plaint sur ce point. Nous ne pourrons pas dans un bref délai résoudre le problème des logements détruits cette année, auxquels s’ajoutent ceux que les ouragans précédents de 2002, de 2005 avaient aussi détruits; cette situation perdurera tant qu’on aura pas construit des petites maisons qui puissent résister aux ouragans de plus en plus fréquents et de plus en plus violents.
Nous avons décidé qu’en de nombreux points de la côte, surtout de la côte sud, où les cyclones et les inondations côtières, continuels et répétitifs, détruisent les maisons, de reconstruire à l’intérieur des terres. Les gens veulent que leur maison soit reconstruite au même endroit, un autre ouragan survient et on se retrouve au même point qu’aujourd’hui. A Cuba, on peut construire une maison avec n’importe quel matériau, compte tenu du climat, mais pas si l’on veut qu’elle résiste aux ouragans, qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents à cause du changement climatique et de l’irrationalité humaine, un problème encore non résolu.
Nous sommes pleins d’optimisme, nous avons toujours été optimistes même dans les pires moments, c’est une chose que nous avons apprise de Fidel, lorsque – il y a eu cinquante ans le 18 décembre dernier-, avec ses deux fusils ajoutés aux cinq que j’avais, il m’a posé cette fameuse question: «Combien de fusils as-tu ?» «Cinq». «Et les deux que j’ai, sept. Nous avons gagné la guerre!». Il a toujours été pareil, il puisait des forces là où il n’y avait aucune perspective d’aucune sorte, ni pour survivre, ni pour continuer d’avancer. C’était toujours pareil.
Ces cinquante années ont été héroïques. Ceux qui ont eu le privilège de les vivre consciemment et de participer activement à tous ces grands événements, avec notre peuple, doivent se sentir fiers de tout ce qu’ils ont vécu, de cette gloire que nous ne pouvons pas laisser flétrir, que nous ne pouvons pas laisser tomber, à laquelle nous devons rester fidèles, car l’impérialisme est toujours là.
Journaliste: A partir des récents résultats des élections présidentielles aux Etats-Unis, certains analystes de la presse internationale estiment qu’il existe des perspectives de changement avec l’arrivée au pouvoir à la Maison Blanche de Barack Obama. Qu’en pensez-vous ?
Raul Castro: Il y a aujourd’hui un nouveau président qui a suscité des espoirs dans beaucoup de pays du monde; je pense que ces espoirs sont excessifs, car même s’il est un homme honnête, et je crois qu’il l’est, un homme sincère, et je crois qu’il l’est aussi, un homme ne peut pas changer les destinées d’un pays, et encore moins – je pense à un homme seul – des Etats-Unis. Il pourra faire beaucoup, il pourra mettre en œuvre des démarches positives, il pourra faire avancer des idées plus justes, il pourra freiner cette tendance, presque ininterrompue depuis la naissance des Etats-Unis, qui fait que tous les présidents ont eu leur guerre, ou plusieurs guerres. Il a dit qu’il allait se retirer d’Irak, bonne nouvelle. Il dit qu’il va doubler les forces en Afghanistan, mauvaise nouvelle. La guerre n’est pas une solution pour résoudre les problèmes du monde.
Je pense qu’il n’existe pas de solution pour l’Afghanistan, sauf une: laisser les Afghans tranquilles. Seul Alexandre le Grand est entré et sorti indemne de ce pays, peut-être parce qu’il s’était marié avec une princesse afghane, mais surtout, parce que qu’il en est parti rapidement. Au 19e siècle les Anglais ont essuyé un grave revers; au 20e siècle les soviétiques ont subi le leur, nous en avons été les témoins, et au 21e siècle les Nord-américains et ceux qui les soutiennent en Afghanistan subiront le même désastre. Ce sont des faits, et cela est négatif.
Les ressources gigantesques qui sont destinées aux questions militaires, aux guerres, depuis la guerre du Vietnam… Pourquoi la guerre du Vietnam? Pourquoi l’agression? Pourquoi près de 60 000 morts nord-américains? Je ne connais pas le nombre énorme – il doit être deux fois ou trois fois plus élevé – d’invalides, de blessés, de mutilés. Pourquoi quatre millions de Vietnamiens tués, des deux côtés ? Pour quels objectifs? Qu’ont-ils obtenu? Pourquoi le blocus contre Cuba depuis cinquante ans, qu’en ont-ils tiré? Ils nous ont renforcés, ils nous ont rendus plus fiers, nous sommes plus forts et nous avons encore davantage confiance dans notre résistance.
J’espère me tromper. Souhaitons à monsieur Obama de réussir; en ce qui nous concerne nous souhaitons qu’il réussisse, mais en menant une politique juste et qui aide à résoudre, grâce au pouvoir que détient son pays, les graves problèmes du monde.
Notre politique est bien définie: le jour où il voudra discuter, nous discuterons, sur un pied d’égalité, comme je l’ai déjà dit, sans la moindre entorse à notre souveraineté et d’égal à égal. Comme d’habitude –car c’en était bien une, on venait à tout moment nous demander de faire un geste–, un ancien président m’a écrit une lettre où il disait que les élections présidentielles allaient apporter des changements et qu’il serait bon que Cuba fasse des gestes. Je lui ai alors répondu avec la même amabilité qui se dégageait de sa lettre que l’époque des gestes unilatéraux était révolue: maintenant, ce sera un geste pour un geste. Et nous sommes prêts à le faire quand ils le décideront, sans intermédiaires, directement. Mais nous ne somme pas pressés, nous ne sommes pas désespérés. Fidel et moi le disons depuis des années: nous ne discuterons pas sous la politique de la carotte et du bâton, ça c’est du passé, c’était une autre époque.
C’est notre position, nous attendrons patiemment. Aussi incroyable que cela puisse paraître, compte tenu du tempérament des Cubains, nous avons appris l’art de la patience; c’est une qualité que nous avons, et nous l’avons démontré, du moins dans ce domaine.
Journaliste: Pendant ces cinquante ans les Etats-Unis ont fait l’impossible pour isoler Cuba du monde. Notre pays a rompu récemment cet isolement des mécanismes régionaux d’intégration avec l’entrée dans le Groupe de Rio. Que représente cet événement pour Cuba ?
Raul Castro: J’ai vécu un moment émouvant dans l’Etat de Bahia, au Brésil, où se sont tenus trois des Sommets auxquels j’ai participé, en présence de la quasi totalité des chefs d’Etat d’Amérique latine et des Caraïbes qui, pour la première fois dans l’histoire, se sont réunis sans la présence de forces extrarégionales –comme le Canada, les Etats-Unis ou l’Europe. Lorsque j’ai déclaré avec une certaine émotion que je regrettais que Fidel ne soit pas assis parmi eux à ce moment-là, mes propos ont été accueillis par une ovation générale. C’était pour nous le signe d’une profonde reconnaissance et une grande joie dont le peuple a été témoin, car c’était la reconnaissance de notre résistance, comme je l’ai dit: «Nous sommes ici parce que nous avons résisté, nous avons résisté pendant un demi siècle » et, évidemment, il faut être prêt à résister un demi siècle de plus.
La vie est une bataille incessante, un combat éternel; certains, par lassitude, abandonnent la lutte et renient tout ce qu’ils ont fait; ils sont par bonheur peu nombreux. Le peuple reste ferme, et il défendra ainsi sa Révolution. Nos Cinq Héros qui sont détenus injustement dans des prisons nord-américaines depuis plus de dix ans représentent précisément cet exemple de résistance.
Journaliste: Les raisons abondent pour célébrer un jour comme aujourd’hui le 50e anniversaire du triomphe de la Révolution cubaine. Comment allez-vous commémorer cet anniversaire ?
Raul Castro: Je pense me rendre vers minuit au Mausolée des camarades morts au combat sur le Deuxième Front ou qui y ont été enterrés après le triomphe de la Révolution. Je veux déposer une gerbe au pied du monument, et aussi sur la tombe de Vilma; écouter avec eux les coups de canon pour le 50e anniversaire de la grande aurore et l’hymne national. Et demain, très tôt, au nom de Fidel, déposer quelques fleurs sur les tombeaux de Marti, des morts de la caserne Moncada, des morts de la lutte clandestine, de Frank Pais et des internationalistes de Santiago, en hommage à ceux de tout le pays. Je le ferai avec un sentiment de satisfaction, avec émotion et avec confiance dans l’avenir.
Journaliste: Merci beaucoup et félicitations pour le 50e anniversaire du triomphe de la Révolution.
Raul Castro: Merci à notre peuple héroïque. •