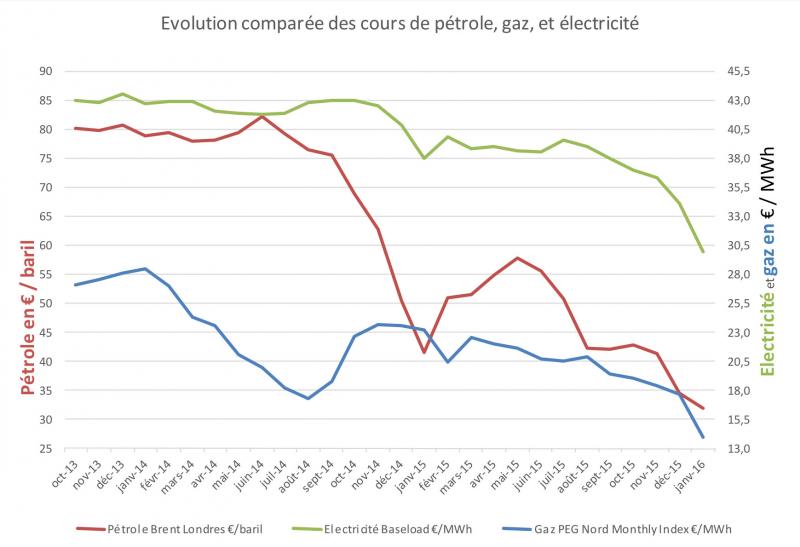Dépressif à cause de mon travail, j’ai osé en parler
Par Pierre Paul pour rue 89
Je travaille dans une multinationale depuis huit ans. Un parcours dont la progression n’avait pas subi d’à-coups jusqu’ici. Or depuis huit mois, je suis sous-employé, sous-utilisé, placardisé. Suite à un projet sans cesse repoussé, je me retrouve dans l’attente d’une futuredécision qui ne vient jamais.
Je trouve par bonheur un poste dans une autre direction, laquelle m’attend avec un projet motivant. L’espoir revient, mais mon service refuse de me laisser partir, pour des raisons politiques qui me dépassent.
La dépression s’installe. J’ai du mal à dormir, du mal à partir au bureau. Mon arrivée au travail avec deux heures de retard le matin n’inquiète personne ; personne ne réalise même que je ne suis pas là. C’est dire si je me sens utile. L’absurdité du refus de ma mutation me pèse.
La dépression est très dure à avouer, car c’est un aveu de faiblesse, et on n’aime pas les faibles dans l’entreprise. Pourtant, il y a des recours, mais ils sont plus ou moins efficaces.
Le premier auquel je pense est celui de la ligne d’assistance téléphonique pour les difficultés psychologiques des salariés, communiqué il y a quelques années, lors d’une vague de suicides dans l’entreprise. A l’époque, c’était un sujet de plaisanterie entre collèges.
Au téléphone, une oreille impartiale, mais pas de vrai suivi
Je le retrouve dans un bureau, sous d’autres documents. Il est impossible à trouver dans l’annuaire de l’entreprise, mais cette ligne a le mérite d’exister.
Il s’agit ici visiblement plus de s’y épancher que de profiter d’un réel suivi des salariés. La personne que j’ai eue au téléphone m’a écouté pendant une heure, prodigué quelques conseils et analysé ma situation.
Je peux rappeler ce numéro quand je veux, sauf que j’aurai certainement quelqu’un d’autre au bout du fil. Pas vraiment de suivi de mon cas, donc. Mais une oreille impartiale qui a compris que mon salut était dans la recherche d’un autre emploi.
Un collègue et ami, témoin de mon désarroi, s’en ouvre à la médecine du travail et me conseille d’aller les rencontrer. Je tombe sur un médecin, dont je dois souligner la chaleur de l’accueil, qui me fait raconter ma situation.
Après une heure de discussion, il me fait passer un test pour évaluer mon niveau de stress. Mes « très bons » scores (notamment un 0 sur 20 en « perspectives d’évolution ») confirment une situation dépressive et anxiogène qui doit être prise en charge. Je ne veux pas être marqué « dépressif » au fer rouge.
Mais la médecine du travail étant « non-prescriptive », il ne peut que me conseiller d’aller voir mon généraliste, et me proposer une future entrevue pour faire le point sur ma situation. De toute façon, je suis très réfractaire aux médicaments dans ce genre de cas.
Il me propose aussi d’utiliser mon « mal-être au travail » pour faire pression sur la hiérarchie, afin qu’elle accepte ma mutation. Mais c’est là que toutes les perspectives de prise en charge s’arrêtent pour moi : je ne tiens absolument pas à ce que mes difficultés soient rendues « publiques ».
Il y a une culture du politiquement correct et de l’apparence « clean » du cadre, qui m’empêche d’aborder ce sujet avec ma hiérarchie. De peur de me voir « grillé » pour toujours, qu’il soit marqué « dépressif » au fer rouge dans mon dossier, je préfère attendre que ça passe.
Chercher ailleurs ? Je le fais, oui, mais la conjoncture est contre moi. Forcer la mutation ? Impossible.
Je vais donc me démerder jusqu’à ce que je trouve une porte de sortie. La boîte, elle, m’offre des canaux d’écoute. J’ai passé l’après-midi à parler de mon mal-être, et ça m’a fait du bien. C’est déjà ça.