Gilda Guibert-Landini, professeur agrégée d’histoire
1848 en France : Des illusions de la révolution fraternelle à la sanglante lutte des classes.
 Le « printemps arabe » tourne mal en Tunisie… On dit que l’histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaie. Il y a 170 ans de cela, les peuples européens, suivant la Révolution de Février 1848 en France, se soulevèrent : ce fut le « printemps des peuples ». En France ce printemps fut de courte durée : cette révolution qui avait suscité, comme dans les pays arabes, tant d’espoirs, finit en juin dans un bain de sang. Celui du peuple.
Le « printemps arabe » tourne mal en Tunisie… On dit que l’histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaie. Il y a 170 ans de cela, les peuples européens, suivant la Révolution de Février 1848 en France, se soulevèrent : ce fut le « printemps des peuples ». En France ce printemps fut de courte durée : cette révolution qui avait suscité, comme dans les pays arabes, tant d’espoirs, finit en juin dans un bain de sang. Celui du peuple.
Pourquoi la nouvelle république mise en place – la Deuxième République – a-t-elle si vite brisé les aspirations populaires qu’elle avait nourries et a-t-elle débouché sur le coup d’État de Napoléon III en 1851 ? Comment un peuple peut-il se faire voler sa révolution ? Voilà un sujet qui reste bien actuel.
En réalité cette révolution oppose dès le début des forces opposées : celles de la bourgeoisie dominante et celles du peuple ouvrier de la capitale : Paris. La lutte à mort entre ces deux forces est, au fond, une lutte de classes qui ne dit pas son nom, mais qui se révèle dès les premiers instants et s’envenime bientôt en conflits aigus jusqu’à ce dramatique mois de juin 1848.
La monarchie de juillet – 1830-1848
Depuis 1830, la Monarchie de Juillet incarne à la perfection les intérêts de « l’aristocratie financière », comme l’appelait Marx. Le souvenir de la « Grande révolution » est encore très vivace parmi les bourgeois. Et toute la politique menée durant ces années vise à protéger leurs intérêts.
Le renchérissement de la vie en 1847 provoque en France comme sur tout le reste du continent des conflits sanglants. Interdite de réunion, la bourgeoisie républicaine française contourne la loi en organisant à partir du 9 juillet 1847 des banquets qui réunissent des centaines de participants autour de quelques éminents orateurs. On n’en compte pas moins de 70 à Paris et dans les grandes villes du royaume au cours des sept mois suivants.
La révolution de Février 1848
L’un de ces banquets ayant été interdit, les étudiants et les ouvriers manifestent le 22 février 1848 à Paris. Ils sont rejoints le lendemain par la garde nationale composée de petits bourgeois.
Durant les jours qui suivent les manifestations populaires et les barricades érigées dans les rue de la capitale obligent le roi Louis-Philippe à abdiquer et la bourgeoisie – qui se serait ben contentée d’une régence – à mettre en place une nouvelle forme de gouvernement. En effet, afin de ne pas se faire de nouveau rouler dans la farine comme ce fut le cas lors de la Révolution de 1830, le peuple parisien envahit le Palais-Bourbon et repoussant toute solution monarchique, réclame un gouvernement provisoire. Des noms sont jetés à la va vite sur des listes et des bouts de papiers et la liste est alors soumise en plein tumulte à l’approbation d’une foule bigarrée qui se presse dans la salle envahie. Pas de vote puisqu’il n’y a pas d’assemblée. C’est ainsi que sont nommés les membres de ce gouvernement provisoire dont Alphonse de Lamartine[1].
Ce gouvernement provisoire après ce simulacre d’élections, décide de se rendre à l’Hôtel de ville pour, ainsi dire, se faire reconnaître par le peuple et surtout se répartir les différents ministères. En voilà un sérieux sens démocratique ! Mais là, il se trouve en présence d’un courant venant d’ailleurs, d’une autre liste émanant de la presse avancée et des sociétés secrètes républicaines. Y figurent Louis Blanc républicain et organisateur de la campagne des banquets et Alexandre Martin (dit l’ouvrier Albert), un ouvrier mécanicien.
Dans sa composition, ce gouvernement provisoire qui surgit des barricades de Février reflète en réalité les divers partis qui se sont partagés la victoire. Il ne pouvait être qu’un compromis entre les différentes classes qui avaient renversé ensemble le trône de Juillet, mais dont les intérêts s’opposaient avec hostilité.[2]
Gouvernement hétérogène aux voix discordantes dont Proudhon a dit : « il n’a pas su, voulu, osé ». Eh bien soyons clair : les voix dominantes étant celle de la bourgeoisie : les verbes « su » et « osé » ne correspondent pas à la situation. Seul le verbe vouloir est à sa place. Ce gouvernement n’a pas VOULU de République sociale ! Et la République elle-même a bien failli ne pas être prononcée !
Lamartine et ses compères hésitent, discutent, tergiversent durant des heures lorsqu’il s’agit de proclamer le nouveau gouvernement : c’est qu’on ne veut pas effaroucher l’aristocratie ni la haute bourgeoisie qui n’a pas oublié la grande Révolution et qui n’a que faire d’un gouvernement qui ne plierait pas à sa botte. Dès le départ Lamartine dénie aux combattants des barricades le droit de PROCLAMER la République. Selon lui, ce n’est pas à la rue de faire la loi ! Tiens ! On croyait que ces propos avaient été inventés par les sieurs Sarkozy et Macron ! Eh bien non ! Déjà en 1848, la bourgeoisie, qui tout comme eux, a peur de ce peuple des rues, se cache derrière un semblant démocratique. Il faut, dit Lamartine, attendre le vote de la majorité des Français ! À ses yeux, les ouvriers parisiens qui s’agitent en armes sous les fenêtres de l’Hôtel de ville, trop révolutionnaires à son goût, ne représentent pas la France ! Néanmoins, ces combattants des barricades sont résolus à ne pas se laisser escamoter leur victoire comme en 1830.[3] Et du milieu des groupes armés qui fourmillent sur la place de Grève montent des sommations d’en finir. Finalement c’est François-Vincent Raspail, fervent républicain qui, au nom du prolétariat parisien, donne deux heures au gouvernement pour déclarer la République sinon il reviendrait à la tête de 200 000 hommes ! Le délai de deux heures n’était pas encore écoulé que déjà des ouvriers, sur une large bande de toile blanche, charbonnent ces mots en lettres énormes : « La République une et indivisible est proclamée en France. » « République française ! Liberté, Égalité, Fraternité »
Comme quoi, la rue qui ne fait pas la loi peut bien l’instaurer au passage ! Les bourgeois entendent alors crier des mots qu’ils ne comprennent pas : « Vive la République démocratique et sociale ! » Sociale ! Qu’est-ce que cela peut bien signifier ?
Ce que cela signifie, ils vont le comprendre dès le lendemain : au matin du 25 février, des faubourgs et des quartiers pauvres descendent sur la place de Grève des hommes armés de fusils, de sabres et de drapeaux rouges. Face à eux le gouvernement bourgeois sous la houlette du poète refuse ce drapeau et impose le drapeau tricolore.[4]
Mais peu après, c’est une délégation en armes conduite par un ouvrier mécanicien nommé Marche, un de ces inconnus dont l’énergie fait des miracles dans les moments de troubles, qui se présente devant le gouvernement. Il réclame la reconnaissance immédiate du « droit au travail ». Le gouvernement regimbe devant cette sommation impérieuse. Lamartine s’efforce d‘envelopper du miel de son éloquence celui qu’il considère sans doute comme un pauvre ouvrier ignorant. « Assez de phrases comme cela ! » l’interrompt brutalement le jeune homme en tapant du poing sur la table. Désarçonnés, les nouveaux maîtres du pouvoir, sont obligés d’accepter séance tenante, le décret suivant : « Le gouvernement provisoire de la République française s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail. Il s’engage à garantir du travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s’associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail. »
Tous signent, et un certain nombre l’a sans doute fait à contre-cœur. C’est en effet, l’acte le plus révolutionnaire qu’on leur ait arraché. Le décret est un engagement solennel de l’État à intervenir dans le domaine économique dans un sens favorable aux travailleurs. Il indique même en termes imprécis l’association comme le moyen d’atteindre ce but. La Révolution sociale vient de trouver là sa formule vague. Il ne reste plus qu’à attendre, se disent sans doute les députés, que les ouvriers rentrent chez eux et se calment.
Mais non ! Au matin du 28 Février, jour où la République doit être officiellement proclamée sur la place de la Bastille, plusieurs milliers d’ouvriers, sur la place de Grève brandissent des bannières où s’étalent ces mots : Ministère du Progrès. — Organisation du travail. — Abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme, et une nouvelle députation populaire est annoncée au Gouvernement provisoire porteuse d’une demande de décret plus explicite.
Lamartine et les modérés qui répugnent de toute évidence à mettre en œuvre un décret qui dépasse leur pensée, mais qui ont encore peur des barricades, cherchent une transaction qui ne leur coûterait pas grand-chose. Et là : idée de génie ! Ils nomment une Commission spéciale qui siègerait au Luxembourg, et qui serait chargée de rechercher les moyens d’améliorer la condition de vie des classes laborieuses. Louis Blanc et Albert se laissent prendre au piège et consentent à la présider. Attention : il s’agit bien d’une Commission, pas d’un ministère. Pas d’argent et donc pas de pouvoir ! Les deux représentants de la classe ouvrière, qui ont « pour tâche de chercher la pierre philosophale, découvrir la terre promise, de proclamer le nouvel évangile et d’occuper le prolétariat parisien »[5] sont ainsi bannis du siège du Gouvernement provisoire, qui conserve seul la réalité du pouvoir, puisque c’est là – et là seulement – que se prennent les décisions. Les représentants de la classe ouvrière n’auront droit, eux, qu’à « une parlote autour d’une marmite vide ».[6]
Le prolétariat est bien obligé dans un premier temps d’accepter les limites que la bourgeoisie lui impose avec ce que Marx appelle « un ministère de l’Impuissance, un ministère des Vains Désirs, une commission du Luxembourg », au lieu de revendiquer, d’imposer même son intérêt comme l’intérêt révolutionnaire de la société. En fait, cette illusion de la collaboration entre les deux classes est typique de ce mois de février 1848 : On se prend à rêver que peut-être patrons et ouvriers pourraient devenir des « partenaires sociaux » comme on ose le prétendre encore aujourd’hui… Il faudra le massacre de juin pour que la « guerre de classes », comme l’appelait déjà Tocqueville, écrase sans distinction d’âge ou de sexe ceux qui ont le malheur de s’opposer à la bourgeoisie.[7] Le prolétariat peut faire la Révolution AVEC (ou POUR) la bourgeoisie, mais pas CONTRE !
Les réformes de la République bourgeoise de février.
Dès la veille, le 27 février, afin de couper l’herbe sous le pied à Louis Blanc qui réclame des ateliers sociaux, autrement dit des coopératives, le gouvernement publie un décret dans lequel il décrète l’établissement d’ateliers nationaux. Rien à voir avec des ateliers sociaux ! Ce sont en fait des ateliers de charité qui ne s’inspirent nullement des principes socialistes ! Lamartine le dira lui-même[8] : Ils furent surtout la solution méprisante de la bourgeoisie afin d’occuper le lumpenproletariat, un prolétariat en haillons qu’elle espérait d’ailleurs transformer en « armée prétorienne » contre les « ouvriers séditieux des clubs »[9]. Tout comme la monarchie de Juillet fut contrainte de proclamer qu’elle était une monarchie entourée d’institutions républicaines, la république de Février fut forcée de s’annoncer comme une république entourée d’institutions sociales[10]. Mais rien ne révèle mieux le dissentiment existant parmi les membres du gouvernement que ces ateliers nationaux qui se révèlent d’ailleurs bien vite aussi coûteux qu’inefficaces et qui plus est, des foyers d’agitation révolutionnaire ! Où la majorité disait : charité, la minorité répliquait : justice. Malgré cela, ils resteront longtemps dans les mémoires le symbole de la fraternisation et de l’unanimisme républicain. Le prolétariat de Paris se laissa aller à cette généreuse ivresse de fraternité.
On a bien souvent décrit la révolution de février 48 comme « une révolution romantique ». Bien sûr : rendez-vous compte ! Quels changements en quelques jours ! Le 2 mars, un décret – qui ne durera que le temps des beaux jours – accorde la réduction du temps de travail à 10 heures[11]. Le 4 mars, la liberté totale de la presse est décrétée ! Le 5 mars, c’est à la fois l’abolition de l’esclavage annoncée dans le Moniteur et le suffrage universel masculin (les femmes n’en sont pas jugées dignes) – le moyen qu’a trouvé la bourgeoisie de contrer ce qu’elle ose appeler la violence politique. Elle seule a donc le droit de faire régner la violence contre ceux qui se battent pour leur survie : c’est la dictature de la bourgeoisie. Le seul moyen qu’elle accorde dorénavant de faire entendre sa voix, c’est le vote. L’image célèbre de Bosredon représentant l’ouvrier qui pose son fusil pour mettre son bulletin dans l’urne semble opposer ainsi le suffrage universel aux « mouvements de la rue ». Cette idée revient d’ailleurs sans cesse sur le tapis dès lors qu’il y a des manifestations. L’ouvrier n’a pas lâché son fusil. Mais il doit le conserver uniquement pour lutter contre les ennemis de l’extérieur, pour la défense de la patrie. Si cette représentation est devenue l’emblème de la démocratie électorale, elle n’en demeure pas moins sarcastique. En arrière-plan des affiches électorales indiquent « Avis aux caméléons », « Aux grands prestidigitateurs ». Le dessinateur de toute évidence n’est pas dupe. Les ouvriers eux-mêmes ne tarderont pas à s’apercevoir que les promoteurs du suffrage universel ont partiellement réussi à convaincre les partisans de l’ordre en organisant ces premières élections, puisque les classes paysannes et la petite bourgeoisie, majoritaires, se révèlent être davantage conservatrices. Et pour cause, comme l’explique Tocqueville : « Le matin de l’élection, tous les électeurs, c’est-à-dire toute la population mâle au-dessus de 20 ans, se réunirent devant l’église. Tous les votes furent donnés en même temps, et j’ai lieu de penser qu’ils le furent presque tous au même candidat. ». C’est sûr que sous l’œil du curé ou du noble du village, il est difficile d’avoir un vote contestataire. D’autant que, comme la plupart des paysans sont analphabètes, ils utilisent des bulletins déjà rédigés par le maire, voire par le candidat lui-même. De toute façon, le vote n’est pas secret. Donc la pression est trop forte pour que ce suffrage soit réellement démocratique ! C’est donc une chambre à dominante conservatrice qui s’impose le 4 mai, et la forme réactionnaire du régime en découle.
Le voile se déchire : La répression bourgeoise est impitoyable !
Les nouveaux élus reviennent rapidement sur certains progrès sociaux : afin de mater les émeutes qui se succèdent entre mars et mai, le 12 mai l’Assemblée interdit aux clubs de présenter des pétitions. Le 15 mai, lors d’une manifestation, les chefs socialistes sont arrêtés (Raspail, Blanqui, Albert, Barbès). Le piège se referme. Le temps de la confrontation est venu. Dès le 17 mai, l’embauche est suspendue.
Des mesures de plus en plus draconiennes sont prises contre les ateliers nationaux, jugés coûteux et surtout facteurs de diffusion des idées socialistes. Nombre d’ouvriers se retrouvent au chômage, ce qui les pousse à l’émeute, en juin 1848. « Les ouvriers n’avaient plus le choix : il leur fallait ou mourir de faim ou engager la lutte. […] C’était une lutte pour le maintien ou l’anéantissement de l’ordre bourgeois. Le voile qui cachait la République se déchirait. »[12]
Le lendemain 24 juin, l’Assemblée déclare l’état de siège. La répression est alors sans pitié. C’est le général Cavaignac (célèbre pour ces enfumades en Algérie) qui est chargé de réprimer le mouvement. Au moins 4 000 insurgés ont péri dans les combats et 1 500 ont été fusillés sans jugement. On procède à près de 12 000 arrestations. De dures condamnations vont suivre et l’on déporte en Algérie 4 350 insurgés sans les avoir jugés. Louis Blanc prend la route de l’exil. Finalement, le 4 juillet, les Ateliers Nationaux sont dissous. La bourgeoisie pouvait enfin dire « l’ordre règne à Paris » !
Mais pour le prolétariat, c’en est fini de ses illusions fraternelles. La République bourgeoise c’est la domination du capital par tous les moyens y compris la guerre civile. Les mots d’ordre prolétariens comme l’a dit Marx changent pour devenir Renversement de la bourgeoisie ! Dictature du Prolétariat ! L’expérience historique – conclue dans la tragédie de juin – que vient de faire la classe ouvrière a commencé à installer dans la conscience d’un grand nombre d’ouvriers l’idée qu’il fallait en conséquence doter la classe ouvrière d’un programme et d’un parti capables de conduire la Révolution. Et Marx de conclure, non comme s’il parlait de 1848 comme s’il imaginait déjà 2018 : si une autre révolution devait avoir lieu, elle serait obligée de conquérir le terrain européen, le seul où l’emportera la révolution sociale ! Car ce n’est que trempé dans le sang des insurgés de Juin 48 que le drapeau tricolore est devenu le drapeau de la révolution européenne, le drapeau rouge !
Pour tous ceux qui seraient intéressés par cette révolution oubliée de nos manuels d’histoire et qui est pourtant le berceau nos idées révolutionnaires, sachez qu’un article plus complet sera dans le prochain n° d’Etincelles en juin.
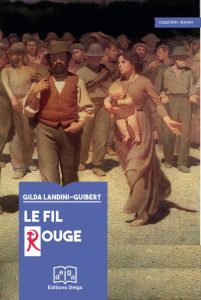 Gilda Landini est notamment l’auteur de « Le Fil Rouge », un livre a mettre dans toutes les mains
Gilda Landini est notamment l’auteur de « Le Fil Rouge », un livre a mettre dans toutes les mains
[1] Poète renommé et homme politique qui fut d’abord légitimiste, puis orléaniste et enfin républicain (une vraie girouette comme V. Hugo).
[2] Idem, Karl Marx.
[3] Pendant la révolution de juillet 1830, les masses populaires qui s’étaient battues sur les barricades et qui demandaient le suffrage universel, la République et la convocation de la Constituante n’avaient pas su se présenter de façon aussi organisée que la bourgeoisie. Les banquiers utilisèrent la victoire du peuple et aidèrent le duc d’Orléans (Louis-Philippe) à monter sur le trône. (Karl Marx, La lutte des classes en France, 1848-180)
[4] Tableau de H. F. E. Philippoteaux : Lamartine repoussant le drapeau rouge à l’hôtel de ville, le 25 février 1848
[5] K. Marx, idem.
[6] La deuxième république française 1848-1851 par Georges Renard.
[7] En 2006 c’est l’un des plus grands patrons du monde Warren Buffet qui osait dire : « la lutte des classes existe et c’est ma classe, celle des riches qui est en train de la gagner » avant de confirmer en 2011 que cette guerre avait bel et bien été gagnée. Et l’un des magnats financiers américains (décédé en 2016), Thomas Perkins prônait d’adapter le poids du vote de chaque citoyen en fonction du montant des impôts qu’il paie… bref le retour au suffrage censitaire !
[8] Lamartine, Histoire de la Révolution de 1848.
[9] Lamartine, idem.
[10] K. Marx, idem.
[11] Mais dès septembre, après que les belles illusions ont été noyées dans le sang des ouvriers, il est supprimé et on passe à 12 heures.
[12] K. Marx, idem.


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)

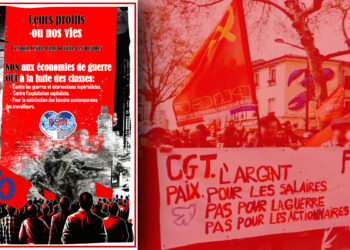



A l’Assemblée Nationale, pour la première fois élu, un « Compagnon », Agricol Perdiguier, a, également pour la première fois, défendu le principe de la réduction du temps de travail, avec un discours, qui, certes, mélange des aspects divers, de différentes valeurs (il fait référence à ses convictions chrétiennes), mais est très solidement argumenté, sur l’intérêt, à la fois, humain et économique. C’est peu de dire que les « aristocrates » de l’Assemblée ne l’ont pas entendu. Quelques années plus tard, dans un cadre social et économique violent, la « solidarité » compagnonnique sera, pour lui, en échec, puisqu’il finira sa vie dans le plus grand dénuement.
http://leblogdessalariesdescfa.hautetfort.com/archive/2013/11/02/agricol-perdiguier-le-discours-contre-les-12-heures-et-contr.html
23 février 1848, 23 février 2018 … Si ma mémoire ne me trompe pas, il y eut aussi un 23 février glorieux en 1918 : fondation de l’ Armée Rouge.
Merci à vous ! En effet, Perdiguier est provençal, né dans le Vaucluse : il est le seul député ouvrier à avoir été élu 2 fois en 1848 !!! une fois dans le Vaucluse où il est né et une fois dans la Seine où il vivait : il a choisi la Seine. En bonne provençale que je suis, je ne peux l’ignorer et dans l’article plus long que j’ai préparé pour Etincelles et qui paraîtra en juin, figurera un extrait de son discours du 8 septembre 1848 contre les 12 heures de travail dont certains passages sont d’une brûlante actualité. Mais là on m’avait demandé de faire « court »… Encore merci à vous pour ce rappel d’un autre héros ouvrier anonyme. Gilda