www.initiative-communiste.fr publie ci-après une critique débat autour du film c’est quoi ce travail, par Dominique Muselet du réseau salariat. L’occasion de souligner combien sont rares les films qui même indirectement donne à voir les travailleurs.

Dimanche 1er novembre, un débat animé par Sébastien Jousse et Bernard Friot* a suivi la projection à l’espace St Michel, du documentaire de Sébastien Jousse et Luc Joulé : C’est quoi ce travail ? La salle du cinéma était pleine et la plupart des gens sont restés pour le débat. Il y avait là de nombreux adhérents et sympathisants de réseau-salariat.
Avant de parler du débat, il faut parler un peu du film. Je n’ai pas lu les critiques et donc je vais me contenter de vous donner mes impressions personnelles. Tout le film se passe dans l’usine de PSA Peugeot-Citroën de Saint-Ouen où l’on fabrique des pièces de voiture. Chaque ouvrier, ouvrière, est enchaîné(e) à sa machine et, comme quelqu’un nous l’a expliqué pendant le débat, chaque série d’actions dure 15 secondes. C’est-à-dire que tous les 15 secondes l’ouvrier refait la même série de mouvements !
Pendant qu’on voit l’ouvrier opérer, on l’entend parler en voix off. Il parle de son travail, de sa machine, de ses collègues, de sa vie, de ses souffrances et de ses aspirations. Puis c’est le tour d’un autre ouvrier, et ainsi de suite.
Dans l’usine, il y a aussi un artiste, le compositeur Nicolas Frize, « en résidence » pour deux ans. Il monte une sorte de concert avec les ouvriers. Si bien qu’on voit en alternance des ouvriers prisonniers de leur machine et de leur cadence et un musicien qui se balade dans l’usine comme ça lui chante, en faisant résonner tous les bouts de ferrailles qu’il rencontre pour essayer d’en tirer des sons exploitables. On ne sait pas s’il exploite aussi les ouvriers qu’il fait travailler à son spectacle ou s’ils sont payés pour ces heures supplémentaires.
On ne sait pas non plus si les réalisateurs ont voulu, ce faisant, illustrer le fossé qui sépare le « travail » des ouvriers du « travail » du compositeur. Les premiers sont soumis à un employeur, à une machine et à l’insécurité permanente (qu’on appelle dans notre jargon, à RS, le chantage à l’emploi), et le second bénéficie d’une subvention d’état et donc d’une large autonomie et de la sécurité financière pendant deux ans. Tout ce qu’il doit faire, c’est produire une œuvre à la fin des deux ans. Et de la main d’œuvre pour ce faire, il en a à revendre…
Le contraste est saisissant et quand le compositeur revient à l’écran, après un témoignage poignant de plus, on est partagé entre le soulagement de voir la souffrance s’éloigner et la légèreté apparaître, et la colère de voir cet artiste subventionné « profiter » des ressources sonores de cet endroit magnifique (l’usine est splendide), des hommes et femmes qui y travaillent, et même des cinéastes qui sont entrés dans l’usine sur ses talons pour, d’abord et avant tout sans doute, officiellement le filmer lui, dans ses œuvres. Pendant le débat une personne a demandé à S. Jousse si cette expérience artistique, que les ouvriers avaient rendue possible en acceptant d’y participer, avait changé quelque chose dans leur vie. « Non, bien sûr que non, le lendemain, tout a recommencé comme avant ! » a-t-il répondu.
Le film se termine sur des extraits du spectacle, très réussi, très beau, et qui a le mérite de montrer que les ouvriers et ouvrières de l’usine sont pleins de talents. Et cela ne fait qu’accentuer le sentiment de gâchis, de souffrance et de colère, qu’on a devant le sous-emploi de toutes ces personnes dont la richesse intérieure est palpable.
Voilà, à mon sens, le second contraste autour duquel est bâti ce film : c’est le fossé entre la tâche qu’ils sont forcés de faire et leur force à eux.
C’est peut-être que la robotisation à laquelle ils sont soumis développe leur capacité de résistance, mais le fait est qu’ils ne se laissent pas détruire, ils ne se laissent pas déshumaniser. Leur résilience est remarquable. Chacun d’entre eux (qu’ils me pardonnent j’ai oublié leurs prénoms) s’est construit un espace de respiration, un petit coin de ciel bleu, un refuge intérieur, une soupape de sécurité. Il y a celui qui avance son travail en faisant plus de pièces à l’heure qu’il n’y est obligé pour pouvoir aller prendre un café au bar du coin ; il y a celui qui collectionne les plantes vertes : non seulement il est entouré de verdure, mais la solitude, inhérente au travail en machine, est adoucie par le fait que ses collègues lui en apportent ; il y a celui qui bat la machine de vitesse, et c’est là sa revanche ; il y a celui qui travaille de nuit, ce qui lui détruit la santé, mais la solidarité qui lie l’équipe de nuit le console ; il y a la dame qui a besoin de marcher et qui s’arrange pour avoir le temps de faire de petits tours dans l’usine ; et celui qui s’évade, dans sa tête, au royaume de la musique classique…
Sans cela, ils seraient broyés car ils l’avouent à demi-mot, avec toute la pudeur de ceux qui n’ont pas l’habitude de se plaindre, ils ne vivent pas, ils survivent. Ils sont de ceux qui font face, de ceux qui assument leurs responsabilités jusqu’au bout comme cette ouvrière qui a des douleurs terribles dans le dos et les bras à force de faire les mêmes gestes toutes les 15 secondes mais qui continue parce qu’elle n’a pas le choix, elle a besoin de cet argent. D’ailleurs elle a craqué, une fois, elle a pleuré pendant deux jours complets, le chef d’équipe l’a consolée et elle s’est remise au travail avec son dos en compote.
« Pourquoi ne la change-t-on pas au moins de poste ? » s’est écrié quelqu’un pendant le débat. « C’est qu’il n’y a sans doute pas d’autre poste disponible », lui a-t-on répondu.
La première personne qui a pris la parole pendant le débat a exprimé sa surprise de voir qu’ils ne souffrent pas davantage. On voit bien qu’ils font un travail pénible, solitaire, abrutissant, a-t-elle dit, et pourtant ils n’ont pas l’air de souffrir…
Moi, ce qui m’a étonnée, c’est qu’elle n’ait pas vu combien ils souffraient. Déjà, il ne faut pas perdre de vue que leur parole n’est pas vraiment libre dans le film, ils s’expriment dans l’usine et dans le cadre de leur emploi.
Mais leur retenue, leur refus d’étaler leurs souffrances, s’explique peut-être aussi par leur peur de lui donner corps, et de s’y perdre. Leur attitude contraste (encore un contraste !) avec la propension de plus en plus grande de la société à la pleurnicherie, la sensiblerie, l’apitoiement sur soi-même.
Pour moi, le but des cinéastes, conscient ou inconscient, était justement de faire ressortir leur force, leur humanité, leur capacité de résistance, leur refus de disparaître, d’être robotisé, anéanti, leur capacité à se créer et à nourrir une vie intérieure qui leur permettre de vaincre la machine et tous ceux qui les y enchaînent, leur refus de perdre espoir.
Car « Il y a pire que la mort, il y a la perte de l’espoir. » (Arthur dans Le roi Arthur)
*Bernard Friot Bernard Friot est un sociologue et économiste français né le 16 juin 1946 à Neufchâteau, et professeur émérite à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Il est le co-fondateur de l’association d’éducation populaire, Reseau-salariat
source : http://www.reseau-salariat-idf.com/ et http://www.legrandsoir.info/autour-du-documentaire-c-est-quoi-ce-travail.html


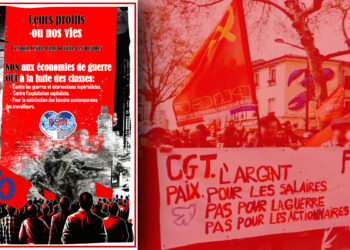
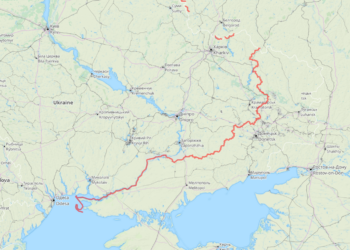


![L’Union Européenne 20 ans après le 29 mai 2005 : le referendum 2025 ? la table ronde en vidéo [PRCF PARDEM FIERS DPC JRCF]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250329-referendum-union-europeenne-120x86.jpg)