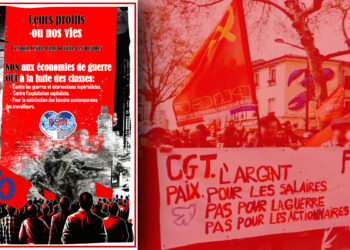Dans une petite bourgade du nord-est de l’Angleterre, ancienne ville de mineurs minée par le chômage, débarquent quelques familles syriennes réfugiées placées là semble-t-il par une organisation, publique ou privée. Leur arrivée déclenche des réactions diverses et divise la population, échantillonée dans les habitués du pub The Old Oak, dernier lieu public et de discussion.
Ken Loach explore crûment la complexité du racisme ou de la xénophobie dans les classes populaires. Certains habitants, symboliquement regroupés autour de TJ, patron du pub, se montrent bienveillants. La tirade de l’un d’eux nous rappelle assez vite le lien entre le rejet de l’étranger chez certains travailleurs et le degré de la conscience de classe. A l’un de ceux qui sont le plus violemment hostiles aux nouveaux arrivants, dont presque chaque phrase est ponctuée du terme « bougnoules » (c’est du moins la traduction proposée par les sous-titres du terme anglais – que nous ne sommes pas parvenus à saisir), il ironise : « On voit que ton père était un jaune, tu es en train de tourner comme lui »…
D’autres, les plus nombreux, se montrent méfiants au premier abord, pour évoluer au gré de leur compréhension de ces autres pas si autres. Cette catégorie est l’occasion pour le film d’évoquer les aspects pervers de l’aide aux réfugiés dans un contexte de grande pauvreté et dans le cadre général de l’anarchie capitaliste. L’un des habitués du pub s’agacera ainsi que les réfugiés soient envoyés dans cette localité déjà déshérité, et non chez les « bourgeois de Chelsea et Westminster », qui n’en veulent pas « et nous traitent de racistes si on se plaint »… Plus tard, une scène pleine de finesse : trois enfants du coin assistent à une livraison de vivres à l’une des familles réfugiées ; il s’agit de dons en nature d’associations paroissiales des environs, de particuliers, du syndicat des pompiers, etc. En plus de l’alimentaire, un vélo, d’allure vétuste, se trouve dans le camion. Avec plus d’incompréhension que d’animosité, l’un des gamins fait remarquer : « Moi aussi, j’aimerais bien avoir un vélo »…
L’Old Oak se trouve au cœur des trames du film. Lieu de rassemblement de longue date, c’est dans son arrière-boutique que Yara, l’aînée d’une des familles syriennes, découvre profondément, et très matérialistement, où elle a atterri. Une série de photographies aux murs de ce qui est devenu un débarras témoigne du passé de la ville, la mine, les accidents, les grèves, et le lien social perdu. Et cette phrase en légende d’un cliché de piquet de grève : « Quand on mange ensemble, on se serre les coudes » (When you eat together, you stick together)…
Son initiative de réhabiliter l’arrière-salle du pub pour y tenir plusieurs fois par semaine une cantine gratuite pour tous les enfants du bourg ne lui rendra cependant pas grâce aux yeux des irrécupérables racistes, troisième catégorie, très restreinte mais au pouvoir de nuisance démesuré. Un pouvoir que TJ se voit contraint de tolérer car la situation du pub ne tient qu’à un fil… et qu’ils consomment allégrement. Pourquoi n’auront-ils de cesse de torpiller les nouvelles « activités caritatives » du bistrotier ? Difficile à dire. Méchanceté, situation un peu plus aisée que la moyenne ? Peut-être n’ont-ils pas d’enfants à nourrir, cantonnant ainsi leurs perspectives à « retrouver leur bon vieux pub »…
On touche là aux regrettables insuffisances du film. Ken Loach, comme à son habitude, tient à nous faire toucher du doigt la vie des oubliés et des laissés-pour-compte du monde capitaliste. Et sans misérabilisme, ce qui ne gâche rien de cette fresque sociale hyper-réaliste. Simplement, il ne semble pas y avoir d’issue possible à la situation, seulement une légère atténuation de ses aspects les plus navrants, suspendue finalement à la bonté de chacun. Et c’est déjà quelque chose, dans cette Angleterre industrielle fracassée par le thatchérisme et qui ne s’en est jamais remise, où, comme le dira TJ à son ancien ami Charlie qu’il est venu confronter, probablement la tirade la plus pertinente : « Quand c’est la merde, on regarde toujours en bas, jamais en haut. C’est plus facile de s’en prendre aux plus pauvres ou aux émigrés. Chacun pour soi, la loi de la jungle, voilà où on en est rendus ».
Certes, mais n’est-ce pas aussi ce qui se fait le plus spontanément ? Comment regarder vers le haut ? Sans regretter que le cinéaste ne s’aventure pas dans les suggestions militantes qui montrent souvent leur promptitude à la lourdeur, on peut déplorer que l’idée d’organisation soit si peu présente. (Hormis, au mieux, dans cette cantine, fournie par différentes charités…)
Et pourtant, les fréquentes allusions au passé minier combatif du bourg auraient pu être l’occasion de brosser cette idée, sans lourdeur, en arrière-plan. Non, pas de politique, pas de lutte syndicale.
C’est peut-être gâcher tant de pertinence sociologique que d’en conclure, uniquement, la nécessité très consensuelle du « vivre-ensemble »…
En revanche, le sujet du film se trouvant être le racisme au sein des classes populaires broyées par la désindustrialisation, on aurait pu, sans gêne, rester dans le flou quand à la situation du pays d’origine des réfugiés. On aura quand même droit à la petite pique anti-Bachar – « ils sont une centaine dans une cellule, ils doivent s’asseoir à tour de rôle. Voilà ce que nous fait le régime al-Assad. » – mais sans plus de détails… parce que, mettons, c’est bien connu. Pour compenser, il y en a aussi pour l’État Islamique, à propos de la destruction de Palmyre et de la perte irréparable de son patrimoine – un « ni-ni » qui pour le coup relève de la suggestion militante…et pas des plus subversives.
Le cinéma social se fait rare, ne soyons pas trop sévères ; et gageons que ses impératifs sont peu compatibles avec ceux de l’industrie cinématographique – non plus, si l’on veut être un brin taquin, qu’avec ceux de la sélection au Festival de Cannes…
HUBBARD


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)