
Notre camarade Jean-Paul Batisse était l’invité, début juillet, de la librairie Tropiques, pour parler de son ouvrage, « Il était une fois en URSS » (Editions Delga, 2019). Lecteur à Alma-Ata de 1984 à 1988 puis à Sofia de 1988 à 1994, ancien professeur à l’Université de Reims, il explique les raisons de la nostalgie actuelle pour la « belle époque » que fut le premier pays socialiste de l’histoire de l’humanité.
Commander le livre : http://editionsdelga.fr/produit/il-etait-une-fois-en-u-r-s-s/
Il était une fois en URSS
Quand on évoque leur ancienne patrie devant des habitants de l’ex-URSS, ceux-ci laissent percer un sourire, une lueur dans les yeux, renvoyant à des temps forts et des souvenirs impérissables, qu’ils ne demandent qu’à raconter.
Fin connaisseur de l’espace soviétique, où il effectua nombre de séjours, dont l’un en poste à Alma-Ata (Kazakhstan) de 1985 à 1988, et se basant, avec faits de société et anecdotes à l’appui, sur ses observations personnelles, Jean-Paul Batisse met au jour les raisons d’une telle nostalgie de la « belle époque » dans tous les domaines, pour voir en quoi celle-ci se distinguait du mode de vie occidental.
En Russie, d’après La Croix (2015), à la question « quel système préférez-vous ? », ils sont 34 % à répondre l’URSS, contre 29 % pour le système actuel et seulement 11 % pour la démocratie à l’occidentale. Un autre sondage, réalisé par la société Levada, indique que 56 % des Russes regrettent l’Union soviétique. Même les rares qui n’éprouvent pas une telle nostalgie reconnaissent que l’ancien système présentait quelques avantages, qu’un certain état d’esprit a disparu.
L’auteur ne se serait pas lancé dans l’écriture de ce livre s’il n’y avait pas été encouragé par de nombreux amis ex-soviétiques, qui estiment qu’il est essentiel que l’Occident connaisse la vérité sur leur ancienne patrie.


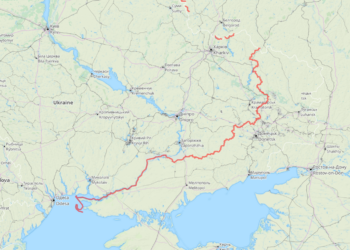


![L’Union Européenne 20 ans après le 29 mai 2005 : le referendum 2025 ? la table ronde en vidéo [PRCF PARDEM FIERS DPC JRCF]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250329-referendum-union-europeenne-120x86.jpg)

je pense que, puisque la lutte des classes semble bien être le moteur de l’histoire selon la science, on ne peut étudier l’histoire du socialisme réel, du processus réel du communisme et donc de l’URSS, sans poser la question de la lutte des classes en URSS pour expliquer les orientations révolutionnaires mais aussi les orientations contre-révolutionnaires. Lutte des classes qui se déroule bien sûr dans les entreprises, dans la rue, dans la vie culturelle et idéologique et dans les structures de pouvoir, à commencer par le Parti. Staline, Trotsky ou Mao Zedong ont un peu écrit sur ces questions, chacun à sa manière bien sur, mais la contre-révolution des années 1985-89-91 apporte forcément des éléments supplémentaires pour nourrir cette réflexion. Quelle était la base sociale de la bourgeoisie post-soviétique et quelle était la base sociale du capitalisme (re)naissant ? Qui était sans doute plus un nouveau capitalisme qu’une simple restauration capitaliste de pays qui n’avaient été qu’à la périphérie du vieux capitalisme. Cela posera aussi la question de la nécessitée de ré-analyser les rapports entre structure et superstructure, celle du rôle du capitalisme mondial(isé), y compris dans les pays alors en partie à l’abri de ce marché capitaliste et celle de l’origine des consciences de classe dans ces sociétés là. Pourquoi pouvait-on être un libéral dans un pays où il n’existait en principe pas de propriété privée des moyens de production (mais où il existait les marchés kolkhoziens et le marché noir et aussi les liens formels et informels avec les entreprises et entrepreneurs capitalistes occidentales, en particulier à partir du moment où on a introduit les politiques de licences). J’ai par exemple accompagné comme traducteur des cadres d’une entreprise polonaise en 1979 venant visiter leur partenaire commercial français. C’étaient des membres du Parti qui ne remettaient alors pas en cause ni le système socialiste ni même, pour des Polonais, la nécessité d’une alliance polono-soviétique …mais ils comparaient désormais leur niveau de vie et d’autonomie de décisions, non pas tellement avec celui des ouvriers de leur entreprise ou celui de leurs propres parents, mais avec ce qui leur apparaissait comme celui des cadres supérieurs et des propriétaires de l’entreprise française avec qui ils étaient en lien constant. On peut supposer que les hauts cadres soviétiques se sentaient de plus en plus sur la « même longueur d’onde » que leurs « partenaires » occidentaux de négociation, les plus hautes élites du monde, que sur celle de leurs compatriotes salariés.