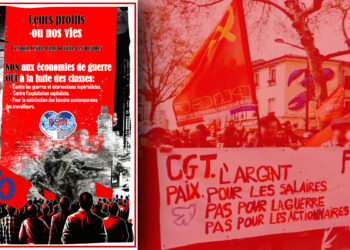conférence de Annie Lacroix-Riz à la librairies Tropiques à Paris
Le mythe de l’épuration
par Claude Grimal
Publié initialement sur EN ATTENDANT NADEAU
La non-épuration en France de 1943 aux années 1950 poursuit le travail déjà abondant que l’historienne Annie Lacroix-Riz mène sur la période de la guerre et de l’immédiat après-guerre. L’ouvrage se fonde, comme ses précédents, sur des recherches d’archives méticuleuses et s’inscrit fort utilement contre des tendances historiques actuelles qui, indulgentes pour Vichy et infiniment moins pour la Résistance, semblent avoir ces derniers temps la faveur de l’édition et des canaux audiovisuels.
Annie Lacroix-Riz, La non-épuration en France de 1943 aux années 1950. Armand Colin, 672 p., 29,90 €
La droitisation de la pensée, en marche dans ce domaine comme dans d’autres, a conduit à une analyse de ces années cruciales qui en vient à réaménager les faits et les divisions chronologiques, brouillant ainsi les frontières entre collaboration et Résistance, minimisant le rôle de cette dernière, insistant sur une terrible « épuration sauvage » extra-judiciaire dont elle (et surtout sa composante FTP) aurait été responsable, et accréditant l’idée que l’État de droit gaulliste après la Libération aurait su organiser une épuration juste et mesurée, à laquelle il aurait ensuite mis un terme pour le plus grand bien du pays. Lacroix-Riz démonte pièce par pièce toutes ces thèses.
D’abord, l’action de la Résistance n’a pas été négligeable, et ce ne sont pas les seuls Américains et Anglais qui ont endossé la dimension militaire de la Libération. Les archives allemandes montrent, sur ce premier point, des anxiétés peu compatibles avec la prétendue débilité des luttes de la Résistance intérieure. La correspondance d’Otto Abetz, ambassadeur à Paris, exprime par exemple une grande inquiétude vis-à-vis des nombreux sabotages, assassinats ou « attaques perfides contre des soldats isolés » allemands perpétrés sur tout le territoire français. Et vers la fin de la guerre, le « commandant ouest » de la Wehrmacht, Gerd von Rundstedt, confirme lui aussi la « gravité » de la situation pour les troupes allemandes dont les petites unités sont constamment attaquées « par des bandits en uniforme ou en civil », obligeant à mobiliser d’importantes forces de protection pour chacun de leurs déplacements. Les combattants patriotes responsables des ces attentats, rappelons-le, pratiquaient non des actes de terrorisme mais des « actes de guerre » définis comme tels par la jurisprudence du Comité de la France libre à Londres (qui s’était déclaré en guerre contre l’Allemagne en 1941).
Quant à l’idée que la Résistance aurait pendant l’Occupation et à la Libération commis des violences par haine de classe, par vengeance politique ou personnelle, elle est battue en brèche. Ce ne sont ni les notables, ni (pour les FTP) des dissidents politiques ayant rompu avec le PC, ni, lors de la Libération, les femmes coupables d’avoir simplement eu des relations sexuelles avec l’ennemi, qui sont visés mais des collaborateurs notoires. Pour ce qui est de la « tonte » des femmes, sujet qui fournit souvent aujourd’hui aux médias leur représentation presque unique de l’après-Libération et qui a donné lieu chez certains historiens à des élaborations plus ou moins heureuses autour du genre, Lacroix-Riz signale n’avoir jamais trouvé « en plusieurs années de dépouillement des fonds de justice, dont l’énorme série BB18, […] de femmes ‟tondues” ou persécutées pour délit sexuel exclusif ». Ce qui ne préjuge pas des actes non consignés dans les archives et n’ôte rien à leur brutalité, ce qui ne signifie pas que n’existèrent pas des débordements criminels et crapuleux, mais fournit un éclairage général différent sur les colères qui animèrent les populations françaises à la Libération.
Cependant, les violences commises pendant l’Occupation ou à la Libération sont à placer dans un contexte : une période d’occupation du territoire national ou qui suivit celle-ci. Pendant plusieurs années, l’armée allemande et les préfets pétainistes utilisèrent police, gendarmerie et milice contre les partisans, les maquis et la population civile accusée de complicité active ou passive avec eux. Lacroix-Riz avance un chiffre de victimes à partir de diverses sources, comptage sinistre mais nécessaire, dont elle souligne les aléas factuels et les présupposés politiques (tel crime relevant, on l’a signalé, du « droit commun » pour les uns et de « l’acte de guerre » pour les autres, etc.).
Quant à l’épuration effectuée après la guerre sous le gouvernement gaulliste, l’ouvrage avance qu’elle fut pratiquement inexistante, et ce non à cause du contexte intérieur (climat de guerre civile ou lassitude des Français) et extérieur (menace soviétique et guerre froide) qui aurait exigé qu’elle fût légère puis qu’on y mît rapidement un terme, mais à cause d’un consensus qui s’était déjà établi à Alger entre de Gaulle et les Américains, pourtant opposés sur nombre de questions. En effet, personne, à Alger, n’aurait souhaité une épuration massive de l’appareil économique, politique et militaire de Vichy. Lacroix-Riz montre que, si des commissions d’épuration furent bien mises en place, ainsi que cela avait été prévu dès le début de l’Occupation au sein de la Résistance et de la France libre, elles furent aussitôt réduites à l’impuissance par différents subterfuges (absence de crédit, de personnel, non-transmission des dossiers, requalifications des chefs d’accusation, mesures dilatoires…).
Par contre, l’inventivité pour transformer les épurables en résistants semble ne pas avoir connu de bornes. De même que l’ardeur pour soustraire à l’examen des collaborationnistes notoires ou faire libérer ceux que les avocats décrivaient comme des « Français non coupables, injustement incarcérés » fut vigoureuse. En effet, les efforts pour les disculper (qu’ils aient été responsables politiques, dirigeants de presse compromis avec les Allemands, administrateurs de biens juifs, etc.) se déployèrent sans relâche. Documentés dans le livre par de nombreux extraits de lettres, de circulaires et autres, ils sont frappants de grotesque et de cynisme. L’arc-boutement des administrations et des ministères pour blanchir les leurs et effacer les méfaits donne une leçon sans pareille de ténacité et de solidarité de caste ou de classe. Grâce à leur imbattable système de protection, peu de ceux qui devaient répondre « d’actes de trahison, collaboration avec l’ennemi et de menées antinationales » furent en effet condamnés. « Entre 44 et les années 1950 », nous dit le livre, « les pratiques d’Occupation indiscutablement établies ne pesèrent rien face aux témoignages dithyrambiques post Liberationem, aux ‟certificats de résistance” ou médicaux, le plus souvent évidemment tarifés ». Dans le domaine du blanchiment, un seul exemple suffira, concernant l’appareil judiciaire : tous les dossiers des magistrats qui avaient condamné à mort des résistants furent classés sans suite. Un succès.
Par un renversement des choses, politiquement sans doute peu surprenant, ce furent les résistants qui se mirent à être soupçonnés et attaqués. Assez tôt, un homme le vit venir. Il écrivit ainsi en 1948 que sous l’égide de « la démocratie américaine » et du « libérateur de la France » (de Gaulle), « la défense de classe » avait « vite » permis aux « amis (français) du docteur Göbbels […] redevenus les bien-pensants », de se remettre « de leur frayeur. […] Tout rentrait dans l’ordre », avec le retour en force de « l’ennemi numéro un : le communisme ». Cet homme, le philosophe Vladimir Jankélévitch, prévoyait aussi que « demain la Résistance devra[it] se justifier pour avoir résisté ».
Bien différent donc fut le sort des collaborationnistes et « assassins de patriotes ». C’est ce que montre avec précision l’ouvrage d’Annie Lacroix-Riz, faisant apparaître comment ils bénéficièrent de la politique de non-épuration favorable au statu quo général des élites que de Gaulle, ses soutiens politiques et les Alliés décidèrent de suivre. La non-épuration est donc à lire.
Claude Grimal


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)