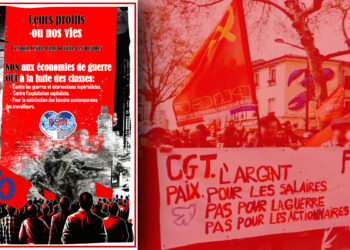Le 6 novembre 2020, différentes composantes du PCF ont organisé un débat en visioconférence, avec notamment pour invité Rémy Herrera, économiste, ainsi que Laurent Brun, syndicaliste, secrétaire général de la CGT Cheminots. La problématique de la table ronde était: « À quelle rupture la crise actuelle du capitalisme appelle-t-elle ? »
Fadi Kassem et Annie Lacroix-Riz
Pour le PRCF, la réponse est assurément la révolution socialiste et, pour y arriver, la reconstruction urgente du parti communiste qui fait cruellement défaut aux travailleurs de ce pays.
Retrouvez, ci-dessous, le verbatim de ces deux interventions ainsi que la vidéo du débat.
La vidéo du débat
L’intervention de Rémy Herrera – économiste

Bonsoir à toutes et à tous, camarades.
Je veux remercier les organisateurs de cette initiative pour leur invitation à parler, à reparler de socialisme. C’est heureux, car cela fait des lustres que le PCF a renoncé à en parler et, en réalité, a renoncé au socialisme tout court. Et je pense, personnellement, que c’est notamment à cause de ce renoncement que le Parti est là où il est, c’est-à-dire au plus bas.
Le problème, c’est qu’en abandonnant le socialisme – qui est une voie, qui est une transition –, le Parti a aussi abandonné la recherche de l’idéal communiste ; d’où cet état actuel de dérive, ou cette impression de perdition.
Donc, je vous avoue que – je suis certes très satisfait de cette initiative, mais que – je me sens un peu comme un prêtre ouvrier invité à un concile du Vatican, ou un membre des alcooliques anonymes invité à un salon des vins et spiritueux pour dire : « il faut arrêtez de boire ! ». Permettez-moi de dire ça en plaisantant pour ne pas être trop déplaisant.
J’ai accepté d’être là et de participer à ce débat, non pas pour diviser, mais pour contribuer, modestement, à l’unité de celles et ceux qui veulent parler de socialisme pour engager une transition socialiste, en rupture avec le système dans lequel nous vivons, et dans lequel nous vivons de plus en plus mal.
Ce système est en crise. Cette crise ne date pas d’hier, elle remonte à au moins un demi-siècle, elle est structurelle, grave, gravissime même, elle est multidimensionnelle. Elle est systémique, ce qui veut dire que le système ne trouvera pas de solution de lui-même. Le capitalisme décline, le capitalisme dégénère, et s’il ne s’effondre pas rapidement, c’est parce que son État le soutient bout de bras ; comme ce fut le cas en 2008 quand le pan financier du système s’est écroulé, et comme c’est encore le cas à l’heure actuelle avec la crise dite « sanitaire » et une économie qui vit sous perfusion.
Ce que je dis, c’est qu’il n’y aura pas d’issue au problème sanitaire avec des gens qui détruisent l’hôpital public ; ni d’issue au problème financier avec des banques qui continuent à spéculer. Il n’y aura pas d’issue au problème environnemental avec des écologistes plus néolibéraux les uns que les autres, pas davantage qu’il n’y a eu d’issue aux problèmes sociaux avec les sociaux-libéraux du PS. Et j’ajouterai qu’il n’y aura pas non plus d’issue au terrorisme religieux avec les marchands du temple qui ont affaibli l’éducation nationale et la laïcité en les vendant au secteur privé, confessionnel de surcroît.
Le capital ne trouvera jamais de solution par sa logique interne du profit pour des raisons profondes, et multiples, notamment : parce que ses nouvelles technologies tendent à économiser beaucoup de travail humain et sapent la création de valeur, parce que le travail improductif gagne du terrain sur le travail productif, parce que les contradictions du capital exigent une intervention de l’État qui coûte de plus en plus cher, mais aussi parce que la suraccumulation provient désormais surtout du capital fictif et que la finance enferme tout le système dans une spirale de destructions, de conflits, de guerres qui finit par nous menacer toutes et tous de mort. Voilà pourquoi vouloir engager une transition socialiste, ce n’est pas seulement répondre à un esprit de justice, c’est répondre à l’appel de la raison, c’est même une question de survie pour l’humanité, pour la vie. On en est là, camarades.
Le socialisme n’est pas qu’un mot, c’est une lutte. Ce n’est pas une fin, mais un processus de transition, long, difficile, qui peut prendre mille formes sur la voie de l’émancipation, sur la voie de la libération du travail de la domination du capital. Parce que le capitalisme, c’est ça, c’est la domination du capital sur le travail.
J’en entends qui diront : on a déjà essayé, et ça a mal tourné. Mais quand au juste le socialisme a-t-il été tenté dans ce pays ? En 1981 ? En 1981, ce que l’on a eu, c’est du mitterrandisme et l’invention du néolibéralisme d’État », mais pas du socialisme. C’est ce que j’explique dans mon dernier livre, En Lutte !.
Et l’URSS, et l’Europe de l’Est, n’est-ce pas un échec, ça ? Si. Ce que je vous dirai à ce sujet, c’est que le capitalisme a mis des siècles à émerger et à se dégager du féodalisme, alors pourquoi le socialisme, lui, avec une ambition autrement plus belle et autrement plus juste, n’aurait-il pas droit, lui, au temps long ? Et d’ailleurs, le socialisme est-il le même partout ? Si c’était le cas, alors il aurait échoué partout. Or, ce n’est pas le cas, ce n’est pas du tout le cas. On fait croire que le socialisme a échoué partout pour que les travailleurs abandonnent la lutte et se soumettent, pour que les peuples du Nord et du Sud croient qu’il n’y a pas, qu’il n’y a plus d’alternative.
C’est là que les expériences de la Chine, du Vietnam et de Cuba sont intéressantes pour nos luttes.
La Chine, c’est la plus grande réussite économique du monde, et même de l’histoire du monde. Nos ennemis disent : la Chine ? C’est du capitalisme ! Alors nous, nous devrions les croire, répéter ça et attribuer le succès chinois au capitalisme ? Mais ces éloges, le capitalisme ne les mérite pas ! Non, ce succès chinois est dû principalement, essentiellement, au socialisme. Aucune des réussites chinoises récentes n’aurait été possible sans une lutte acharnée contre le capitalisme, sans un contrôle strict des capitalistes, sans la révolution socialiste qui a commencé en 1949, qui a extirpé le peuple chinois de la misère et de la guerre, et qui lui a apporté le progrès social, l’éducation, la santé, les infrastructures publiques, l’indépendance, la dignité.
Donc restons modestes – mais pas soumis. Les Chinois disent : on explore une transition longue au socialisme. Cherchons à comprendre, apprenons, soyons respectueux.
Qu’il n’y ait pas ici de malentendu : la Chine est loin, très loin de l’idéal communiste ; il y a beaucoup trop d’inégalités, beaucoup trop de défauts à cette étape de la transition, qui est une étape initiale du socialisme. Mais ce qui est certain, c’est que le peuple chinois et ses dirigeants sont jetés dans la bataille de la transition socialiste. Comment ça finira ? Je n’en sais rien. Mais il est impossible de nier leur volonté. L’histoire n’est pas finie.
D’ailleurs, camarades, imaginez un instant la France avec une propriété des sols et des sous-sols collectivisée ; avec la plupart des grandes entreprises industrielles sociétés d’État ; avec toutes les infrastructures nationalisées ; avec la monnaie, la banque, la finance contrôlées par l’État ; contrôlé aussi le comportement des transnationales étrangères sur le territoire national ; plus la planification et, au sommet du pouvoir, pour superviser un État surpuissant, quoi donc ? Un Parti communiste ! Imaginez-vous notre pays organisé comme ça, c’est-à-dire comme l’est la Chine actuellement. Alors, qu’est-ce qu’on dirait ? Que c’est du capitalisme ? Vous rigolez ! On dirait : c’est du socialisme. Nos ennemis capitalistes diraient même : c’est du communisme ! Disons plutôt que c’est une forme de socialisme de marché, avec des capitalistes bien sûr, mais des capitalistes strictement contrôlés par le pouvoir politique d’un Parti communiste.
La Chine n’est certainement pas communiste, mais elle est en lutte avec le capitalisme pour tenter de le dominer. Il faut essayer de comprendre tout ça, de penser par nous-mêmes et, d’abord, de se libérer de l’idéologie dominante, de l’oppression des médias dominants, qui sont devenus chez nous le premier obstacle à la liberté d’expression.
Au Vietnam, c’est un petit peu la même chose qu’en Chine depuis le « Doi Moi », c’est-à-dire le renouveau du socialisme, un processus d’économie de marché socialiste, commencé après les années très difficiles de l’après-guerre, après que l’armée des États-Unis ait déversé sur le Vietnam trois fois plus de bombes que tous les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale réunis. Et tout récemment, la manière remarquable dont le Vietnam a su faire face à la pandémie de covid19 a été ici, en France, complètement passée sous silence, au prétexte que ce n’était pas possible, au prétexte que les Vietnamiens mentent. Mais c’est notre gouvernement à nous, soumis à la finance et en guerre contre tout un peuple, qui ment !
De ces trois expériences socialistes actuelles, c’est Cuba qui est la plus éloignée du capitalisme. C’est donc logiquement que ce soit contre Cuba que l’impérialisme s’acharne le plus – en lui imposant le blocus. Sans le socialisme, Cuba n’aurait jamais pu tenir après la chute de l’Union soviétique. Mais sans la résistance de Cuba, on ne parlerait plus aujourd’hui de socialisme en Amérique latine. Or, partout sur ce continent latino-américain, les peuples sont debout et luttent pour le socialisme. Regardez la Bolivie et la toute récente victoire de son peuple, magnifique ! On dira : c’est la pénurie à Cuba. Mais c’est le blocus impérialiste qui crée la pénurie à Cuba, pas le socialisme. Il y avait de tout à Cuba avant la chute de l’URSS. Maintenant, Cuba manque de beaucoup de choses, matériellement, mais elle ne manque certainement pas d’esprit de solidarité. Les Italiens le savent bien, tous les pays africains et presque tous les pays du Sud le savent aussi, qui reçoivent depuis longtemps les soins des missions internationalistes cubaines. Chers camarades, Cuba est absolument fondamentale pour nous parce que les Cubains prouvent qu’il est possible de résister.
Ce que nous apprennent ces trois pays, c’est donc :
- D’abord, qu’il faut résister, même si l’impérialisme impose un blocus, même si l’impérialisme a rasé votre pays ;
- Ensuite, qu’il y a une alternative, que cette alternative s’appelle le socialisme, que c’est aux Partis communistes d’assumer leurs responsabilités ;
- Et enfin que le socialisme reste d’actualité, qu’il doit, qu’il peut même dépasser le capitalisme, qu’il n’est pas synonyme d’inefficacité et de pénurie, mais de partage, d’opulence même (une certaine opulence, comme le souhaitait Marx, comme le souhaitait Lénine).
Ce qu’il faut donc comprendre, c’est que le capitalisme est finissant, que le capitalisme agonise, qu’il va déchaîner une violence extraordinaire contre tous les peuples avant de disparaître, et que c’est le socialisme, la solidarité, qui marchent avec l’histoire.
Mais à part ces leçons, importantes, que pouvons-nous tirer plus concrètement de tout cela ? Les expériences socialistes cubaine, vietnamienne et chinoise sont évidemment inexportables, en plus elles sont immensément perfectibles, dans tous les domaines, mais elles nous intéressent parce qu’elles fusionnent trois dimensions clés : la dimension d’émancipation sociale (anticapitaliste), la dimension d’indépendance nationale (antiimpérialiste) et la dimension de l’humanisme égalitaire (antiraciste). C’est l’articulation de ces trois dimensions qui définit leur transition socialiste respective, qui définit leur « projet communiste ». Et même si ces trois révolutions, qui sont toujours debout à l’heure présente, qui tiennent, ont chacune des conditions historiques, socio-économiques et culturelles singulières – ce qui signifie qu’il faudra trouver, nous, en France, nos propres formes de lutte, renouvelées, adaptées pour être plus efficaces face aux défis actuels –, l’analyse des ressorts profonds de ces trois révolutions est, il me semble, utile pour nous. Les trois sont, je l’ai dit : 1. antiracistes ; 2. antiimpérialistes ; 3. anticapitalistes. Ça donne quoi, pour nous ?
- L’antiracisme, bien sûr, parce que combattre le racisme de l’extrême droite et du système est devenu une priorité absolue. Mais pas à la façon de la droite, qui monte les communautarismes les uns contre le autres ; ni comme le fait la « nouvelle droite » social-libérale du PS, antiraciste en paroles, mais dont les actions visent à neutraliser les luttes populaires, surtout dans les cités, dans les quartiers. Non, notre combat à nous contre le racisme n’est pas sociétal, il est politique, il est socio-économique. Et c’est d’ailleurs la même chose d’autres combats fondamentaux, liés, le combat pour la démocratie, celui pour l’égalité homme-femme, celui pour la protection de l’environnement, qui sont à placer, aussi, au cœur de nos luttes communes pour le socialisme. À ce propos, l’Islam politique, comme tous les autres fascismes, ne veut pas du tout rompre avec le capitalisme ; au contraire, il est l’allié et le complice de l’impérialisme. Donc ici encore, le choix du socialisme sera pour nous le plus sûr rempart contre tous les fascismes, y compris contre le fascisme de l’islamisme politique.
- L’antiimpérialisme, ça veut dire non seulement mettre fin à la logique de guerres de l’OTAN sous hégémonie des États-Unis, mais aussi se libérer du joug européen. Je souhaite de tout cœur bon courage à Fabien Roussel au PCF s’il veut parler de socialisme en restant dans la zone euro. L’Union européenne a été construite précisément pour empêcher le socialisme, c’était même son but premier. Bon courage aussi à Laurent Brun à CGT s’il veut rester à la Confédération européenne des Syndicats, eurolâtre, social-libérale, entièrement soumise au capital. Vraiment bon courage à eux deux s’ils veulent réformer l’irréformable. En attendant Godot – cette Europe sociale qui n’arrivera jamais, pour la raison que le cadre européen tel qu’il existe l’interdit –, ce sont la droite et l’extrême-droite qui occupent le terrain de la contestation que nous avons décidé de déserter. Car je rappelle que le concept de souveraineté nationale est né de nos rangs (à Valmy). En fait, la censure du débat sur l’euro n’est pas seulement antidémocratique, elle est simplement suicidaire. Nous ne reconstruirons pas de perspective socialiste, ni même sociale, même modérément sociale, sans remise en cause radicale de l’euro.
- L’anticapitalisme, ça signifie nécessité de rompre avec le système de domination du capital en bout de course, dépassé, devenu presque uniquement destructeur, meurtrier, criminel même. L’alternative anticapitaliste, c’est la transition socialiste. C’est la seule alternative raisonnable. Cela veut dire quoi, pour nous ? Cela veut dire, plus concrètement :
- Des services publics forts, conçus comme conditions de la citoyenneté ;
- La planification, pour l’application d’une stratégie de développement, socialiste ;
- Le contrôle de la monnaie, de la banque et des secteurs stratégiques de l’économie, ce qui implique donc des nationalisations, à repenser totalement par rapport aux expériences passées ;
- Une propriété des ressources naturelles collective et l’urgence d’une protection de la nature ;
- Des formes de propriété certes diverses, mais orientées vers la socialisation des forces productives ;
- Une hausse très forte des revenus du travail, beaucoup plus rapide, avec un objectif de justice sociale, une optique égalitaire ;
- Des relations extérieures garantissant l’échange gagnant-gagnant et fondées sur la paix ;
- Et, bien sûr, une forme de démocratie politique élargie, non pas fictive comme aujourd’hui, mais authentique, largement participative, rendant possibles et concrétisant les choix collectifs stratégiques.
Alors ensemble, délégitimons le capitalisme qui promet l’abondance, mais généralise la pénurie (on voit ce que ça donne en pleine pandémie !). Décrédibilisons ce système capitaliste qui nous vend du bonheur en publicité, mais nous pousse dans la pire crise depuis 1945 ; qui sacralise la liberté individuelle, mais démantèle nos droits, détruit nos services publics, appauvrit de plus en plus d’êtres humains. Déboulonnons ce système archaïque qui parle de démocratie, mais impose la dictature de la finance. Camarades, on n’aménage pas une dictature, on la combat. L’ordre que nous impose le capital financier est, aujourd’hui, une dictature. Notre devoir immédiat à toutes et tous est de nous unir pour y mettre fin.
L’intervention de Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots

Intervention liminaire : Le capitalisme répond-il aux besoins des salariés et de la population ?
Non évidemment. Il ne répond pas aux besoins individuels puisque les salaires sont insuffisants. On le voit en ce moment avec les personnels de santé qui quittent leur métier, parce que leur salaire ne leur permet plus de vivre au regard des contraintes de leur poste. On le voit aussi avec les nombreux emplois non pourvus dans le bâtiment, la restauration ou les services. Et on le voit encore plus crument avec les 2,1 millions de travailleurs pauvres que compte notre pays, pourtant 6ème ou 7ème puissance mondiale !
Il ne répond pas non plus sur les conditions de travail qui ne sont pas bonnes et qui ne s’améliorent pas avec le temps. Par exemple, l’automatisation des caisses dans les banques et les grandes surfaces, n’est pas déployée pour améliorer les conditions de travail mais au contraire pour accroître la pression pour la productivité des travailleurs.
Donc, le capitalisme ne répond pas à ces besoins individuels. Et il ne répond pas non plus aux besoins collectifs. Les salariés ne sont pas maîtres de leur production. C’est le système qui organise les capacités de production, et il le fait selon la profitabilité qu’il espère en retirer. Donc il y a de plus en plus de divergences entre les productions et les besoins réels du pays :
- Des activités sont purement et simplement détruites. Par exemple, dans le transport, pour des questions fiscales et règlementaires, la route est presque systématiquement privilégiée et le transport ferroviaire disparait alors que les enjeux environnementaux justifieraient le contraire.
- D’autres activités sont délocalisées. Par exemple, dans l’automobile, alors que nous produisons 400 000 véhicules de moins que ce que nous immatriculons chaque année, on continue à fermer des usines.
- Pendant la crise, on a vu la même chose avec les médicaments, les matériels de santé, mais aussi des choses très basiques comme les sacs en papier de farine. En France, on a des moyens de transport, on a du blé pour faire de la farine, et on a des usines qui produisent cette farine, mais la production des sacs en papier d’emballage ayant été délocalisée en Chine, on avait une pénurie dans les commerces parce que les frontières étaient fermées !
- D’autres activités sont au contraire très excédentaires par rapport aux besoins. C’est probablement le cas de l’industrie du luxe et de celle de l’armement.
On ne voit pas ces déséquilibres que dans l’industrie, mais aussi dans les services. Par exemple, les EPHAD sont notoirement sous-développés par rapport aux besoins liés à la dépendance. Ou encore dans la recherche : les labos se font concurrence sur le vaccin COVID, pour être les premiers à poser leurs brevets, mais si on ne sort pas des lois du marché pour diffuser le vaccin notamment aux pays d’Afrique, l’OMS avertit que la pandémie va se poursuivre malgré ces découvertes !
Et malgré la profitabilité des entreprises, le système ne développe plus les investissements productifs. Depuis la fin des années 90, le taux d’investissement a totalement décroché du taux de marge : en 1980, les investissements représentaient 22% pour 25% de marge ; en 2015, c’est 23% d’investissements pour 34% de marge. La marge s’est développée au détriment du salaire et cela n’a profité en rien à la société, au contraire !
Pour terminer, le système fragilise l’organisation des entreprises elles-mêmes : les logiques de 0 stock, flux tendus, sous-traitance en cascade, sont efficaces du point de vue capitalistique, mais pas du point de vue industriel. Elles permettent de segmenter la chaine de valeur et de ponctionner un profit à chaque étape, mais du point de vue de la productivité technique, les entreprises seraient bien plus efficaces sans cette atomisation. Donc il y a de plus en plus de profit, mais de moins en moins d’emplois et de moins en moins bonne qualité.
Quelle est la réponse syndicale à cette inefficacité du système ?
Les syndicats contestent les licenciements, la casse des droits sociaux, ils manifestent, pétitionnent et appellent à la grève. Ils développent aussi des démarches plus offensives avec des revendications sur l’organisation de la production, les investissements, l’emploi, la répartition des richesses, voire même des projets complets de filières.
Cette activité est insuffisante mais elle n’est pas négligeable. En 2018, il y a eu beaucoup de conflits sectoriels durs : la pénitentiaire, les cheminots, les journées nationales des fonctionnaires, les journées nationales des retraités, un mouvement lycéen, des séquences nationales de grève à Air France, et puis les Gilets Jaunes. En 2019 aussi, avec le conflit de Radio France, les journées des pompiers, les journées de la santé où les hôpitaux tiraient déjà le signal d’alarme, puis il y a eu le conflit des retraites.
En France, 10 à 11% des salariés sont syndiqués. Même si c’est en recul par rapport à d’autres périodes, cela traduit tout de même le besoin de s’organiser pour disposer d’un contre-pouvoir à l’arbitraire patronal.
Ces réactions syndicales sont-elles suffisantes ?
Non, elles ne le sont pas. D’abord parce que les revendications buttent sur le fonctionnement du système : il ne s’agit pas simplement d’avoir le rapport de force face à son employeur. Il faut aussi dépasser le contexte économique (les relations clients-fournisseurs, les menaces de fermeture d’entreprise, de rachat…). On connait bien le discours : on ne fait pas assez de profit, l’action baisse, on risque d’être rachetés, donc on est tous dans le même bateau, il faut faire des efforts… même si les sacrifices sont toujours du même côté. Et il faut parfois dépasser les lois et règlementations, qui sont elles-mêmes le produit d’un rapport de force qui n’est pas souvent favorable aux salariés. Par exemple, les règles de concurrence européennes empêchent théoriquement toute possibilité de monopole public ou de politique publique en dehors des règles de marché. C’est également le cas avec la liberté de commerce ou la liberté d’entreprendre en France qui complexifient un certain nombre de luttes et bloquent certaines revendications.
Le système capitaliste, ce n’est pas seulement un mécanisme économique, c’est tout un écosystème de pouvoirs, de règles techniques, juridiques et administratives, etc. Les revendications sont entravées par cet écosystème. Elles débouchent souvent sur des compromis, plus ou moins favorables, et immédiatement menacés par la lutte des classes que mène de manière ininterrompue le patronat. Donc pour aller au bout de la satisfaction des revendications, il est indispensable de changer le cadre, les règles, de faire sauter les entraves.
Par ailleurs, si nous affirmons que le système capitaliste organise mal les choses, ne répond pas aux besoins, limite la satisfaction des revendications, alors il est nécessaire de passer à un autre système, à d’autres mécanismes et d’autres règles. Lorsque nous revendiquons la nationalisation d’une entreprise importante menacée de liquidation, par exemple, nous le faisons un peu. Mais nous restons limités parce que nous n’osons pas aller plus loin que l’étatisation. Or pour être convaincants, il faut aller au fond des choses.
Certains défendent un syndicalisme de lobbying, y compris pour peser sur les lois. Mais cela nous place toujours en situation de compromis. Et qui plus est, un compromis passé avec ceux qui détiennent le pouvoir légal, souvent à la botte des capitalistes, donc qui ne remettront pas en cause les intérêts capitalistes en profondeur. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire du tout. Nous avons défendu le code du travail contre la loi travail ou autre. Mais ça veut dire que ça ne peut pas être l’objectif de notre démarche, son aboutissement.
Même dans le cas de réformes extrêmement progressistes, comme la création de la Sécurité sociale, il a fallu faire des concessions aux agriculteurs, aux indépendants et aux cadres, il a fallu accepter le maintien d’une industrie pharmaceutique qui se comporte comme un parasite de l’assurance sociale, un réseau de soins déséquilibré par le maintien de la médecine générale libérale, et très rapidement la gestion ouvrière a été remise en cause. Aujourd’hui c’est l’étatisation qui guette. Donc pour ne pas être soumis en permanence aux limitations et aux remises en cause, il faut plus qu’une réforme, il faut une rupture systémique.
Quelle rupture ?
Il nous faut un autre système avec des règles qui permettent le développement économique et social sans concentration du capital et du pouvoir, qui nous sortent progressivement de l’encouragement à l’égoïsme et à la vénalité. Pour moi ce système c’est le socialisme, qui prépare le passage à la société sans classe.
Depuis la fin des années 90, les capitalistes ont le rapport de forces et l’hégémonie idéologique parce que nous avons été privés de capacité à penser cet autre système. La pression idéologique est colossale : le socialisme, c’est la dictature, les millions de morts, la ruine, les tickets de rationnement, la bureaucratie corrompue, etc… Récemment, ils ont même fait voter une directive européenne qui assimile communisme à nazisme ! Donc si vous êtes pour un autre système que le capitalisme, vous êtes un nazi ! Il n’y a pas d’alternative, nous sommes interdits de penser autrement. Et cela influence forcément les moins politisés et les moins conscients des militants.
Du coup, privées de perspective transformatrice, les luttes sont essentiellement défensives, et assez souvent perdantes. Ce n’est pas dénigrer nos luttes que de dire ça. J’ai moi-même conduit plusieurs conflits importants, je pense que c’était nécessaire, j’en suis fier, et nous avons fait tout ce que l’on a pu pour gagner car rien n’est jamais écrit à l’avance. Mais si l’on veut être objectifs, il faut reconnaitre que les luttes récentes n’ont pas obtenu satisfaction.
Cela créé un effet domino de la défaite, on se concentre sur ce qui est le plus accessible, le local, les préoccupations immédiates. Là encore, c’est nécessaire de batailler sur les méfaits concrets du capitalisme et des choix d’entreprise, mais ça n’est pas suffisant. Si on se contente de cela, on finit par accepter que les capitalistes dirigent la société, et on en est réduit à accompagner la mise en œuvre dans le cadre fixé, en ne traitant plus que les conséquences sociales et seulement pour en limiter la nocivité.
Je rajoute que ne pas nommer l’alternative crée aussi des illusions. Certains hommes politiques (c’est vrai aussi pour certains leaders syndicaux ou associatifs) critiquent le système mais restent silencieux sur ce qu’ils défendent. Ils sont anti-libéraux, ennemis de la finance, ou anti-mondialisation (comme Montebourg récemment), mais ils ne s’affirment ni marxistes, ni favorables au socialisme. Sauf qu’il n’y a pas beaucoup d’autres théories économiques. Une fois au pouvoir, ils se révèlent au mieux keynésiens, au pire néoclassiques : leurs choix sont donc guidés par ces analyses économiques et ils produisent les mêmes politiques que leurs prédécesseurs.
Donc les salariés sont déçus, ils considèrent cela comme une trahison (alors qu’il s’agit en fait d’une fidélité à leur vision économique), ils mettent tout le monde dans le même panier et ce sont les fascistes qui progressent dans cette ambiguïté idéologique. Donc même si tout ne repose pas sur nos épaules, je pense que la dynamique de défaite syndicale et la progression du fascisme sont aussi liées au recul idéologique des communistes, au recul de la pression qu’ils mettaient dans la bataille des idées pour le socialisme.
Nous avons besoin de nous réarmer idéologiquement. Il faut réaffirmer la nécessité du socialisme, pour clarifier les positions de chacun, et aussi pour dédramatiser ce terme. Il faut aussi rediscuter de son contenu, à la lumière des expériences passées ou actuelles, pour redonner des perspectives à nos combats quotidiens.
Seconde intervention dans le débat
Concernant la Chine, comme tous les autres pays d’ailleurs, je pense comme Danielle qu’il faut que nous fournissions plus de travail. Je connais peu de chose de la Chine, j’ai aussi des doutes et des interrogations, mais on manque de travaux fiables et concrets pour alimenter nos réflexions.
Or d’après les quelques recherches que j’ai pu faire sur ce pays, le salaire moyen y est passé de 1 000$ par an à 10 000$ en quelques années. On est encore très loin des plus de 40 000$ français, mais c’est beaucoup mieux que l’Inde qui stagne à 2 000$ et que beaucoup d’autres pays non industrialisés qui pratiquent des politiques libérales qui ne leur permettent pas de décoller.
De la même manière, il y a 20 ans il y avait 0 km de ligne à grande vitesse ferroviaire en Chine. Aujourd’hui il y en a 36 000 km et l’objectif est de 70 000km en 2035. Pour comparaison, en 40 ans, nous en avons construit 2 600km en France. Même rapporté à la population, les Chinois font mieux que nous, alors que nous sommes une nation bien plus industrialisée qu’eux à la base.
Ce sont des réalisations pratiques. Seront-elles accaparées par les capitalistes à la fin, je n’en sais rien. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas. Évidemment, pour ne pas tomber dans la recherche d’un modèle, nous devons d’abord réfléchir à ce que nous voulons en France ? Est-ce que l’on reparle de l’appropriation des grands moyens de production et d’échange ? C’est par exemple ce qui a donné les services publics. Or, aujourd’hui, nous nous battons de manière très défensive sur cette question. Les services publics ça ne peut pas être seulement l’énergie, les transports, l’hôpital ou l’école. Nous devons bousculer les capitalistes, les attaquer sur leurs fondements, montrer les contradictions de leur système face aux attentes de la population.
Par exemple, la grande distribution serait un service public extrêmement utile. Par son poids dans la logistique, elle permettrait d’orienter les flux de marchandises sur les modes de transport moins polluants. Au lieu d’acheter le plus loin possible dans les pays à bas coût de main d’œuvre, elle pourrait être un instrument de la consommation locale, etc. La socialisation de la grande distribution est probablement une condition pour répondre aux enjeux environnementaux. Sinon, on laisse cela aux initiatives individuelles et il n’y a aucun progrès.
De la même manière, nous utilisons internet et les outils numériques. Or l’un des enjeux de l’économie de demain, c’est le traitement des données générées par ces flux. Aujourd’hui tous les « clouds » sont privés et pratiquement tous américains. Pourquoi ne pas imaginer un État Civil 2.0 qui soit chargé du stockage des données, de ne pas en stocker trop pour limiter la consommation énergétique, et de s’assurer que leur utilisation n’est pas à but mercantile mais bien pour améliorer la vie des gens ?
Le socialisme doit être vivant et original.
Concernant les luttes, il n’y a pas de recette miracle. Déjà, il faut bannir les slogans et les raccourcis. Non il ne suffit pas d’appeler à la grève générale pour qu’elle advienne. Nous devons reconstruire un parti dans lequel on s’affute idéologiquement par le débat, dans lequel on cherche à construire une ligne c’est-à-dire à identifier les meilleures idées et que tout le monde se réfère à ce produit collectif.
Ensuite nous devons reconstruire un parti dans lequel les pratiques d’organisation sont une force essentielle. Ni les résultats électoraux, ni l’audience médiatique, ni tout autre palliatif, ne doivent nous écarter de cette priorité. Nous devons développer des formes d’organisation et des processus de décision qui nous permettent de mobiliser efficacement les militants, même s’ils sont peu nombreux au départ, et bien sûr de renforcer ce nombre. Les communistes sont pour moi les militants qui érigent l’organisation au rang de science ! Mais nous avons énormément reculé sur cette question.
Enfin, si nous ne pouvons pas faire de grandes démonstrations de force, nous devons, dans un premier temps, nous contenter de faire de l’agitation sur les contradictions du capitalisme. Mais il faut que cette agitation soit coordonnée et que son contenu provoque réellement des débats.
Dernier point concernant les Gilets Jaunes. Comme je l’ai dit au départ, pour moi ils ne sont pas un mouvement révolutionnaire, ils sont un mouvement sectoriel puissant, au même titre que d’autres mouvements. Et ils sont traités par le pouvoir de la même manière : au départ le Gouvernement est effrayé, il procède à quelques concessions (mais je conteste formellement que les GJ ont obtenus plus que les luttes syndicales classiques), puis dès qu’il a l’assurance que le mouvement ne s’étendra pas, il durcit sa position et mise sur le pourrissement et la répression. Il a fonctionné de cette manière avec tous les conflits de 2018. Et effectivement le mouvement des GJ a pourri. Donc c’est un événement important et positif, car il survient dans un secteur que l’on ne pensait pas mobilisable (le lumpenprolétariat et les indépendants). Mais ça n’en reste pas moins un mouvement sectoriel.


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)