Un message électronique d’Alberto Dines m’a amené à lire, très lentement, L’Homme qui aimait les chiens * de Leonardo Padura.
J’avais lu certains de ses romans policiers ; j’admirais l’écrivain mais le citoyen ne m’inspirait pas de sympathie. Je m’interrogeais : quel livre cela pouvait-il bien être, qui avait été accueilli avec enthousiasme par la critique en France, en Espagne (10 éditions), au Brésil, au Portugal ?
Je compris ensuite. Je crois ne pas avoir lu ces dernières années un roman à propos duquel il soit aussi difficile d’écrire ce que j’ai ressenti.
Le livre compte plus de 600 pages. La difficulté provient du fait d’avoir changé d’opinion pendant que j’avançais dans la lecture. Le roman est une boîte à surprises qui sème des questions sans réponse.
Dans la première partie, le talent littéraire de l’auteur m’a beaucoup impressionné. Mais, par la suite, l’admiration fut accompagnée d’un grand malaise. Comment expliquer la contradiction apparente ?
Deux personnages traversent le livre : Trotsky et le Catalan qui l’assassina en 1940, Ramón Mercader, le « héros » du roman.
Padura a recours à une technique innovatrice dans sa fiction. L’un des narrateurs, Iván Cárdenas, est un Cubain, écrivain frustré qui sur une plage de l’Est de la Havane, a écouté l’histoire du crime rappelée par un ami de Montaner qui est en réalité Mercader lui-même.
En élaborant une architecture fictionnelle complexe, Padura s’est inspiré de l’histoire réelle et de l’histoire entendue pour construire un roman déjà traduit en plusieurs langues.
Les récits sont parallèles mais interconnectés : la vie tragique de Trotsky depuis son exil au Kazakhstan en 1928 jusqu’à l’assassinat à Mexico en 1940 ; et la métamorphose de Ramón Mercader, la Catalan d’origine aristocratique qui depuis la bataille de Madrid a évolué sans formation idéologique vers le fanatique opérationnel du NKVD (précurseur du KGB) qui tua Trotsky avec une pioche.
Iván, le narrateur cubain, révèle, dans la réflexion sur sa vie, son éloignement de la Révolution. Non seulement il désapprouve mais désire la fin du socialisme, d’un régime auquel il impute la responsabilité de la pauvreté, du retard, de la corruption, de la peur qui, pense-t-il, se répand comme la lèpre à travers l’île. Il ressent de l’aversion pour le communisme.
La méditation est celle d’Iván mais ses idées, ses critiques et ses aspirations sont celles de Padura.
L’écrivain, comme la grande majorité des jeunes de sa génération, a appuyé la Révolution à ses débuts. Mais il a bientôt été désenchanté. Le Parti, ses dirigeants, le discours marxiste, l’influence soviétique, ont mis fin à ses illusions et aspirations juvéniles.
J’ai connu à Cuba, pendant mon séjour prolongé sur l’île, de nombreux intellectuels qui sont passés de l’adhésion à la désillusion.
Je ne condamne pas tous ceux qui ont renoncé à la militance révolutionnaire. L’homme est un être en permanente mutation. Mais les transformations idéologiques ne sont pas uniformes ; elles diffèrent beaucoup.
Le roman de Padura me rappela des conversations avec Lisandro Otero, un grand écrivain. De révolutionnaire passionné, discipliné, qui remplit des fonctions diplomatiques en Europe et en Amérique Latine, il s’achemina lentement vers un scepticisme qui transparaissait dans des articles publiés dans Le Monde diplomatique.
En lisant son roman El Arbol de la Vida je le sollicitai chez lui pour essayer de comprendre ce qui l’avait conduit de l’apologie à la critique. Sa réponse, confuse, hésitante, ne m’éclaira pas. Le message de son roman est pessimiste : des générations successives sont passées à Cuba, depuis l’époque coloniale, de la rébellion au conformisme, à la rupture avec la morale et l’éthique. Pourquoi ? Parce que, selon Lisandro, toutes les révolutions finissent par dévorer ceux qui osent défier l’ordre préexistant.
Néanmoins, Lisandro Otero, naturalisé mexicain, inversa le cap dans les dernières années de sa vie, il reprit la défense de la Révolution. Et le prix national de littérature lui fut attribué.
Danton, contrairement à Lisandro, ne récupéra pas l’espoir après l’avoir perdu. Il avait enterré l’idée de révolution comme utopie. Il apparaît dans l’Histoire comme antithèse de Robespierre.
Le chemin de Trotsky est sinueux, dans certaines phases presque incompréhensible, mais il mourut en croyant à la révolution mondiale comme but à la portée de l’homme.
L’ENIGMATIQUE PADURA
Padura (à qui le gouvernement de Rajoy a concédé la nationalité espagnole) déconcerte le lecteur. Il s’éloigne du style de l’anticommunisme traditionnel. Pour convaincre il utilise un processus qui l’éloigne des historiens antisoviétiques comme l’Américain Robert Conquest et d’écrivains comme le Russe Soljenitsyne qui, pour exorciser le socialisme n’hésite pas à attribuer à la Révolution Française de 1789 l’origine de tous les maux qui culmineraient dans la Révolution Bolchévique d’Octobre 1917.
Padura s’est efforcé de couvrir son livre du manteau du sérieux qui donna du prestige au roman historique de Walter Scott et Victor Hugo à Tolstoï. Il se prépara pendant de nombreuses années pour écrire de 2006 à 2009 son œuvre définitive.
Il étudia le marxisme. Il connaît l’Histoire des Révolutions russes, il a beaucoup lu sur la génération de révolutionnaires professionnels qui accompagnèrent Lénine dans le grand défi de 1917. Presque tous (Kamenev, Zinoviev, Rikov, Preobragensky, Piatakov, Radek, Rakovsky, entre autres) furent accusés, dans les Procès de 36, 37, 38, de trahir la Révolution. Et, à l’exception de Radek, fusillés.
Padura a réuni une documentation importante. Il a visité l’URSS. Il a eu accès aux archives soviétiques quand Yeltsine les ouvrit. Je constate que certaines de ses citations reproduisent les textes originaux. Son livre révèle une connaissance précise de la ville de Moscou. Cette rigueur apparente dans le montage du roman contribue à inspirer confiance au lecteur en le persuadant habilement que ce retour à Trotsky recrée dans une œuvre de fiction le révolutionnaire et l’homme.
Néanmoins, cette conclusion ne respecte pas l’Histoire. Le Trotsky de Padura est un personnage très différent du Trotsky réel. Il y a de l’exactitude dans l’évocation de l’itinéraire de l’exilé, érigé par Staline en ennemi numéro un. Il l’accompagne dans l’exil, en Turquie, en France, en Norvège, et dans ses dernières années à Coyoacán, au Mexique.
Mon ami brésilien l’écrivain Alberto Dines, en exprimant sa considération pour le talent de Padura, souligne « l’extraordinaire travail de recherche et de montage littéraire ».
Le commentaire est pertinent. Mais Padura n’est pas un historien. Il déforme de façon captieuse Trotsky. En abusant de la liberté de l’écrivain il attribue au révolutionnaire exilé, dans ses méditations sur le passé, des repentirs et des doutes incompatibles avec sa personnalité et sa clairvoyance.
Padura transcrit un paragraphe d’un document politique, presque un testament, dans lequel il affirme : « Je mourrai-écrivit-il-en étant un révolutionnaire prolétarien, un marxiste, un matérialiste dialectique ».
L’affirmation est claire. Mais Padura insinue que Trotsky devait se repentir de sa responsabilité dans la répression des marins de Kronstadt de 1921 et de son manque de fermeté dans la défense des syndicats pendant le débat sur le thème au Comité Central. En réalité, Trotsky fut l’un des adeptes de la répression implacable du soulèvement de Kronstadt et Lénine le critiqua pour avoir pris l’initiative de la militarisation des syndicats pendant la guerre civile.
Dans un chapitre de son livre l’écrivain suggère que Trotsky, en repensant au passé, était assailli de doutes angoissants sur la viabilité du projet communiste. Padura lui attribue des pensées comme celle-ci : « Le marxisme serait-il seulement une « idéologie », une sorte de fausse conscience qui menait les classes opprimées à croire qu’elles luttaient pour leurs propres fins, quand en réalité elles favorisaient les intérêts de la nouvelle classe au pouvoir ? » (page 417).
AMBITION DÉMESURÉE
Padura a consacré trois ans à écrire son roman mais il a conçu le projet bien longtemps avant. Il a parcouru le monde, de Barcelone à Mexico, en passant par Moscou et Paris, à la recherche d’inspiration (et de contacts) pour s’imprégner de l’atmosphère des lieux où Merceder-Mornard s’était préparé pour son entrée dans l’Histoire.
Il brûlait d’une ambition démesurée. Il crut qu’il allait construire une cathédrale de la littérature. Il espérait peut-être s’élever au niveau de Gorki ou de Tolstoï. Il n’atteignit pas le but. Ecrivain de grand talent, il ne parvint pas à produire une grande œuvre.
Le roman captive par la technique, par un suspense qui relève un peu de John Le Carré. Les protagonistes –Ramón Merceder (déguisé en Mornard-Jacson), sa mère Caridad Mercader, le Russe Kotov (aussi appelé Tom, Grigoriev, Roberts, Eitingon), responsable de l’Opération Canard, montée pour l’attentat de Coyoacán, sont très élaborés. Mais Sylvia Ageloff, la jeune trotskyste maîtresse de Mercader, une femme intelligente, surgit comme une figure d’idiote, comme une caricature.
Les références à Frida Kahlo, même à la brève relation amoureuse-sexuelle que la grande peintre vécut avec Trotsky, ont quelque chose de feuilletonesque. Le Trotsky du roman est artificiel ; les agents secrets soviétiques, par leur perversité et manichéisme, ne sont pas convaincants. Padura exagère tellement dans sa diabolisation du NKVD (héritier de la Tcheka) qu’il n’atteint pas l’objectif.
J’ignore les voyages de l’écrivain pour se documenter et chercher l’inspiration. Mais la minutie dans les références aux villes comme Barcelone, Madrid, Moscou, Paris, New-York et Mexico DF est elle que le lecteur finit par croire que Padura connut intimement les quartiers, les jardins, les rues, les hôtels, les restaurants par où est passé son « héros » postulant assassin.
Dans la Ville de Mexico j’eus l’opportunité de visiter à Coyoacán la Maison Bleue de Frida Kahlo et la maison forteresse où résidait Trotsky quand on le tua. Ce sont des lieux qu’on n’oublie pas. Je me rappelai des détails des deux en lisant les pages où Padura décrit le moment où Mercader enfonça le crâne de Trotsky avec la pioche d’alpiniste qu’il portait dans sa gabardine. Je fus envahi d’un sentiment de répulsion, de nausée et de malaise.
UNE FIN DE FEUILLETON
Le roman perd de la qualité comme œuvre littéraire dans la troisième et dernière partie, L’Apocalypse. Ramón Mercader soutint devant le chef de la Police secrète et le Tribunal que l’initiative du crime fut exclusivement la sienne. Il ne parla pas sous la torture. Dans les trois prisons par lesquelles il passa il déclara toujours être Belge et s’appeler Jacques Mornard, bien que la justice mexicaine sût depuis longtemps qu’il était le Catalan Ramón Mercader.
Après avoir fait les 20 ans de prison auxquels il fut condamné, il voyagea à Moscou où Khrouchtchev lui concéda l’Ordre de Lénine et le titre de héros de l’Union Soviétique.
Le fait qu’il fît ensuite de longs séjours à Cuba doit avoir contribué à éveiller l’intérêt de Leonardo Padura.
Inadapté au climat russe, il demanda à Fidel l’autorisation de résider à Cuba et la demande fut acceptée (il décéda à La Havane en 1978 d’un cancer très agressif).
Son séjour sur l’Ile doit avoir contribué à éveiller l’intérêt de Padura envers le fameux aventurier. Mais il n’y a pas d’indices qu’il ait renoncé à ses convictions politiques.
Néanmoins, Padura dans son roman soumet Mercader à une radicale métamorphose idéologique à son arrivée en URSS.
Selon l’écrivain, quand il rencontre à nouveau Eitingon à Moscou en 1968, à une époque où il tire profit de privilèges exceptionnels comme héros de l’URSS, l’ex-agent secret, qui avait consacré sa vie au communisme et idolâtrait Staline, il a avec son ancien tuteur des dialogues qui surprennent le lecteur, dans lesquels est visible la frustration des deux hommes et leur rupture psychologique et idéologique avec le régime soviétique.
Eitingon raconte qu’après la mort de Beria, il passa 15 ans emprisonné. Et il avoue à son camarade qu’il lui a menti. Il lui dit que Staline désirait qu’il fût abattu par la sécurité de Trotsky parce que vivant il serait gênant et il pourrait parler.
Mercader et Eitingon, en évoquant des épisodes historiques, ne parlent pas comme des révolutionnaires déçus ; ils s’expriment avec la rancune de victimes de ce qu’ils considèrent comme un engrenage broyeur qui les aurait utilisés comme de simples instruments.
Je transcris deux réflexions de Mercader : « la confession de ce que non seulement il avait été utilisé pour accomplir une vengeance mais aussi considéré comme une pièce bien plus qu’inutile fit sombrer la dernière bouée de sauvetage qui l’unissait à ces années pleines de désillusions et de découvertes douloureuses » (page 567).
« Il sentit la désillusion le miner de l’intérieur. Les vestiges de l’orgueil, sur lequel, malgré les doutes et la marginalisation, il s’était appuyé, s’évaporaient peu à peu à la chaleur de vérités trop cyniques » (page 568).
C’est le langage de quelqu’un qui ne se sentait plus communiste. Il est clair pour moi que celui qui parle pour Mercader et Eitingon est Leonardo Padura, l’écrivain cubain qui hait –c’est le mot- le socialisme et le communisme.
Un ami cubain, commentant la motivation de « ceux qui s’en vont ou restent opposants », m’a écrit dans une lettre récente :
« Une bonne partie le fait parce que c’est le chemin de la célébrité, qu’elle soit méritée ou non (…) parfois c’est aussi la voie pour un gain économique supérieur (…). Une situation qui procure beaucoup de dividendes c’est de marcher comme le border line ».
J’ai pensé à Maduro en lisant cette lettre.
Je note que la qualité littéraire de son roman faiblit beaucoup dans le dernier chapitre, quand Padura revient au narrateur Iván (qui meurt).
Une remarque personnelle :
J’ai désapprouvé depuis ma jeunesse, avant d’adhérer au Parti, la trajectoire de Trotsky.
Plus tard j’ai lu beaucoup de ses livres et j’ai critiqué dans des articles et conférences sa pensée politique, son frénétique antisoviétisme et la création de la IV Internationale.
Je vois dans les multiples organisations trotskystes des groupes si négatifs que Trotsky lui-même ne se reconnaîtrait pas en eux.
Mais j’ai toujours condamné la féroce persécution dont fut cible Trotsky, comme je condamne l’élimination par Staline de son nom dans l’Histoire et les accusations absurdes de complicité avec le nazisme.
Les erreurs, l’intolérance, l’arrogance de Trostky ne m’empêchent pas de reconnaître qu’il fut un révolutionnaire dans l’erreur, qui s’assuma jusqu’à la fin comme marxiste et communiste.
J’ajouterai à cette opinion que les méthodes, erreurs et crimes de Staline ne peuvent occulter l’évidence que ce fut un révolutionnaire qui vécut pour la cause du communisme et qui eut un rôle décisif dans la défaite du Reich hitlérien, dans la victoire qui sauva l’humanité de l’horreur fasciste.
*Leonardo Padura, O HOMEN QUE GOSTAVA DE CAES, Porto Editora, 2011
Vila Nova de Gaia, 16 avril 2015
Traduit en français par Rose-Marie Serrano


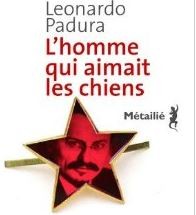

![Tous marxistes sans le savoir ? [ le coco masqué #1 ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250515-capitalisme-savoir-science-coco-masque-1-350x250.jpg)
![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)


