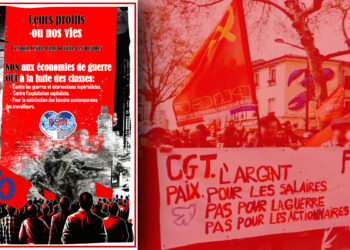www.initiative-communiste.fr vous propose de retrouver présenté en 5 parties un article du philosophe marxiste Georges Gastaud, publié par la revue Etincelles nous proposant de revenir à la « dialectique de la nature ». Friedrich Engels, en approfondissant ses travaux sur le matérialisme dialectique a livré des travaux inachevés réflexion à propos de la science, dans une série de texte rassemblée dans une oeuvre intitulée « dialectique de la nature » (à lire ici). Lénine, dans matérialisme et empirocritiscisme abordait également ces thématiques, utiles tant à la philosophie qu’à la science. Georges Gastaud emmène ici le lecteur de façon moderne et didactique le lecteurs dans une réflexion solide mais toujours abordable. jour après jour, de quoi lire et réfléchir au cœur de l’été.
www.initiative-communiste.fr vous propose de retrouver présenté en 5 parties un article du philosophe marxiste Georges Gastaud, publié par la revue Etincelles nous proposant de revenir à la « dialectique de la nature ». Friedrich Engels, en approfondissant ses travaux sur le matérialisme dialectique a livré des travaux inachevés réflexion à propos de la science, dans une série de texte rassemblée dans une oeuvre intitulée « dialectique de la nature » (à lire ici). Lénine, dans matérialisme et empirocritiscisme abordait également ces thématiques, utiles tant à la philosophie qu’à la science. Georges Gastaud emmène ici le lecteur de façon moderne et didactique le lecteurs dans une réflexion solide mais toujours abordable. jour après jour, de quoi lire et réfléchir au cœur de l’été.
Aujourd’hui, la première partie de cet article
Retour à la dialectique de la nature
 Durant plusieurs décennies, l’idée de dialectique de la nature n’a suscité qu’indifférence ou mépris dans les milieux universitaires. Pour les philosophes de type traditionnel, cette expression faisait figure de contradiction dans les termes : la dialectique relevant du registre de la logique, elle ne pouvait évidemment pas concerner la nature : car comment la matière, étrangère par définition à l’ordre du discours, pourrait-elle être en rien concernée par la contradiction et la négativité ? De même n’est-il pas absurde d’attribuer une histoire à la nature alors que des générations de philosophes ont appris en classe terminale que l’historicité est l’apanage du sujet humain ?
Durant plusieurs décennies, l’idée de dialectique de la nature n’a suscité qu’indifférence ou mépris dans les milieux universitaires. Pour les philosophes de type traditionnel, cette expression faisait figure de contradiction dans les termes : la dialectique relevant du registre de la logique, elle ne pouvait évidemment pas concerner la nature : car comment la matière, étrangère par définition à l’ordre du discours, pourrait-elle être en rien concernée par la contradiction et la négativité ? De même n’est-il pas absurde d’attribuer une histoire à la nature alors que des générations de philosophes ont appris en classe terminale que l’historicité est l’apanage du sujet humain ?
Quant aux marxistes, ils avaient appris à regarder avec méfiance tout ce qui, de près ou de loin, semblait associé au diamat, un acronyme russe signifiant » matérialisme dialectique » mais désignant en français depuis la » déstalinisation » la version dogmatique de la philosophie marxiste en usage sous Staline. A la suite de Roger Garaudy, certains philosophes communistes s’engageaient alors dans une révision idéaliste du marxisme en privilégiant les œuvres de jeunesse de Marx et en recentrant leur interprétation du marxisme sur une conception purement anthropologique de la catégorie d’aliénation. D’autres, avec Althusser, empruntèrent le chemin en apparence inverse d’une révision scientiste et théoriciste de la philosophie marxiste, qu’ils prétendaient expurger de ses naïvetés idéalistes et hégéliennes ; au nombre de ces dernières, ils plaçaient l’idée d’une logique dialectique prétendant à l’universalité objective et ils répudiaient dans la foulée toute ontologie, toute conception du monde matérialiste-dialectique. Dans ces conditions, l’accès à la dialectique de la nature semblait définitivement muré puisque si les uns déclaraient incurablement dogmatique l’idée de dialectique de la nature, d’autres reléguaient au rang de scorie spéculative et métaphysique l’idée de dialectique de la nature ! Il n’y eut guère alors que le concept de reflet, clé de voûte de la théorie matérialiste de la connaissance, qui réussît à soulever contre lui autant de rejet méprisant parmi les intellectuels bien-pensants et autres » marxologues » ralliant à petit pas l’idéologie dominante !
Ce blocage intellectuel était encore aggravé par la méconnaissance profonde des écrits d’Engels dans laquelle se complait l’Université philosophante. Jusqu’à nos jours, celle-ci considère ce puissant penseur, savant et révolutionnaire, au mieux comme le » second couteau » de Marx, au pire comme un vulgarisateur dogmatique du matérialisme historique. Quant aux travaux de valeur des philosophes soviétiques, yougoslaves, cubains, vietnamiens ou est-allemands sur le matérialisme dialectique en général et la dialectique de la nature en particulier, c’est peu dire qu’ils étaient et restent superbement ignorés de la quasi-totalité des philosophes occidentaux que n’effleure même pas l’idée saugrenue qu’on puisse avoir pensé quoi que ce soit de 1945 à 1991 entre Berlin-Est et Vladivostok…
Il se pourrait cependant que ces platitudes anti-dialecticiennes volassent assez vite en éclats sous la poussée des sciences de la nature en vif essor (physique des particules, astrophysique et cosmologie, biologie générale, anthropologie préhistorique, neurologie). Comme Galilée lançant au Grand Inquisiteur la célèbre formule » et pourtant elle tourne « , la dialectique de la nature, qui est réalité avant d’être concept, reprend force et vigueur de jour en jour. Dans son livre inachevé Dialectique de la nature, Engels nous en avait tranquillement averti : » dans la nature, les choses se passent, en dernière analyse, dialectiquement et non métaphysiquement « . Quant à Lénine, il affirmait non moins sereinement dans Matérialisme et empirio-criticisme que » la science de la nature accouche du matérialisme dialectique « .
Car la dialectique de la nature, dont le principe remonte à Héraclite (6ème siècle av. notre ère) n’est nullement une lubie théorique attachée aux vicissitudes historiques de telle ou telle doctrine. La dialectique de la nature constitue au contraire comme nous le verrons une tendance objective de la connais-sance scientifique de la nature cherchant à rendre compte rationnellement du monde matériel en devenir ; et le rôle du philosophe marxiste n’est pas plus de forger des » doctrines » à son sujet que le rôle du parti communiste n’est de plier l’histoire à un » idéal » pré-fabriqué ; dans les deux cas (dialectique de la nature, lutte de classe), il s’agit seulement de rendre conscientes et de mettre en cohérence, bref de penser, d’ » acter » et d’ » activer » des tendances objectives qui émergent du réel lui-même et qui affleurent dans les résultats des sciences et dans les méthodes scientifiques, fût-ce d’abord de manière spontanée, fragmentaire et inconsciente.
Dans cette nouvelle rubrique d’EtincelleS, il s’agira donc de produire quelques signes tangibles de ce retour de la dialectique de la nature tout en polémiquant contre les interprétations mystiques des résultats scientifiques qui ne cessent de ressurgir de l’interprétation idéaliste des sciences. Il s’agira aussi de montrer que la dialectique de la nature n’a rien d’une lubie spéculative d’Engels et qu’elle tient au contraire une place fondamentale dans la constitution de la philosophie marxiste et du matérialisme historique. Il s’agira enfin de fonder et d’étayer le concept de dialectique de la nature pour en fixer le statut, indissolublement » ontologique » et » gnoséologique » en distinguant l’approche marxiste et l’approche hégélienne de la nature.
Les enjeux d’une défense et illustration de la dialectique de la nature sont tout à la fois scientifique, idéologique, politique et philosophique :
- enjeu scientifique, car l’émergence d’une dialectique de la nature permet de montrer que les avancées de la science contemporaine débouchent sur autre chose que sur une Tour de Babel positiviste où toute signification d’ensemble s’égare et où l’idée même d’une connaissance vraie, d’une intelligibilité foncière, du réel est contestée avec acharnement.
 enjeu idéologique, car faute de dialectique, le matérialisme spontané des sciences de la nature ne fait pas le poids face à l’irrationalisme proliférant qui suinte de tous les pores du capitalisme actuel. Enjeu politique, car il est de première importance de montrer que malgré l’intense réaction qui caractérise notre époque contre-révolutionnaire, le progrès scientifique, ce vieil allié des luttes pour l’émancipation sociale, s’approfondit et porte témoignage pour l’avenir raisonnable de l’humanité.
enjeu idéologique, car faute de dialectique, le matérialisme spontané des sciences de la nature ne fait pas le poids face à l’irrationalisme proliférant qui suinte de tous les pores du capitalisme actuel. Enjeu politique, car il est de première importance de montrer que malgré l’intense réaction qui caractérise notre époque contre-révolutionnaire, le progrès scientifique, ce vieil allié des luttes pour l’émancipation sociale, s’approfondit et porte témoignage pour l’avenir raisonnable de l’humanité. - enjeu philosophique enfin, car sans une ontologie scientifique et rationnelle, sans une dialectique de la nature, il est impossible de reconstruire une conception matérialiste et humaniste du monde et de la société permettant aux amis du progrès social de donner sens rationnel à leur vie d’homme et à leur combat collectif pour la transformation de la société.
La DIALECTIQUE SCIENTIFIQUE de la NATURE,
ou la défaite du positivisme
Le retour de la dialectique de la nature se manifeste d’abord par la publication d’un certain nombre d’ouvrages philosophiques de qualité sur lesquels nous reviendrons ultérieurement dans cette rubrique. Mais quels que soient les mérites de ces ouvrages, ils ne seraient pas par eux-mêmes significatifs : on peut toujours accuser tel ou tel philosophe de prêcher pour son saint ! Plus significatif est l’examen des problématiques scientifiques autour desquelles s’organise, de manière plus ou moins spontanée, la recherche scientifique la plus fondamentale.
A) En physique, le positivisme, le kantisme et le néo-positivisme, qui ont dominé la science occidentale durant tout le 20ème siècle, semblent avoir » mangé leur pain blanc « .
Ces courants dits » agnosticistes » (on entend par là qu’ils nient la possibilité pour la science d’atteindre ou d’approcher la vérité objective) sont les alliés traditionnels tout à la fois du pragmatisme économique (qui maintient les chercheurs sous la tutelle de l’économie capitaliste en leur inculquant le mépris de la philosophie) et de la religion (interdire la connaissance du fondamental, de l’universel et de l’élémentaire c’est préserver la foi et son » domaine réservé » : le » sens « ). Depuis Auguste Comte, le fondateur du positivisme, cette doctrine et ses avatars contemporains ont condamné comme » spéculatives » les recherches sur l’essence, sur l’élémentaire et sur la totalité, toutes considérées comme » métaphysiques « . Or, bousculant le veto positiviste, les physiciens contemporains ont mis le cap sur la recherche d’une grande unification théorique qui permette à la fois d’englober dans un système unique les deux » grandes » théories héritées du 20ème siècle (Relativité et Mécanique quantique) et de coordonner les différentes » forces » qui sont au cœur de la physique des particules (interactions forte, faible, électromagnétique et gravitationnelle). Il s’agit aussi de penser dans leur unité articulée l’énergie et la substance matérielle, la relation matière-mouvement (c’est-à-dire, de manière plus précise le rapport matière-espace-temps), l’interaction du vide et des particules, etc.
Devant de telles préoccupations, comment ne pas parler de renaissance de la dialectique matérialiste ? Par exemple, à propos de la matière et du vide, ces deux » contraires » de la théorie physique dont Démocrite et l’atomisme antique avaient de manière à la fois sommaire et brillante, étudié la polarité dans le but de comprendre le mouvement physique ? Désormais, c’en est fini d’une conception qui fait de la » parti-cule élémentaire » (succédané moderne de l’atome de Démocrite) un » être » plein, dénué de structure et de dynamisme internes. Ainsi la théorie des » cordes » et des » super-cordes » a-t-elle entrepris d’étudier la géométrie intime hautement complexe des » particules « , tandis que symétriquement, le vide n’est plus conçu comme un pur néant informe et immatériel : lui aussi possède une structure et il est dialectiquement lié, à travers la notion de champ à son contraire, la particule » élémentaire « . Dans la chromodynamique quantique, qui étudie les quarks et leurs relations, on voit même apparaître des particules d’interaction, les » gluons « , dont la fonction est de lier entre elles les particules » dures » (hadrons) à travers le vide et qui » matérialisent » l’échange inter-particulaire et » néantisent » symétriquement les particules en les relativisant.
La » matière » cesse ainsi définitivement d’être conçue comme une substance brute et sans vie, alors qu’inversement, l’échange, la relation, le mouvement, se voient assigner un substrat matériel objectif. Pour parler comme J. Derrida, la matière est » dé-fétichisée » et » spectralisée » tandis qu’en contrepartie, le rapport et l’échange sont matérialisés et dés-idéalisés. Ce double geste de spectralisation de la chose et de matérialisation de la relation coupe court d’une part à la mystique d’une matière opaque, succédané de la mystérieuse » chose en soi » kantienne, d’autre part à l’escamotage de la relation et de sa matérialité.
Le physicien des particules et philosophe marxisant Gilles Cohen-Tannoudji a détaillé de manière précise et suggestive ces dialectiques dans son livre déjà classique La Matière-espace-temps. Ainsi, qui peut encore sérieusement concevoir le temps ou l’espace comme des données purement » trans-cendantales « , comme des » formes a priori de la sensibilité » relevant du sujet connaissant fût-il universel, quand chacun constate au contraire que l’espace-temps est une donnée variable et éminemment relative, non pas au sujet humain (s’agît-il du sujet idéal de la science !) mais bien à la structure de la matière (à son mouvement, à son échelle, etc.) ?
Plus significativement encore, la physique des particules a dû se lier, et même jusqu’à un certain point fusionner avec son symétrique apparent, la cosmologie à tel point que tendanciellement, la science de l’élémentaire tende à ne plus faire qu’un avec la science de l’univers(el). Par un chassé-croisé théorique qui donne le tournis, les cosmologistes sont appelés à se tourner vers la physique des particules pour comprendre l’histoire de l’univers dans ses premiers » instants » après le big bang, à une époque où la température dudit univers est colossale et où règnent les » hautes énergies « , domaine propre de la physique des particules qui s’acharne à les produire ou plutôt à les reproduire dans des accélérateurs de particules de plus en plus puissants. Et à l’inverse, pour » unifier » les forces et les particules, la substance matérielle et l’espace-temps, le » vide » et le » plein » dans une seule théorie, il faut que le physicien des particules se place du point de vue de leur genèse, en mettant en évidence leur différenciation à partir d’une unité primordiale ou plutôt, d’une unité antécédente. Or pour cela, le microphysicien a besoin des lumières du cosmologiste dont le rôle est précisément de décrire le devenir de l’univers. Se dessine alors une sorte de science intermédiaire, dont l’astrophysicien soviétique Victor Ambartsoumian avait eu l’intuition, qu’il baptisait » cosmogonie » et qu’on pourrait plus complètement dénommer » physico-cosmogonie « .
Dans un article de La Pensée polémiquant contre les thèses de Lucien Sève sur le statut de la philosophie marxiste, puis dans la quatrième partie intitulée Matérialisme et universalisme de mon livre Mondialisation capitaliste et projet communiste, j’ai analysé ce chassé-croisé de première importance pour qui veut comprendre les lignes de forces d’une éventuelle restructuration matérialiste et dialectique de la science au 21ème siècle. S’y dessine une totale et prometteuse recomposition générale, non seulement du savoir scientifique, mais de la conception même de ce savoir. D’une part, les domaines longtemps opposés de l’empirique et du rationnel tendent à fusionner : forces et particules se produisent mutuellement dans une logique dont il y a lieu de rendre compte de manière logico-mathématique Inversement, la grandiose théorisation scientifique de l’universel-élémentaire que constitue la materia prima du big bang cesse d’être une pure spéculation, un pur » mythe des origines « , comme c’était inévitablement le cas dans les cosmogonies dites primitives, de Sumer à la Grèce antique en passant par l’Egypte des pharaons et la civilisation maya. En effet, la genèse historique de l’élémentaire est en droit observable au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’observation directe du » big bang » au niveau macrophysique de la cosmologie. Symétriquement, les recherches en apparence hyper-spéculatives sur la formation de l’univers acquièrent, au moins en droit, un statut expérimental puisqu’elles doivent être au minimum compatibles avec les recherches sur les particules et qu’elles peuvent même les stimuler et les provoquer directement.
D’autre part, cette logique matérielle à la fois singulière et universelle (Marx définissait la dialectique matérialiste comme la logique spéciale de l’objet spécial) se produit elle-même au cours d’une histoire (c’est cette histoire qui intéresse le micro-physicien quand il interpelle le cosmologiste) ; et cette histoire de l’Univers découle elle-même d’une logique, étudiée par le physicien des particules, car l’expansion de l’Univers obéit à des lois d’origine et doit par exemple être compatible avec le mal nommé principe anthropique. Logique dialectique de l’histoire de la nature, nature matérialiste de l’histoire de la logique, c’est bien là, d’un autre et double nom, désigner ce qu’Engels appelait sans détour » dialectique de la nature « .
Mais surtout, les statut respectifs de la philosophie et de la science se trouvent bouleversés par l’impressionnant » chassé-croisé » philosophique évoqué ici. On enseigne encore aujourd’hui benoîtement aux apprentis philosophes de nos lycées, aux » littéraires » comme aux » scientifiques « , que la science s’occupe de ce qui est expérimental mais qu’elle doit du même coup renoncer aux grandes questions spéculatives sur les causes (chercheurs, ne vous demandez pas pourquoi ? mais comment ?), sur l’origine, sur le Tout, sur l’élémentaire, sur le sens… En un mot, il faudrait bannir de la science tout questionnement malséant sur l’origine de la raison et sur la raison des origines. En contrepartie la religion, circonscrite dans les limites étriquées de » la » raison positiviste, se voit reconnaître le droit de postuler, en vertu de raisons pratiques et morales (idéologiques en réalité) l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme et le libre-arbitre de l’homme… Selon la vulgate kantienne qui fonctionne encore à plein régime en ce début de 21ème siècle, il faut seulement bannir la métaphysique qui prétend démontrer la réponse aux questions ultimes que l’homme se pose sur sa condition sans pouvoir accéder à la terre promise de l’expérimentation.
Eh bien, cette vulgate kantienne, comme la célèbre » colombe légère » de la Préface à la Critique de la Raison pure, a désormais du plomb, ou plutôt, du hadron dans l’aile. En-deçà du » chassé-croisé » de la cosmologie et de la microphysique, de l’Univers et de la particule, de l’historique et du logique, une autre dialectique se dessine qui peut en droit mettre fin au divorce de la science et de la philosophie ; celles-ci, encore fusionnelles chez leur commun fondateur Thalès de Milet, ont divorcé chez Kant dont le criticisme a redessiné les frontières entre science, théorie de la connaissance, métaphysique et religion » rationnelle « . Mais science théorique et philosophie matérialiste pourraient bien connaître au siècle prochain d’enthousiasmantes retrouvailles en permettant tout à la fois à la philosophie d’accéder au statut expérimental et à la science d’acquérir la dimension philosophique qui lui fait défaut sous la domination répressive du positivisme académique. N’est-ce pas au final ces retrouvailles, avec leurs prometteuses conséquences politiques, sociales, idéologiques, éthiques, -humaines en un mot-, que la philosophie officielle qui domine les media et l’Université s’acharnait à conjurer en frappant de forclusion la dialectique de la nature ?
Comme on le voit, la mise en évidence de la dialectique de la nature ne procède pas au petit bonheur en montant en épingle de manière contingente ou forcée des » exemples » de dialectique pêchés au hasard dans les productions scientifiques. On a souvent reproché au diamat stalinien (ou à la remarquable pédagogie philosophique d’un Georges Politzer) de procéder ainsi sans rigueur véritable. Ces reproches ne sont guère fondés quand on pense à la destination de l’ouvrage de Staline Matérialisme dialectique et matérialisme historique ou à celle des Principes élémentaires de philosophie de Politzer : il ne s’agissait pas principalement dans ces ouvrages (même si de grands scientifiques comme Oparine en URSS, Langevin et Wallon en France, y ont trouvé leur bonheur) de former des chercheurs de haut niveau mais de répondre à l’injonction de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert : » hâtons-nous de rendre la philosophie populaire » en permettant à des millions d’ouvriers, d’ingénieurs, de paysans, d’étudiants de s’approprier les fondamentaux d’une démarche philosophique et scientifique nourrie par l’expérience et tournée vers la révolution socialiste. Pour autant il est vrai que bien souvent, par peur de déplaire, par psittacisme doctrinal ou par démission intellectuelle, bien des intellectuels marxistes se sont contentés d’illustrer la dialectique de la nature comme semblait l’avoir fait Engels dans son livre éponyme sans songer que le décès d’Engels a laissé ce livre lumineux, plein d’une foisonnante conceptualité qu’il faut se donner la peine de dégager, à l’état de recherche préalable et de travail documentaire. Ici nous procédons tout autrement : c’est la logique même de la recherche scientifique confrontée à de sérieux problèmes méthodologiques et à l’élucidation de problèmes centraux et récurrents qui nous conduit à mettre l’accent (à la suite des scientifiques eux-mêmes puisque tout cela est tombé dans le domaine de la vulgarisation) sur le chassé-croisé dont nous venons de parler et dont l’essence est bien de dialectiser l’étude de la matière.
Enfin, j’ai souligné dans mes travaux antérieurs sur ce sujet que le » chassé-croisé » microphysique/cosmologie apporte un démenti cinglant aux conceptions actuellement les plus répandues sur le statut de la philosophie marxiste.
Ainsi, selon Lucien Sève, fidèlement relayé en cela par Cohen-Tannoudji, la philosophie matérialiste se réduit à une théorie de la connaissance, à une » gnoséologie » ; si bien que les » catégories philosophiques » ne se rapportent pas à l’être (ontologie) mais seulement au rapport cognitif entre l’être et la pensée. Elles ne portent pas sur les propriétés de l’être mais sur celles du reflet cognitif de l’être. A cette conception réductrice et empreinte d’esprit » criticiste » de la philosophie, j’ai d’abord objecté que si la théorie matérialiste de la connaissance voit dans les catégories philosophiques le reflet de la réalité objective, le contenu logique de ces catégories doit forcément refléter en dernière analyse, de manière aussi relatives et approximative qu’on voudra, des propriétés du monde matériel : comment en effet des catégories décrivant de manière appropriée le rapport juste et véridique de la pensée à l’être matériel pourraient-elles fonctionner si elles n’avaient pas aussi et d’abord du » répondant ontologique » du côté de l’être matériel lui-même ? Pour le matérialisme, le reflet, relation de la pensée à la matière, est lui-même inclus en tant que propriété dans la matière elle-même dont il n’est qu’un aspect ou qu’un moment si bien qu’inscrire les catégories philosophiques exclusivement dans le rapport de l’être à la pensée, c’est absolutiser la pensée, c’est inclure la matière dans le reflet et glisser à l’idéalisme. Car le matérialisme philosophique se définit comme la tendance philosophique dans laquelle la matière est l’absolu, l’esprit l’aspect relatif, et pour lequel la relation entre la matière et l’esprit (ici le reflet, la connaissance scientifique) est elle-même de nature matérielle, donc objectivable.
Mais pour nous en tenir aux arguments proprement scientifiques, le statut de l’idée de matière est profondément renouvelé par le redéploiement de la physique et de la cosmologie. Souvent conçue, y compris par les matérialistes, comme une » idée générale « , une pure abstraction de l’esprit pensant et généralisant, la notion de matière donne souvent prise paradoxale à de dures contre-attaques idéalistes : » la » Matière, objectent les idéalistes, ça n’existe pas, il n’y a que » des » matières ! « . Tout au contraire, en reportant vers l’origine de l’univers (de cet univers-ci devrions-nous dire plus prudemment pour couper court aux mythes créationnistes à propos du big bang), les physiciens et cosmologistes actuels envisagent clairement que » la » matière puisse tendre à coïncider, au point zéro, avec l’univers lui-même. Cela signifie que tendanciellement, l’universel et le singulier fusionnent et que le concept-catégorie de matière ne se réduit pas à une » idée » ; le concept lui-même, si l’on consent à le saisir de manière dialectique et pas seulement comme le produit mort d’une généralisation, comme un » universel » de type médiéval, comporte une base objective, empirique (au moins en droit) et… matérielle, comme toute essentialité véritable. A un certain niveau du devenir historique où nature et matière, univers et élément coïncident (avec quelles explosives, c’est peu de le dire, contradictions !), catégorie philosophique et concept de matière tendent à fusionner, ce qui crée des conditions sans précédent pour le rapprochement de la science et de la philosophie matérialiste que nous évoquions ci-dessus, et cela sur des bases parfaitement rigoureuses.
Pour conclure, soulignons l’éclairage indirect que l’orientation de la physique jette sur le concept même de dialectique de la nature. La fusion tendancielle de la microphysique et de la cosmologie manifeste avec éclat l’unité des aspects logique ( » synchronique « ) et historique (diachronique) de l’idée de nature. La nature a bien une » histoire » sans laquelle on ne peut rien comprendre à ses lois de fonctionnement qui n’ont rien d’une donnée éternelle, inexplicable, incompréhensible et irréductible ; et c’est en quoi l’étude de la nature reste irréductible à de purs raisonnements métaphysiques et spéculatifs puisque la logique est intrinsèquement matérielle et qu’elle est le produit d’une » nature » ; mais inversement, cette histoire a bien une nature et elle se déroule à partir d’une logique, elle est donc foncièrement intelligible et l’homme peut donc s’attendre à percer les mécanismes les plus fondamentaux de la natura rerum, comme l’avait entrepris Lucrèce ; une » nature » tout à la fois conçue comme la racine des choses, comme leur logique productive, tout à la fois structure du réel et logique fonctionnelle.
B) Dans le domaine biologique, la dialectique de la nature émerge de manière encore plus sensible et foisonnante… et multipolaire.
Sans jamais, hélas, évoquer positivement Engels (sans doute jugé politiquement incorrect par les temps qui courent…), François Dagognet, philosophe, médecin et biologiste de l’école de G. Canguilhem, a montré toute l’actualité de la dialectique matérialiste en matière de connaissance du vivant. Dans son opuscule déjà classique le Vivant, Dagognet a montré de manière synthétique à la fois l’originalité irréductible du vivant, l’impossibilité qu’il y a de le concevoir de manière platement mécaniste, et sa matérialité intrinsèque. Combattant à la fois, comme Engels le fit jadis dans Dialectique de la nature le réductionnisme matérialiste et l’idéalisme vitaliste (ce qu’il nomme le » romantisme » biologique, avec ses supputations à la Bergson sur le prétendu » élan vital « ), prenant appui sur le finalisme rationaliste d’Aristote et sur l’Encyclopédie des sciences philosophiques de Hegel, F. Dagognet n’en finit pas de déployer la dialecticité intrinsèque de la matière vivante et de mettre en évidence l’ingéniosité des biologistes qui, pour expérimenter sur le vivant » sans le détruire ni le dilacérer « , prennent soin en permanence d’ » extérioriser le milieu intérieur » cher à Claude Bernard en prenant soin d’en respecter l’essentielle réflexivité interne.
Il nous suffit ici de laisser la parole à Dagognet quand il se livre à l’exercice le plus philosophique qui soit en biologie fondamentale, celui qui consiste à définir le vivant : » On n’en finirait pas, écrit-il (p.39) d’examiner les paradoxes ou les propriétés antinomiques qui conviennent au corps, énigme majeure « . D’emblée la définition du vivant se centre sur la mise en évidence de la polarité dialectique, notamment celle de l’interne et de l’externe, mieux celle de l’externe s’intériorisant. Ce n’est pas tout : à en croire l’auteur, le vivant est le ban d’essai du matérialisme dialectique (saluons Dagognet qui parvient adroitement à contourner pendant deux cents pages cette expression compromettante…). Car le vivant est » une matière qui s’oppose, à l’aide de moyens strictement matériels, à la matière même et parvient à la tourner, l’obligeant autant à s’individualiser qu’à perdurer comme telle, ainsi nous apparaît l’organique en ses débuts » (P. 54). Cette magnifique définition du vivant nous montre comment l’extériorité spatiale qui caractérise la matière comme étendue chère à la Mécanique cartésienne » s’ invagine » (p.58) et se » creuse » pour donner naissance à l’intériorité plus ou moins accomplie du vivant, de la plante à l’animal. Se manifeste alors un double souci. Contre l’idéalisme et le vitalisme irrationaliste, le » matiériste » Dagognet, -à l’instar d’Engels-, prend fortement position sur l’intégrale matérialité du vivant, laquelle ne témoigne d’aucune » sur-nature « . Bref, comme le disent ordinairement les biochimistes les plus réductionnistes, » ce que fait la vie, les atomes peuvent le faire « . Mais contre le mécanicisme » matérialiste » issu de Descartes et de sa théorie de l’animal-machine (conception qui domine encore largement la biologie de La Mettrie à Jacques Monod), Dagognet prend soin de souligner la spécificité du vivant, qui forme bel et bien un niveau particulier doté de ses propres lois de fonctionnement et d’évolution propre, au sein du monde matériel.
Plus saisissante encore est la dialectique mise à jour par Dagognet dans le domaine des méthodes scientifiques propres à la biologie. Rendant justice à Claude Bernard tout en critiquant ses écarts vers le vitalisme, Dagognet montre que le propre du biologiste, en tant qu’il étudie l’organisme ou le rapport d’intégration de l’organisme en son milieu, est de s’intéresser à une totalité relativement close. Dès lors il va s’agir paradoxalement pour le chercheur d’extérioriser l’intérieur sans briser sa clôture spécifique qui est la vie même du vivant. Pour trouver la vérité, il faut en quelque sorte que l’observateur-expérimentateur trompe et » tourne » le vivant qu’il examine au prix de mille astuces éblouissantes d’ingéniosité (la tromperie étant ici, nouveau paradoxe, signe du plus grand respect !). En somme, il s’agit pour le biologiste de connaître cette chose en soi par excellence qu’est le vivant, spécialement son » milieu intérieur « , et pour cela l’activité paradoxale du chercheur sera d’intervenir de mille façons pour se faire petit et disparaître puisqu’il s’agit en somme de faire nôtre l’en-soi de l’autre, de s’approprier cognitivement la manière dont fonctionne le vivant quand nous ne sommes pas là, bref de le connaître objectivement comme cherche à le faire toute science digne de ce nom. En employant une expression qui parlera à tout lecteur de l’Idéologie allemande de Marx et Engels, nous dirions volontiers que la connaissance biologique constitue en quelque sorte un » reflet inversé » de l’objet étudié dont elle reproduit la logique en la retournant comme un gant :
» La science de la vie, écrit Dagognet p. 89, semble se construire comme si elle allait en direction inverse de celle de la vie : elle peut alors coller à elle puisqu’elle se borne à la tourner et à la dérouler en sens contraire d’elle-même. Alors que le vivant se boucle et se ferme (l’intériorité), celle-là, sans la briser, l’étale, le déplie et par là le livre en entier « .
Cette fine observation nous semble d’ailleurs déborder largement le champ des investigations biologiques. C’est toute la méthodologie scientifique, c’est la théorie générale de la connaissance qui trouveraient avantage à se mettre à l’école de cette » médecine expérimentale » que Claude Bernard a tout à la fois reconnue et méconnue, comme tout pionnier. Alors que règne quelquefois, à partir d’une interprétation discutable des paradoxes gnoséologiques de la physique quantique (notamment des célèbres relations d’incertitude décrites par W. Heisenberg) la conception idéaliste selon laquelle le physicien des particules est par essence un » perturbateur » de son objet, un sujet dont la toute-puissance ontologique, productrice de son objet, se paie d’une radicale impuissance épistémologique à connaître cet objet tel qu’en lui-même, Dagognet pulvérise les fausses oppositions de la méthodologie non-dialectique en remarquant que tout l’esprit de finesse de l’expérimentateur est, à égale distance de la contemplation passive des Anciens et du vandalisme interventionniste des Modernes, d’intervenir sur l’objet pour le rendre à lui-même, de le transformer pour le restituer, ce qui signifie que réflexivement, l’intervention doit intervenir sur elle-même pour provoquer le phénomène à l’étude sans en déformer le déroulement. Bref la connaissance scientifique n’est pas davantage, comme l’a bien vu L . Sève après Marx (cf l’Introduction à la critique de l’économie politique, 1857) ce qui » produit » l’objet (la » phénoménotechnique » idéaliste d’un Bachelard) que ce qui le contemple passivement : elle est plutôt ce qui » re-produit » l’objet de manière tout à la fois active et respectueuse de sa logique propre si bien que le reflet du réel, tel que le conçoit un marxisme un peu éclairé, n’est ni l’enregistrement passif et empiriste du réel ni l’engagement brutal et saccageur de la méthodologie vivisectionneuse de la scientificité capitaliste, plus avide d’autopsier les gros matous paradoxaux de Schrödinger que de les regarder vivre humblement et patiemment à la manière d’un Von Frisch décodant le langage des abeilles ou d’un Konrad Lorenz comprenant de l’intérieur le comportement des oies sauvages en se pliant humblement à leur comportement collectif. Pour ne pas rompre (avec l’)objet, le sujet doit apprendre à plier, comme il sied à tout digne roseau pensant ! Cum grano salis, osons-même cette question provocatrice : la science, la physique du futur continueront-t-elle éternellement à jouer aux auto-tampons et le fin du fin de l’expérimentation sera-t-il éternellement de casser, de briser et de » collisionner » pour pénétrer par effraction à l’intérieur des mésons et dans l’intimité des quarks ? Rêvons une minute à la suite d’Alexandra David-Neel qui découvrit au Tibet que le comble de l’action est quelquefois la non-intervention et rêvons qu’à l’avenir, le nom usurpé du grand Thalès cesse de désigner une multinationale de l’armement pour parrainer de nouveau la communauté des contemplatifs distraits, toujours prêts à tomber dans les puits pour observer amoureusement, toutes avancées de la science » dure » en tête, l’infini d’étoiles qui nous embrasse !
Il est pourtant regrettable que, dans sa recherche dialectique, F. Dagognet ne se donne pas les moyens, en recourant notamment à la catégorie dialectique de » saut qualitatif » de concevoir clairement le passage qui conduit de la matière inerte, uniquement comptable des lois physico-chimiques, à la matière vivante, régie par des lois nouvelles et spécifiques, centrées sur le couple dialectique reproduction/évolution. Comment comprendre en matérialiste le fonctionnement d’une polarité dialectique, c’est-à-dire d’une polarité où les deux termes entretiennent une relation dissymétrique, si l’on n’aborde pas franchement la question de la formation de l’un des deux termes (le déterminé) à partir d’une différenciation de son déterminant originel ? En un mot, il est essentiel, pour comprendre jusqu’au bout la logique matérielle des rapports entre le vivant et l’ » inerte « , d’affronter un problème nodal qui est curieusement absent du livre de Dagognet, celui de l’origine de la vie. C’est cette question essentielle, où se nouent le rapport du non-vivant et du vivant, la détermination en dernière instance du second par le premier se complétant d’une domination symétrique du vivant sur le non vivant (Dagognet dit : » du Soi sur le non-soi « ) dans le fonctionnement même de la vie, qu’affrontait sans détour Alexandre Oparine, pionnier des recherches soviétiques sur l’origine de la vie qui se référait sans complexes aux analyses dialectiques d’Engels.
Pour autant, la ligne principale de F. Dagognet, son fil rouge, reste bien la recherche de la dialecticité matérialiste. L’auteur n’a cure des objections poussiéreuses qui prétendent, notamment depuis Sartre et sa Critique de la raison dialectique faire de la négativité l’apanage de l’humaine subjectivité : » la négativité habiterait-elle alors l’être même, à tel point que surgirait de lui et en lui son opposé ? Nous ne savons pas vraiment laquelle des trois, -la dialectique, la nécessité ou la contingence- a promu cette néo-architecture, mais une fois promue, elle tend à subsister et à conserver ses avantages (la régulation et la durée) » (p. 54). Malgré la justesse de la fausse question initiale, notons que la formulation disjonctive de la seconde phrase est fautive : il n’y a évidemment pas lieu de choisir » entre » la dialectique, la nécessité et la contingence ! Au contraire, l’avantage logique d’une conception matérialiste et dialectique de l’origine du vivant est de nous inciter, à l’encontre de l’opposition platement métaphysique proposée par Monod entre le » Hasard » et la » nécessité « , à comprendre comment la contingence et le hasard s’insèrent à titre de moment subordonné dans la nécessité dialectique, c’est-à-dire dans une nécessité contradictoire qui produit nécessairement des bifurcations, de la contingence, du hasard objectif et néanmoins intelligible (à l’opposé du » miracle matérialiste » dont parlent Jacques Monod ou Michel Serres). Le » ou bien » de la contingence est lui-même un moment de la conjonction dialectique des contraires !
On trouve dans le livre de F.Dagognet bien d’autres exemples de cette » unité conflictuelle des contraires » dont Hegel, mais aussi Engels, Lénine et Brecht faisaient la » racine de toute vie et de tout mouvement » et qui constitue le centre de gravité de la pensée dialectique. Dialectique de la ligne droite et de l’arrondi dans l’architecture des structures biologiques (p. 59), dialectique de la » déconstruction » et de la » reconstruction » dans les méthodes du biologiste et du physiologiste (p. 100), dialectique écologique de la proie et du prédateur (p.110), dialectique du temps et de la permanence (p.110), dialectique du vivant et du mécanique qui (contre l’avis de Bergson) trône bien au centre du vivant (p. 105) mais qui ne s’oppose pas à la régulation, à la réflexion, à l’intériorité, dialectique de la » frontière » à travers l’opposition sans cesse surmontée à l’avantage du premier du Soi et du non-soi (109)… il s’agit ici de comprendre de manière rationnelle, logique, matérialiste, » sans le détruire ni le dilacérer » tout ce que les conceptions vitalistes, finalistes, idéalistes classaient sous la rubrique de la finalité. Alors que ces conceptions faisaient du vivant la preuve par excellence de la divine Providence et de ses intentions bienveillantes, le matérialisme dialectique s’efforcera de restituer la portée matérialiste de cette finalité, interne et matériellement déterminée, de cette finalité sans fin dirions-nous en détournant de son sens une expression célèbre de Kant. F. Dagognet n’est d’ailleurs pas éloigné d’une telle formulation quand il déclare, en contournant les analyses d’Engels mais en utilisant le concept thermodynamique de » structure dissipative » et l’étude classique de J. Tonnelat (une expression qui désigne les » dissipations d’ énergie structurante « ) : » certains systèmes, dès qu’ils reçoivent un flux d’énergie, chaleur ou travail, peuvent se transformer et engendrer une configuration non seulement singulière mais qui aussi persistante et qui s’auto-entretient « . Bref, dans certaines conditions, le désordre produit un ordre qui se reproduit et qu’Oparine cherchait jadis dans l’étude des » coacervats « . C’est bien une finalité sans fin, l’apparition d’une finalité sans finalité à égale distance des conceptions matérialistes réductionnistes, négatrices de toute finalité (un peu dans l’esprit de l’Appendice au livre I de l’Ethique de Spinoza, tout au moins quand on le lit rapidement), que des conceptions téléologiques formulées par Aristote et qui font de la finalité du vivant le produit d’une finalité extérieure, l’Acte divin.
Ce qui se joue ici, c’est la possibilité d’une réconciliation matérialiste et dialectique des points de vue stérilement antagoniques du matérialisme mécaniste et du finalisme vitaliste ; l’enjeu est celui d’une approche matérialiste de la finalité interne enfin débarrassée de ses oripeaux théologiques. Peut-on risquer l’hypothèse qu’en biologie fondamentale, comme en physique fondamentale, une grande unification des théories est à l’ordre du jour. Il s’agit d’articuler dans un tout cohérent la génétique issue de Mendel, aujourd’hui porteuse, avec ses prolongements biologico-moléculaires, d’idéologie mécaniste et, de manière moins visible, d’idéalisme platonisant et de combinatoire néo-leibnizienne), la théorie de l’Evolution issue de Darwin (est-il interdit de rêver d’une récupération darwinienne de l’héritage de Lamarck ?) et les approches dialectiques et » holistes » mais volontiers idéalistes et vitalistes, issues de l’éthologie et de l’écologie ? De la sorte, le chercheur en biologie fondamentale pourrait enfin devenir un bigame heureux ! Entendons par là qu’il pourrait cesser de jouer le rôle plaisant décrit par François Jacob dans sa Logique du vivant, celui de l’époux adultère qui honore au grand jour sa sévère » épouse officielle « , la nécessité physico-chimique, tout en se » dissipant » la nuit dans l’excitante compagnie de son inavouable maîtresse, la finalité. Au demeurant, bien que ce mot ne soit point usité par F. Dagognet en raison de sa connotation idéaliste, ce grand admirateur d’Aristote reconnaît de la manière la plus dialectique qui soit la portée de cette notion de finalité quand il écrit à propos du vivant qu’en lui » le Soi domine le non-soi » (p.109).
De la même manière, Dagognet renouvelle tout à fait dans l’esprit du matérialisme dialectique et des recherches soviétiques (horreur !) classiques de l’épistémologue Bonifati Kedrov, le vieux et insistant problème de la classification des sciences. Démontrant avec soin que les questions taxinomiques sont loin d’être dépassées en biologie et qu’elles appellent au contraire de puissants développements heuristiques, F.Dagognet montre qu’il n’y a pas lieu d’opposer métaphysiquement l’ordre historique et diachronique, la classification logique et la découverte empirique, comme l’avait déjà pressenti Auguste Comte. Ainsi Dagognet rappelle-t-il (p.113) que c’est en partant d’une » systématique » rationnelle, elle-même obtenue par l’étude attentive de l’évolution, qu’il est possible de chercher (sans garantie de les trouver : le possible est-il toujours réalisé ?) les chaînons manquants au buissonnant tableau de la vie ! De même que le corps des vivants reproduit, y compris spatialement, les étapes diachroniques de sa genèse phylogénétique et ontogénétique (Dagognet rappelle la loi de Haeckel selon lequel » l’ontogenèse reproduit la phylogenèse « ), de même toute classification objective, qu’il s’agisse du vivant ou des sciences qui l’étudient, reproduit-elle l’ordre diachronique des espèces et des études biologiques. Quoi de plus naturel d’ailleurs ? La science va nécessairement du plus simple (la découverte par Harvey de la circulation du sang précède évidemment l’étude scientifique du système neuromusculaire, cf p. 72) et l’ordo cognoscendi reflète en dernière analyse l’ordo essendi.
Enfonçant le clou sans jamais nommer le Christ, Dagognet précise encore, d’une manière bien plus matérialiste et engelsienne qu’idéaliste et hégélienne (p. 66) : » la vie ne consiste pas à déborder ou à ignorer ou à transcender la matérialiste, mais davantage à l’exhausser et à lui conférer, du même coup, des potentialités. Raison de plus pour toujours devoir accorder les deux, l’organicité et la physico-chimie ou encore le dynamique et le morphologique. Si Claude Bernard, le savant, travaillait à les relier, le théoricien-philosophe plaidait en faveur du divorce et l’approfondissait « . On voit ici Dagognet reprendre en pratique à son compte à propos de C. Bernard savant et philosophe, l’opposition étudiée par Althusser, précisément à propos du livre de Jacques Monod, entre » philosophie spontanée des savants » et » philosophie savante « . Mais cette opposition ne vient nullement d’Althusser, qui l’a empruntée à Engels, à Lénine et à Gramsci. Toujours est-il que le savant Claude Bernard est spontanément matérialiste et dialecticien, alors que le philosophe Claude Bernard (celui qu’on étudie en terminale !) est (de manière dominante car les choses ne sont pas simples en l’occurrence) idéaliste et métaphysicien.
Fort logiquement à partir de pareils attendus, Dagognet retrouve au cœur du vivant la catégorie centrale de la dialectique hégélienne, le dépassement (Aufhebung), c’est-à-dire la négation de la négation. Retrouvant des accents héraclitéens, l’auteur du Vivant s’écrie : » tout s’écoule en nous, tout bouge et tout se recommence » (p. 50). Le vivant ne triomphe pas du temps en le stoppant mais en se re-produisant sans trêve, cette auto-reproduction de soi à partir du non-soi étant la vie même. L’identité n’est donc pas stagna-tion ou transcendance métaphysique mais incessante remise en chantier du soi. C’est ainsi que le vivant » dépasse » sans la » transcender » la matérialité, ordinairement abandonnée au pur écoulement temporel et à l’infinie divisibilité de l’espace : » La victoire sur l’espace ne laisse pas le moindre doute alors que la matière seule est livrée à l’étalement, à la division sans relâche et à la pluralité (…). Autant la matière subit les moindres chocs et se disperse, autant à l’inverse le vivant se maintient et neutralise ce qui l’affecte » (p.66). Evitant le vocabulaire de la pure » continuité » matérialiste comme celui de la métaphysique idéa-liste, Dagognet redéfinit le vivant à travers une » dialectique bio-morphologique » comme » une matérialité capable à la fois d’absorber le temps et l’espace, de les intégrer et, partant, de les dépasser ; avec le vivant, nous entrons dans trans-physique ou l’examen de la méta-matérialité « . La contradiction n’est pas pour autant éliminée mais régulée et reproduite au sein de l’unité (avec tout ce que cela implique du point de vue de la théorie, que dis-je, de la philosophie médicale) : examinant les mécanismes de la régulation cardiaque, l’auteur rappelle par exemple- en montrant qu’il s’agit là d’une observation de vaste portée-, que » chaque action importante est assurée à travers un double et inévitable mécanisme, à la fois une éventuelle stimulation et une relative inhibition » (p.66).
Comme on voit, la fonction philosophique de cette dialectique est d’ » ouvrir » le matérialisme, de déployer la notion de matière dans toutes ses dimensions et pour cela de la sublimer, de l’étager pour y déceler ses manifestations qualitatives successives, de manière à éviter le double écueil du matérialisme mécaniste et de son supplément d’âme vitaliste prenant appui sur les étroitesses répulsives du mécanisme.
Conclusion de la première partie
Nous terminerons cette première partie par une réflexion sur les rapports entre nature et culture dans le champ de l’anthropogenèse. C’est en effet sur les » points nodaux » du développement naturel, sur les transitions entre l’inerte et le vivant (l’origine de la vie), entre le biologique et le social (l’hominisation), que la pensée dialectique trouve à s’exercer de la manière la plus féconde à travers la catégorie déjà citée de » saut qualitatif « . Déjà dans sa Dialectique de la nature Engels avait insisté sur la » transformation du singe en homme » sous le double effet de l’évolution corporelle de l’homo sapiens (notamment le couple formé par le cerveau et la main) et du travail humain. C’est cette veine féconde qu’avait notamment explorée le grand anthropologue français André Leroi-Gourhan quand il écrivait que » le dispositif corporel de l’homo sapiens » lui permettait de sortir de l’ordre purement biologique de la nature pour produire des objets techniques dont la transmission est au cœur de la transmission culturelle par héritage social.
Aujourd’hui cette conception matérialiste et dialectique du passage de l’animalité à l’humanité est quelquefois contestée sur la base d’observations qui montrent que la transmission culturelle n’est pas totalement ignorée des animaux les plus proches de l’homme, notamment des grands singes anthropoïdes si bien qu’il serait devenu absurde de distribuer la nature et la culture respectivement à l’animal et à l’humain.
En réalité, cette objection est superficielle. Qu’il y ait déjà des éléments de culture (ou de la culture en puissance) chez certaines espèces animales, voilà qui ne contredit en rien la conception matérialiste du passage de la nature à la culture. Bien évidemment, il faut que la nature contienne en elle-même, comme en puissance, la culture qui tout à la fois, la prolonge et la nie. Sans cela, l’apparition de l’homme et de sa culture serait un phénomène inexplicable, mystérieux et pour tout dire miraculeux. Au demeurant, le fond de la dialectique engelsienne de la nature et de la culture consiste à monter l’origine animale, c’est-à-dire biologique et matérielle de la culture. Mais comment pourrait-on échapper à la dialectique, à la catégorie de » saut qualitatif » notamment, si l’on veut penser en matérialiste et sans recours au miraculeux ou à l’inex-plicable (le fond de l’idéologie structuraliste, qui dénie tout sérieux aux questions d’origine, est nettement religieux) le passage contradictoire d’un ordre matériel à un autre ? Contradictoire en effet, puisque l’enjeu est de saisir à la fois la continuité (la culture vient de la nature comme le vivant vient du non-vivant) et les ruptures (l’ordre culturel est irréductible à l’ordre naturel comme le vivant est irréductible au non-vivant). De plus générale, toute transition comporte une contradiction objective et met en péril le » tiers exclu « , sans quoi il faudrait qu’une porte fût ouverte ou bien fermée sans qu’il fût logiquement possible qu’elle s’ouvrît ou se fermât jamais. Il y a déjà des éléments de culture, ou des prédispositions à la culture chez l’animal (et chez cet animal qu’est et que reste homo sapiens !), la belle affaire, puisque subsistent en contrepartie des éléments de » nature » chez l’homme » cultivé « . De même subsiste-t-il longtemps des éléments de féodalité au sein du mode de production capitaliste, etc., comme à l’inverse la société féodale porte elle-même en ses flancs son renversement par le capitalisme ou comme la société capitaliste » produit elle-même son propre fossoyeur « , la révolution prolétarienne. La question est alors de savoir quel ordre domine. Par exemple, après la Restauration royaliste de 1815, des éléments de féodalité se réinstallent en France mais la France de Louis XVIII reste fondamentalement une France bourgeoise, où le féodalisme est un élément structurel-lement dominé en raison de la prégnance de la nouvelle société bourgeoise et tendanciellement capitaliste issue de la Révolution.
De même chez certains animaux proches de l’homme des éléments de culture ou de pré-culture peuvent cohabiter avec l’ordre biologique, proprement animal, qui les domine et se les subordonne en fonction de ses propres fins. Cette domination s’inverse progressivement chez les préhominiens et tout l’enjeu de l’anthropogenèse est précisément de soumettre l’ordre naturel au nouvel ordre socio-culturel résultant du travail, du langage, de l’héritage et de la technique. Bref, chez l’homme, l’ordre héréditaire de la biologie est globalement de plus en plus soumis à l’ordre social de la transmission culturelle (et par exemple, comme l’a montré Rousseau, les inégalités sociales n’ont aucun fondement naturel alors que les inégalités sociales peuvent retentir fortement sur les inégalités » naturelles » car il n’est pas indifférent pour le devenir corporel d’un chacun qu’il soit né fils d’avocat à Philadelphie ou fils de paysan sans terre au Chiapas !). En un mot, la dialectique matérialiste de la nature et de la culture doit être complexifiée mais non abandonnée. Au demeurant, l’opposition entre quantitatif et qualitatif est elle-même anti-dialectique dans le mesure où le passage d’une qualité à une autre signifie toujours aussi le basculement d’une prédominance (quantitative donc !) d’une qualité sur une autre à la situation inverse. Il faut pour bien concevoir ce type de révolution distinguer la détermination en dernière instance (même la culture, y compris à un stade historiquement avancé continue de satisfaire aux besoins naturels, fût-ce au prix de mille détours et des pires aberrations apparentes) de la domination structurelle. C’est par exemple, en toute société, le mode de production qui détermine en dernière instance le type de domination de telle ou telle instance de la structure sociale, par exemple la domination de l’appareil idéologique religieux dans la société féodale. De même pour l’anthropogenèse faut-il, à travers une constante et indépassable détermination biologico-naturelle en dernière instance, observer l’émergence tâtonnante et mal assurée d’un nouvel ordre proprement social et culturel qui parce qu’il assure au final la » victoire » d’homo sapiens sur l’adversité naturelle, se soumet progressivement l’ordre naturel lui-même.
Equipé d’un tel appareil conceptuel, on peut aisément concevoir la grandiose dialectique de la nature et de l’histoire qui travaille en profondeur notre temps. Le préhominien a mis des millénaires pour s’hominiser en accédant à la domination du fait culturel sur l’ordre naturel. Mais aussi longtemps que l’homme est resté dépendant d’une collecte aléatoire de nourriture dans son environnement naturel (cueillette, chasse et pêche) la nature le dominait dans sa culture même : historiquement, cela correspond au stade signalé par Marx des religions de la nature. Avec l’essor de la production stricto sensu, c’est-à-dire avec la mise en place d’un nouveau mode d’approvisionnement dont les fruits ne sont plus trouvés dans l’environnement immédiat mais dépendent d’une longue préparation collective en amont, ce rapport s’inverse et la culture finit par se penser elle-même comme domination sur la culture : l’homme finira par se concevoir à la manière de Descartes » comme maître et possesseur de la nature « . Mais cette domination de la culture sur la nature s’effectue dans des formes socio-culturelles, dans des rapports de production (capitalistes) où les formes naturelles dominent sous la forme de la concurrence aveugle et de la » guerre de tous contre tous « . Le capitalisme apparaît alors comme une forme » naturelle « , c’est-à-dire aveugle, de la domination de la culture sur la nature. Dans ces conditions, la nature, comme le corps même de l’ouvrier est facilement détruite, saccagée et mutilée : » le capitalisme ne produit la richesse, écrit Marx, qu’en épuisant ses deux sources, la terre et le travailleur « .
Notre époque, où la dimension proprement exterministe du capitalisme s’affirme de manière écla-tante, non seulement dans le domaine politico-militaire mais dans celui du saccage des ressources naturelles, pose objectivement la question, non du » dépassement » du capitalisme » sauvage » mais du renversement de la sauvagerie capitaliste, Cela devient pour l’humanité une question de simple survie que d’en finir avec cette domination de la nature au sein même de la culture qu’incarnent les sociétés de classes avec leur cortège de guerres, d’inégalités, de fascisme, de développement anarchique de l’économie. L’enjeu du communisme, c’est-à-dire d’une gestion collective, planétaire et planifiée, du travail, des ressources naturelles, des richesses produites et des recherches scientifiques en fonction des besoins du développement collectif et personnel des individus, n’est pas » seulement » de résoudre les problèmes sociaux et d’en finir avec les inégalités sociales. L’enjeu anthropologique du communisme est la liberté, c’est-à-dire la capacité collective de l’homme à maîtriser démocratiquement et rationnellement son développement historique, c’est-à-dire son rapport social à la nature.
Mais en contrepartie, cette domination de la culture au sein de la culture qu’est le communisme en tant que forme suprême de la civilisation et fin de la préhistoire humaine (et non en tant que » fin de l’histoire « ) est aussi réconciliation de la nature et de la culture, négation de cette négation de la nature par la nature qu’est le travail outillé. Car après avoir été sourdement dominé par la nature durant des millénaires (les » catastrophes naturelles » attribuées à des forces surnaturelles rythmaient la vie des peuples et leur extinction naturelle), après avoir » pris le pouvoir » sur la nature à travers le couple capitaliste » technique/libre entreprise » qui caractérise la Renaissance, l’homme est forcé par la nature et par ses besoins naturels les plus incontournables : respirer, manger, etc. (pollutions de l’air et de l’eau, réchauffement climatique, déforestation…) de gérer différemment son rapport à la nature. La culture cesse ainsi d’être une guerre contre la nature et devient gestion rationnelle des ressources naturelles qu’il s’agit de reproduire : ce qui signifie que la production, longtemps conçue comme opposition prométhéenne avec la nature, devient production des conditions naturelles de la production. Ainsi conçue, l’écologie ne signifie pas dénigrement des techniques mais accomplissement sans précédent du travail, de la science, de la technique. Le communisme n’est donc pas seulement transformation des rapports sociaux, il n’est pas seulement un phénomène social, humain, au sens étroit ; il est aussi révolution écologique du rapport entre nature et culture. Il faut pour s’en rendre compte regarder au-delà de la première expérience socialiste de l’histoire telle qu’elle s’est formée en URSS, en Chine et dans tous ces pays de la périphérie capitaliste qui durent dans des conditions particulièrement difficiles, explorer la route mal connue du socialisme tout en lançant l’accumulation capitaliste primitive avec ses inévitables pollutions, cela afin d’échapper au sous-développement originel et d’être en état de tenir tête à un environnement capitaliste d’une agressivité déclarée.
Ce bouleversement dialectique des rapports entre nature et culture ne concerne pas que la nature extérieure, l’ » environnement « . Il touche également la nature interne, le corps humain et son saint des saints, le génome humain que les avancées de la génétique rendent en droit accessible à l’intervention outillée et méthodique de l’homme, donc à terme à la production. Révolution anthropologique puisque de simple donnée naturelle qu’il était jusqu’alors, le corps humain devient en droit l’objet d’une production dès lors que l’on maîtrise les mécanismes de sa production quels qu’ils soient. Il y a là derechef une grandiose négation de la négation : la culture, produit de l’évolution naturelle, est elle-même parvenue à ce stade historique où elle peut à son tour refonder ses bases naturelles de manière artificielle. Sous le capitalisme, cette avancée est prise en tenailles entre, d’une part, les idéologies réactionnaires qui considèrent comme un » péché » de toucher à ce » don de Dieu » qu’est le génome et, d’autre part, la recherche effrénée du profit qui, sous couvert de libre entreprise, ouvre la porte à l’arbitraire le plus monstrueux pourvu qu’il rapporte de l’argent. Dominée par l’idéalisme kantien ou par le personnalisme chrétien, la bioéthique cherche le plus souvent à poser des limites extérieures, transcendantes, » morales « , aux recherches en génie génétique. En réalité, l’éthique vivante ne se forme pas en dehors des processus humains mais en eux-mêmes et aux points nodaux du développement historique de l’humanité. Aucun dieu n’interdit de toucher à la nature, fût-ce à la nature humaine, et profaner la nature est même ce que l’homme a fait constamment pour son honneur depuis qu’il produit ses moyens d’existence en transformant le monde et en se transformant lui-même dans sa lutte avec la nature. Il est simplement expédient d’observer que la nature a rendu possible la culture en dotant l’espèce humaine (« produite pour l’infinité » selon Pascal) de ces organes biologiquement non limités à une seule fonction (comme l’aile, la nageoire ou le croc) que sont la main, le cerveau et l’appareil de phonation. A partir de là, la nature s’ouvre à l’infini de l’histoire et de la culture. De même que le communisme intervient comme autorégulation du développement de la culture en empêchant celle-ci de détruire la nature, qui reste à tout moment la condition matérielle de sa propre possibilité, de même une bioéthique dialectique fixe-t-elle à la recherche cette limite interne au développement de la recherche qu’est la sauvegarde des conditions naturelles de l’histoire elle-même en tant qu’auto-développement de l’homme, c’est-à-dire en tant que liberté. La liberté elle-même est encadrée en ce sens qu’elle interdit ce qui détruit la liberté et qui sape les bases de l’hominisation naturelle (le » dispositif corporel de l’homo sapiens « , comme disait Leroi-Gourhan) et culturelle (par exemple, mais il faudrait en débattre, la prohibition de l’inceste comme facteur d’échange entre les groupes humains et que fondement de la » subjectification » des individus).
Bref, le corps naturel produit un corps social (la culture) qui » retouche » le corps naturel mais doit reproduire ce qui, dans le corps naturel, permet le corps social et son auto-production historique (pourquoi par exemple redouter qu’on puisse à l’avenir éradiquer les maladies génétiques ? En quoi sont-elles facteurs de liberté dès lors qu’on ne partage plus les doctrines religieuses qui font de la vie terrestre une pénitence ?).
Il faudrait revenir sur d’autres recherches récentes qui mettent en jeu à des degrés divers des démarches dialectico-matérialistes (voir les articles consacrés dans ce recueil aux recherches du neurologue américain Antonio Damascio sur la conscience de soi ou aux travaux sur la » sculpture du vivant « ). L’essentiel est d’acter la modernité et l’intérêt profonds de ces recherches en appelant le lecteur à s’y intéresser par lui-même.
Il nous faut maintenant réfléchir au concept même de dialectique de la nature pour en fonder la nécessité universelle.


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)