 Ce n’est pas parce que Martov devint quelque temps le « penseur » et le chef de file des mencheviks, ni parce qu’il s’opposa ensuite vigoureusement à Lénine et à la Révolution d’Octobre (sans toutefois avoir rallié l’union sacrée autour du tsar durant la 1ère guerre mondiale) qu’il ne s’agit pas d’un auteur intéressant que les marxistes se doivent de lire avec vigilance critique, comme Kautsky, Plekhanov et d’autres. Ce n’est pas manquer au léninisme que de pratiquer l’ « assimilation critique de l’héritage » de la IIème Internationale, dont Engels fut l’un des fondateurs, le léninisme véritable, qui n’est pas une foi religieuse mais une méthode de pensée, impose au contraire de procéder comme le faisait Oulianov lui-même : rappelons que sur le projet de colonne dédiée aux héros du socialisme que les bolcheviks voulurent initialement édifier sur la Place rouge, Lénine n’avait rayé qu’un nom : le sien, et qu’il avait laissé sans commentaire les noms de Jaurès et de Plekhanov – que le dirigeant bolchevik avait souvent affrontés – et qu’il n’avait même pas écarté les grandes figures anarchistes, au premier rang desquelles celles de Proudhon…
Ce n’est pas parce que Martov devint quelque temps le « penseur » et le chef de file des mencheviks, ni parce qu’il s’opposa ensuite vigoureusement à Lénine et à la Révolution d’Octobre (sans toutefois avoir rallié l’union sacrée autour du tsar durant la 1ère guerre mondiale) qu’il ne s’agit pas d’un auteur intéressant que les marxistes se doivent de lire avec vigilance critique, comme Kautsky, Plekhanov et d’autres. Ce n’est pas manquer au léninisme que de pratiquer l’ « assimilation critique de l’héritage » de la IIème Internationale, dont Engels fut l’un des fondateurs, le léninisme véritable, qui n’est pas une foi religieuse mais une méthode de pensée, impose au contraire de procéder comme le faisait Oulianov lui-même : rappelons que sur le projet de colonne dédiée aux héros du socialisme que les bolcheviks voulurent initialement édifier sur la Place rouge, Lénine n’avait rayé qu’un nom : le sien, et qu’il avait laissé sans commentaire les noms de Jaurès et de Plekhanov – que le dirigeant bolchevik avait souvent affrontés – et qu’il n’avait même pas écarté les grandes figures anarchistes, au premier rang desquelles celles de Proudhon…
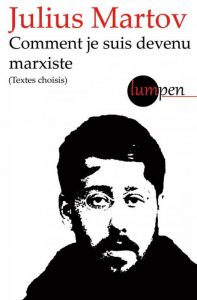 Dans Comment je suis devenu marxiste, Martov narre avec modestie la manière dont, à travers bien des tâtonnements, le lycéen révolutionnaire qu’il était a lu Le Capital (en français, l’édition russe étant interdite) et a rallié le parti ouvrier social-démocrate de Russie, alors marxiste et fortement influencé par Plekhanov. Dans le récit de Martov, on redécouvre le climat étouffant du tsarisme aux abois et l’héroïsme de ces tout jeunes étudiants et ouvriers révolutionnaires qui savaient à coup sûr, quand ils s’engageaient dans la lutte, qu’ils seraient au mieux radiés de l’Université et interdits d’emploi public, et qu’au pire, ils finiraient en Sibérie ou pendus, comme le fut le frère aîné du futur Lénine. Martov lui-même subit plus d’une fois la répression.
Dans Comment je suis devenu marxiste, Martov narre avec modestie la manière dont, à travers bien des tâtonnements, le lycéen révolutionnaire qu’il était a lu Le Capital (en français, l’édition russe étant interdite) et a rallié le parti ouvrier social-démocrate de Russie, alors marxiste et fortement influencé par Plekhanov. Dans le récit de Martov, on redécouvre le climat étouffant du tsarisme aux abois et l’héroïsme de ces tout jeunes étudiants et ouvriers révolutionnaires qui savaient à coup sûr, quand ils s’engageaient dans la lutte, qu’ils seraient au mieux radiés de l’Université et interdits d’emploi public, et qu’au pire, ils finiraient en Sibérie ou pendus, comme le fut le frère aîné du futur Lénine. Martov lui-même subit plus d’une fois la répression.
Cependant l’article qui sort de l’ordinaire dans le recueil édité par le jeune militant communiste Jean-François Garcia (chef de file des éditions Lumpen), s’intitule Les racines du bolchevisme mondial. Il ne s’agit pas principalement pour Martov d’y dénoncer la prise de pouvoir par les bolcheviks russes ; son objet est plutôt de comprendre comment ce qui n’est à ses yeux qu’une déviation volontariste, aventuriste et quasi-« asiatique » du marxisme, – le bolchevisme –, a pu acquérir une influence mondiale avec la création de l’Internationale communiste et le développement de PC de masses dans toute une série de pays occidentaux « civilisés ». Au passage, Martov – qui sait les difficultés que les bolchéviks ont d’abord rencontrées avec les paysans, et qui connaît du dedans le prolétariat russe – ne conteste nullement le caractère prolétarien d’Octobre 1917 : oui le régime des soviets est bien un pouvoir ouvrier et non pas l’on ne sait quelle dictature militaire « hors-classes », comme le prétendent le plus souvent les théoriciens sociaux-démocrates « modernes » à la Michel Rocard. Dont acte !
Cependant, d’après Martov, cette classe ouvrière russe a été fortement perturbée et déclassée par les quatre années de guerre (1914-18) où le prolétariat a été totalement militarisé non seulement en Russie, mais dans toute l’Europe. C’est pourquoi la rationalité marxiste, qui est attachée à la production moderne, a provisoirement déserté le prolétariat russe (et mondial) qui, provisoirement, ne parvient plus à penser en termes de changement durable du mode de production, mais qui veut essentiellement répartir autrement les richesses (« socialisme de la consommation » écrit Martov). Le bolchevisme conduirait alors à court-circuiter les lois objectives de l’histoire chère au matérialisme historique qui eussent voulu que la Russie passât d’abord par une phase de développement capitaliste de manière à permettre la socialisation ultérieure des moyens de production : telle est la vieille idée menchévique selon laquelle, dans un premier temps, la Révolution ne pouvait être que bourgeoise en Russie, le prolétariat devant se contenter d’après les mencheviks (mais aussi d’après Kautsky et toute la Deuxième Internationale),
- De soutenir et de radicaliser au maximum la révolution antiféodale de la bourgeoisie russe,
- De mener une lutte économique, syndicale, dans le cadre capitaliste, pour améliorer ses conditions de vie ; c’est ce que Lénine appelait l’ « économisme », et qui réduit le combat prolétarien au syndicalisme (fût-il de classe et de masse), alors que Lénine a démontré dans Que faire ? que « sans théorie révolutionnaire, il n’y a pas de mouvement révolutionnaire » ;
- De créer un grand parti travailliste aux contours flous et à la discipline minimale pour accumuler les forces dans la perspective d’une lutte ultérieure pour la révolution prolétarienne. A quoi Lénine répondra fort justement que « l’on ne peut avancer d’un seul pas si l’on craint de marcher au socialisme » et que « les réformes elles-mêmes sont la retombée des luttes révolutionnaires » : critique radicale de l’anarcho-syndicalisme qui n’est que le double gauchisant de l’électoralisme traditionnel des partis sociaux-démocrates.
Martov compare alors la révolution bolchevique d’octobre 17 à l’élan des masses populaires françaises sous les deux Communes de Paris, celle de 1793 (alliance « maratiste » des Sans Culottes et des Jacobins), et celle de 1871, avec son mixte curieux et détonnant d’anarchisme fédéraliste et de blanquisme volontariste. Martov prédit alors que l’anarchie encouragée par les bolcheviks avec le mot d’ordre – antiétatique et irresponsable (ou machiavélique ?) à ses yeux – « tout le pouvoir au x soviets ! » sera nécessairement compensée au final par un surcroît de blanquisme, c’est-à-dire de volontarisme, de putschisme et de bureaucratisme, sans que les bolcheviks provisoirement victorieux ne parviennent à réorganiser et à planifier durablement la production (ce qui est l’objectif central du socialisme). Au fond, le léninisme serait une résurgence de l’hébertisme dans les conditions russes. A l’arrière-plan de cette critique martovienne, on retrouve le reproche – d’inspiration trotskiste (Trotski fut d’abord menchévik) – de « substitutisme », le but de Lénine étant selon Martov de substituer les soviets à la classe ouvrière, le parti aux soviets et les chefs du parti au parti.
Certes, quand on lit les analyses de Martov, on peut se dire qu’il a vu juste sur certains risques, qui sont à vrai dire inhérents à toute révolution* : notamment le risque que la révolution « se glace » (comme le redoutait Saint-Just), qu’elle soit confisquée par une direction bureaucratisée et qu’en définitive, s’étant coupée des larges masses, elle redevienne une proie facile, et « à retardement », pour la contre-révolution bourgeoise. Pourtant, sur l’essentiel, on est frappé par la cécité de Martov qui ne voit pas
1) Que la révolution d’Octobre fut puissamment démocratique. Dans Dix jours qui ébranlèrent le monde, le célèbre reportage écrit sur le vif par le journaliste américain John Reed, on voit que la révolution d’Octobre ne fut pas seulement une insurrection militaire prolétarienne – ce qu’elle fut AUSSI bien entendu -, mais un immense débat de masse dans tout le pays sur les deux voies possibles : dictature du prolétariat allié aux paysans ou retour à la démocratie bourgeoise avec le risque plus qu’évident de dictature militaire néo-tsariste, de prolongement sans fin de la guerre impérialiste (absente de l’analyse martovienne en tant que facteur politique décisif). Quasiment partout, dans les usines occupées, aux carrefours de Pétrograd, dans les campagnes, se tenaient d’innombrables AG et d’intenses débats contradictoires généralement conclus par des VOTES, ce qui atteste que la dictature du prolétariat bien comprise ne fait qu’un avec la démocratie prolétarienne et populaire la plus débridée. Si d’ailleurs tel n’avait pas été le cas, comment les bolcheviks, qui n’étaient que 200 000, auraient-ils pu gagner la guerre civile déclenchée par les Blancs, soutenue par la plupart des dirigeants mencheviks et alimentée par l’intervention militaire de 18 Etats capitalistes ? bien évidemment, comme pour Robespierre triomphant de la coalition pan-européenne des monarchies, cette victoire eût été impossible sans l’engagement « à la vie à la mort » de la masse du peuple russe (ou français). Rappelons que c’est le même peuple russe qui, en 1917, refusait de se battre dans l’Armée du tsar qui enregistrait défaite sur défaite face aux Austro-Allemands.
2) Certes, la période qui suivit la mort de Lénine, puis la consolidation du pouvoir soviétique, vit une centralisation extrême du pouvoir et un glissement à l’étatisme qui semblent donner raison a posteriori à Julius Martov. Mais outre qu’il faut prendre en compte les conditions extérieures dans lesquelles s’est trouvée la Révolution russe : écrasement préfasciste des révolutions allemande, hongroise et italienne, massacre du PC chinois, passage quasi-total de la IIème Internationale sur les positions antisoviétiques les plus hystériques (notamment en Allemagne), montée du fascisme à l’Ouest et du militarisme japonais à l’Est, outre qu’il faut prendre en compte les propositions de rectification antibureaucratiques que fit Lénine en direction du 12ème Congrès bolchevik, outre que l’élan des masses prolétariennes et paysannes ne s’est pas tari au plus fort de la période centraliste-étatique que D. Losurdo qualifie de « développementiste » (y compris durant la Seconde Guerre mondiale : relire le roman-témoignage de Fadeev La Jeune Garde), il est absurde d’accuser Lénine ou Staline, quels que soient les reproches qu’on peut à divers degré leur adresser sur ceci ou cela (et les critiques communistes n’ont jamais fait peur aux marxistes : Lénine et Rosa Luxemburg ne s’épargnaient pas !), de ne pas avoir su réorganiser la production : au contraire, que ce soit sous le « communisme de guerre » (pendant la guerre civile), sous la NEP, durant les plans quinquennaux, pendant la guerre et dans la période de reconstruction qui suivit les 25 millions de morts Soviétiques causés par Hitler, le pouvoir bolchevik a montré au contraire une aptitude sans précédent à restaurer l’éconoomie en faisant appel au peuple. Sans cela, les Russes seraient morts de faim, Hitler eût gagné la guerre…, Gagarine n’aurait pas été le premier à orbiter autour de la vieille boule et le « bolchevisme » ne se fût pas mondialisé comme jamais dans les années qui suivirent 1945, sans parler des victoires ultérieurement remportées par Cuba, par le Vietnam, l’Angola, etc., avec l’aide de l’URSS et du camp socialiste.
En réalité, le grand art du bolchevisme fut de dialectiser (et non de « substituer » l’une à l’autre) l’activité de l’avant-garde et celle, spontanée, des masses populaires en révolution. Quand on abandonne l’auto-organisation des masses (Commune, Soviets…) et que l’on mythifie « le » Parti, on coupe tôt ou tard ce dernier de sa sève populaire et du bain de critique fraternelle et constructive dont l’avant-garde a besoin pour demeurer l’avant-garde DES masses populaires. A l’inverse, quand on idéalise l’auto-activité des masses en crachant sur l’avant-garde, sur la discipline, sur la théorie révolutionnaire, etc., on livre les masses aux influences de l’ennemi de classe (laquelle détient généralement les moyens d’influence de masse) et c’est le double risque de la décomposition socio-économique et du thermidorisme politique : comme dans le Thermidor qui débarqua Robespierre, les éléments contre-révolutionnaires prennent le dessus au sein même du mouvement révolutionnaire et tôt ou tard, ils le liquident (on l’a vu par ex. quand les sociaux-démocrates aidés par les maoïstes – alors conduits par un certain Jose Manuel Barroso – ont réussi à mettre en minorité le PC portugais du grand Alvaro Cunhal lors de la Révolution des Œillets).
Enfin, les mencheviks qui ont déserté la Révolution d’octobre – au lieu de la soutenir et, pourquoi pas, de lui apporter leurs vues critiques et constructives de l’intérieur – ou qui l’ont carrément combattue aux côtés des Blancs, ou qui ont fait tirer sur les Spartakistes en Allemagne (comme Noske, Ebert et Scheidemann), font au mieux penser à la mouche du coche décrite par La Fontaine : taraudant le vaillant cheval bolchevik quand il tire d’ahan la charrette en pleine cote au lieu de l’aider à grimper, l’insultant s’il échoue à passer le col et l’insultant encore davantage s’il y parvient… tout seul. Bref, faisant comme s’ils étaient d’impartiaux « observateurs » extérieurs au tableau politique qu’ils décrivent, et non pas une force politique petite-bourgeoise dont les hésitations, les reniements voire les trahisons compliquent sans cesse la tâche déjà fort compliquée de l’acteur principal : le prolétariat et son parti de classe, au lieu de lui apporter un soutien, fût-il critique, en privilégiant la question essentielle : QUI donc est au pouvoir, le prolétariat, ou la bourgeoisie ?
par Georges Gastaud
*mais n’est pas révolutionnaire celui qui renonce à la révolution à cause des risques de défaite ou de déviation qu’elle comporte inévitablement, mais celui qui agit pour elle les yeux ouverts sur les risques de défaite et en prenant des mesures préventives contre les risques de déviation.
- Julius Martov, Comment je suis devenu marxiste, éditions Lumpen 2016



![80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale, rôle de l’URSS, 2 conférence d’Annie Lacroix-Riz [ 29 avril – 5 mai – Paris]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/lURSS-dans-la-Seconde-Guerre-mondiale-lacroix-riz-350x250.jpeg)


![Amis de la PAIX : 8 mai 2025, en résistance contre l’Europe de la guerre [Paris – 11h Café du Croissant]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250508-8mai-Paix-antifascisme-PRCF-120x86.jpeg)
![Le retour de la classe ouvrière ! [Achetez, diffusez et offrez IC Spécial 1er mai ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250501-IC270-classeouvriere-120x86.jpeg)