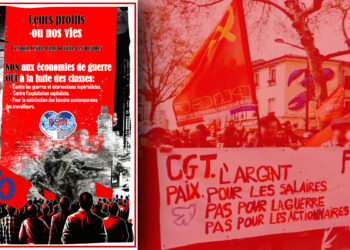En 2016, le gouvernement du président Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) signaient un Accord de paix. Huit années plus tard, le premier président de gauche de l’histoire du pays, Gustavo Petro, s’efforce de relancer la mise en œuvre de cet accord saboté par son prédécesseur de droite radicale Iván Duque. Pourtant, l’ombre d’un absent plane toujours sur la vie politique colombienne : celle de Ricardo Palmera. Charismatique ex-commandant insurgé connu sous le nom de guerre de Simón Trinidad, celui-ci a été extradé en 2004 par le « narco-président » Álvaro Uribe aux Etats-Unis où, au terme d’un procès aberrant, il purge une peine de… soixante ans de prison.

par Maurice Lemoine – initialement publié par nos amis de Mémoires des Luttes https://www.medelu.org/Liberte-pour-Simon-Trinidad
Historique ! Le 24 novembre 2016, le gouvernement du président Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) signaient un Accord de paix censé, du moins sur le papier, mettre un terme à cinquante ans de conflit armé. Huit années plus tard, alors que les FARC ont été légalisées en tant que parti politique, le premier président de gauche de l’histoire du pays, Gustavo Petro, s’efforce de relancer la mise en œuvre de cet accord saboté et paralysée par son prédécesseur de droite radicale Iván Duque.
Ex-guérilleros, ex-paramilitaires, groupes violents dissidents anciens ou récents, narcotrafiquants, gangs urbains, secteurs récalcitrants des Forces armées… L’ambitieux projet du chef de l’Etat – la « paix totale » – se heurte à un mur de protagonistes aux intérêts divergents. Tandis que se multiplient les négociations, les éphémères cessez-le-feu, mais aussi les affrontements, toutes les bonnes volontés susceptibles de participer au plan de « paix totale » et de faire avancer la réconciliation entre Colombiens seraient nécessaires. A commencer par celles d’acteurs prééminents de l’historique conflit. Pourtant, l’ombre d’un absent de marque plane toujours sur la vie politique colombienne : celle de Ricardo Palmera. Charismatique ex-commandant insurgé connu sous le nom de guerre de Simón Trinidad, celui-ci a été extradé en 2004 aux Etats-Unis où, au terme d’un procès honteux, il purge une peine de… soixante ans de prison.
A l’initiative de la Coordination américaine pour les droits des peuples et des victimes de l’emprisonnement politique, une campagne internationale vient d’être lancée pour exiger des gouvernements américain et colombien qu’ils rapatrient Simón.
Aurait-il fallu répondre à l’oppression par la soumission ? La force des faibles c’est la guérilla. L’assassinat à Bogotá, le 9 avril 1948, du leader libéral Jorge Eliécer Gaitán, a mis le feu aux poudres. Il était le favori de la proche élection présidentielle. Il en appelait au peuple contre l’oligarchie. Le crime déclenche une sanglante guerre civile – « la Violencia ». Libéraux et conservateurs s’affrontent à la machette et à coups de fusils. Deux cent mille morts, en 1954, à l’heure d’un premier bilan !
Pour se protéger des hommes de main des « gamonales » [1], des libéraux prennent définitivement les armes, s’organisent en « autodéfenses ». Surgis de paillottes misérables ouvertes à tous les vents, il s’agit essentiellement de paysans. La vie et surtout la mort poursuivent leur œuvre. D’autres hommes et femmes rejoignent les rebelles. On les dit « bolchéviques », ceux-là. L’Etat perd le contrôle de vallées sombres que surplombent des montagnes escarpées. L’Etat les baptise « Républiques indépendantes ». L’Etat décide d’en chasser et d’exterminer les « bandoleros ».
Le 27 mai 1964, le président Guillermo León Valencia lance ses forces militaires sur la supposée République de Marquetalia (Département de Tolima). La zone est encerclée. Elle résiste vaillamment. Trop bien, même. Le 15 juin, des avions déboulent au ras des versants. Les arbres flambent, arrosés de napalm. Les révoltés sentent la terre trembler sous leurs corps allongés.
Une priorité : sauver les familles. Sous les tirs aveugles de la soldatesque, les « guérilleros » ouvrent des « trochas » pour conduire les civils hors de la zone du conflit. On raconte qu’ils étaient quarante-huit. Ils réussissent l’exploit.
Changement de stratégie : d’ « autodéfense », le groupe se transforme en guérilla mobile. Un solide paysan la dirige : Manuel Marulanda Vélez – dit « Tirofijo » (« tire juste »). En septembre, deux cent cinquante combattants se retrouvent à Riochiquito et se dénomment « Bloc sud ». Du 25 avril au 15 mai 1966, ils sont cette fois trois cent cinquante, dans le Sumapaz, lors de la Seconde conférence guérillera. Deux dirigeants émergent : un brillant politique, Jacobo Arenas ; un chef militaire, Manuel Marulanda. Ainsi naissent les FARC, en réponse aux avanies matérielles et sociales qui les ont acculées à se soulever.
Dès lors, dans cette Colombie de l’exclusion sociale, où tant le Parti libéral (PL) que le Parti conservateur (PC) défendent les intérêts économiques de l’oligarchie, la guerre reprend, la guerre se répand, la guerre s’amplifie.
Identité complète : Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda. En abrégé : Ricardo Palmera. Né à Bogotá, le 30 juillet 1950, deux ans après l’assassinat de Gaitán. Leur enfant venu au monde, les parents regagnent immédiatement leur lieu habituel de résidence, la chaude et tropicale capitale du César, Valledupar. Une famille aisée et influente. Le grand-père maternel de Ricardo a été gouverneur du Département de Santander. Avocat et propriétaire terrien, membre du Parti libéral, le père, Juvenal, fut sénateur et vice-ministre de l’Agriculture.
Ricardo fait de brillantes études. Il fréquente le Club social de Valledupar en vrai dandy. En même temps, au cours de quelques voyages touristiques, il devine les mille facettes de la Colombie, mélange aveuglant de luxe et de pauvreté.
Voilà Ricardo jeune cadet à l’Ecole navale Almirante Padilla de Carthagène. Il y croise un jeune lui aussi plein d’avenir, Juan Manuel Santos.
On retrouve plus tard Ricardo à Harvard, pour ses études de troisième cycle, sur la côte Est des Etats-Unis.
Calme, courtois, doté du sens de l’humour, Ricardo Palmera enseigne l’économie à l’Université populaire du César. Puis devient gérant de la Banque du Commerce de Valledupar (Banco del Comercio), au sein de laquelle il gère consciencieusement les comptes des principaux millionnaires de la région. Précédemment, il a aussi exercé à la Caisse du crédit agraire (Caja de Crédito Agraria, Industrial y Minera), une banque de développement au service des secteurs ruraux les plus nécessiteux. L’inégale propriété foncière et les problèmes des paysans du César n’ont plus de secrets pour lui. Il sait que, dans cette société excluante, la vie d’une vache a plus de valeur que celle d’un « peón ».
Depuis qu’il est en âge de réfléchir, Ricardo se prononce pour la paix. L’influence de ses proches. Son père n’était-il pas surnommé « la conscience juridique du César » ? Ultérieurement, la trajectoire professionnelle du jeune banquier le pousse paradoxalement vers la gauche. Radicale ? Sûrement pas. Révolutionnaire ? Encore moins. Un projet émergent enthousiasme alors les progresssistes de Valledupar : le Nouveau libéralisme. Entre 1980 et 1987, Palmera se lance dans la politique, d’abord aux côtés de Luis Carlos Galán et de Rodrigo Lara, qui parcourent le pays pour développer ce courant social-démocrate. Lequel piétine, Galán ratant l’objectif de la présidence après sa défaite électorale de 1982 [2].
Suivi par un groupe d’intellectuels et de professionnels, Palmera fonde un mouvement local, Cause Commune. Son épouse Margarita Russo milite avec lui. Ils ont deux enfants en bas âge. En compagnie d’une camarade, Imelda Daza, Ricardo prend la tête de l’organisation. Dans leur esprit, il s’agit de restaurer les idéaux de Simón Bolivar. Ni plus ni moins. C’est beaucoup, quand même. Possédants et politiques traditionnels considèrent d’emblée l’organisation comme une menace. On soupçonne ses dirigeants d’être des infiltrés de… l’Armée de libération nationale (ELN), autre guérilla née en 1964, très présente dans le sud du César.
Position professionnelle oblige, Palmera demeure le plus discret possible. Il finit tout de même par attirer l’attention. Des militaires l’embarquent, le menottent, le balancent dans une bétaillère, l’expédient à Barranquilla. Pendant cinq jours, privé de sommeil, d’eau et de nourriture, il est « interrogé ». On l’accuse cette fois de soutenir… le M-19 (mouvement armé plutôt urbain au sein duquel milite celui qui deviendra l’actuel président, Gustavo Petro).
Le conservateur Belisario Betancur a été élu. Plus lucide que ses prédécesseurs, il estime que le conflit n’a que trop duré. Le 28 mai 1984, la Commission nationale de paix qu’il a mise en place signe avec les FARC l’Accord de La Uribe, par lequel les belligérants s’engagent à un cessez-le-feu. Celui-ci entre en vigueur le 1er décembre 1984. Dans le cadre de ce pacte, les FARC entreprennent de créer un mouvement politique national : l’Union patriotique (UP). Au programme (qui demeurera une constante) : démocratisation de la vie économique et politique, fin de la violence, construction de la paix « avec justice sociale ».
Des guérilleros abandonnent le maquis et les armes pour participer au projet. Le Parti communiste colombien (PCC) mobilise ses cadres et militants. La gauche non révolutionnaire se met en mouvement. Des orphelins du Nouveau libéralisme se rallient, de même que des organisations et des leaders locaux. A Valledupar, portée par son désir de changement par la voie pacifique, Cause commune adhère à l’UP en 1985.
Lors de l’élection générale du 9 mars 1986, pour sa première participation, l’UP fait élire six sénateurs, neuf représentants (députés), dix-neuf maires et 260 conseillers municipaux [3]. Le nord-est d’Antioquia, le bas Cauca, le Magdalena Medio, l’Urabá, le Chocó, l’Arauca et même l’importante métropole de Medellín lui apportent un soutien conséquent.
L’oligarchie s’agite. Dès juin 1984, un congrès de la très traditionnaliste Fédération colombienne des éleveurs (Fedegan) a affirmé sa volonté « de consacrer l’invulnérabilité de la propriété ». En adepte de la doctrine de Sécurité nationale, le haut commandement militaire considère qu’une solution politique serait un inacceptable succès de la guérilla communiste. Droite comme un cierge, l’Eglise dénonce le même danger. Dans le sillage de tous ces gens, la presse conservatrice soumet les cervelles à un frottement continu. La politique de paix de Betancur se voit sévèrement questionnée.
Le 7 août 1986, le libéral Virgilio Barco accède au pouvoir. L’expérience de l’UP se transforme en bain de sang. Dans cette guerre non conventionnelle, il ne s’agit pas de s’en prendre à la guérilla, mais, par des massacres collectifs et des déplacements forcés, d’éliminer les dirigeants politiques, syndicaux et populaires dans les zones favorables à la « subversion ». De mèche avec les ventres bien remplis et leur armée « officielle », les paramilitaires se chargent de ce sale boulot.
Reconnaître la dangerosité de la situation ne veut pas dire renoncer à agir. L’UP ne se rend pas. Pour la présidentielle à venir, elle choisit l’avocat Jaime Pardo Leal, membre du Parti communiste (parti légal fondé en 1930). Lors de la campagne du candidat à Valledupar, Palmera fait sa connaissance. Au sortir de ce premier contact, il ne cache pas son admiration. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu entre les deux hommes, le 12 octobre 1987, au siège de l’UP, à Bogotá. Elle n’aura jamais lieu. La veille du rendez-vous, Pardo Leal est assassiné.
Dans un rapport publié bien plus tard, le 22 avril 2022, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), un tribunal créé en 2016, indiquera que, entre 1984 et 2007, « sur les 5 733 victimes [membres de l’UP], 4 616 sont mortes à la suite d’un homicide », les autres ayant été la cible de « disparition forcée ».
En cette année 1987, à Valledupar, Palmera voit périr autour de lui de nombreux amis et camarades. Des « listes noires » circulent, porteuses de l’identité des prochaines victimes. Son nom figure sur l’une d’entre elles. L’élimination de Marcos Sánchez, un très proche ami, est la mare de sang qui fait déborder le vase. Dans le Département du Cesar, Imelda Daza et Palmera sont désormais les uniques survivants de la direction régionale de l’UP. Daza s’exile en Suède pour sauver sa peau.
Soumis à une rude pression, Palmera serre les poings. Il a des obligations, des responsabilités professionnelles, une femme, des enfants. Il soupèse les possibilités. Mourir, au coin d’une rue, exécuté d’une balle dans la tête ou dans le dos. Partir à l’étranger ou aller vivre dans une autre partie du pays. « En réalité, racontera-t-il plus tard, jamais je n’avais pensé que je serais guérillero. » Il met sa femme et ses enfants dans un avion à destination du Mexique.Lui ne part pas. Il déteste trop l’oligarchie et ses « sicarios » pour leur donner cette satisfaction. La meilleure option, pour survivre, est de rejoindre les rangs des insurgés. « J’étais incapable de partir en courant comme un chien [4]. »
Un banquier dans la guérilla ! Palmera découvre les FARC. Elles sont « le peuple en armes », une organisation révolutionnaire d’obédience marxiste, dotée d’une plateforme de lutte, d’une proposition sociale, politique et économique, pour une nouvelle Colombie. Dans ses rangs, on ne s’appelle pas « compañero », comme dans tous les mouvements armés d’Amérique latine, mais « camarada ». La norme, pour intégrer l’organisation, impose d’avoir entre 15 et 30 ans. Palmera a 37 ans. S’agissant d’un « intellectuel » de ce calibre, les « comandantes » se permettent une interprétation large des règles qu’ils ont eux-mêmes définies. Palmera choisit son nom de guerre. Il devient Simón Trinidad. Au sein de cette armée très verticale, composée d’une majorité de paysans, sa formation lui assure une rapide ascension. On le charge de la formation politique et de la propagande. Au milieu des années 1990, il est l’un des commandants du Bloc Caraïbe, chargé de l’organisation des masses du Front 41.
Des « marimberos » aux « narcos » : en quelques décennies, la Colombie a beaucoup changé. Producteurs et trafiquants de marijuana, les « marimberos » de la côte atlantique ont vu leur production s’effondrer quand, à la fin des années 1970, les Etats-Unis sont entrés en guerre contre « l’herbe étrangère ». La destruction de milliers d’hectares a ruiné les Colombiens en même temps que, relocalisation oblige, la production nord-américaine explosait.
Parallèlement, les Etats-Unis, encore eux, enregistraient un succès certain dans leur lutte contre la cocaïne au Pérou et en Bolivie. Jusque-là, et depuis la perte de leur marché « marimbero », les trafiquants colombiens s’étaient spécialisés dans la transformation de la pâte base élaborée à partir de la feuille de coca, importée du Pérou et de Bolivie, en produit fini (le chlorhydrate de cocaïne), exporté vers les pays des consommateurs « yuppies ». Ne pouvant plus s’approvisionner en matière première, ils poussent à la plantation de cocaïers, dont la Colombie devient le premier pays cultivateur au monde.
Nées dans les années 1960, les FARC n’ont pas eu besoin de la cocaïne pour exister, survivre et se développer. Leur premier réflexe, lorsque s’est développé le trafic de drogue dans leurs zones d’influence, a été de s’opposer à ce produit de « la dégénérescence capitaliste » [5]. Elles ont dû revenir sur cette position radicale lorsqu’il s’est avéré qu’elles entraient en contradiction avec la stratégie de survie de leur base sociale, les paysans. Ceux-ci n’avaient aucun intérêt à cultiver café, yucca, bananes, maïs ou haricots, faute de marché pour les écouler. Ou avec des revenus tellement faméliques qu’il ne valait pas la peine de s’échiner.
Pragmatique, la guérilla a, d’une part, protégé ces « campesinos » en imposant aux acheteurs et intermédiaires un prix plancher pour la coca ; d’autre part, elle a tiré un parti financier de ce négoce en prélevant un impôt tant sur les producteurs que sur les commerçants, intermédiaires et « narcos » venus récupérer la pâte base ou la coca. Si l’on excepte quelques fronts déviants, passés de l’autre côté de la barrière, cette implication dans la longue chaîne du commerce de la « blanche » n’a jamais fait des FARC un « cartel de la drogue ».
En revanche, c’est aux armées privées narco-paramilitaires que l’Etat a sous-traité la lutte contre la « subversion » tandis que, faux noms, fausses raisons sociales et entreprises fictives,Dieu sait combien la « coke » a permis de financer les nouveaux condominiums luxueux de Cali, Medellin ou Bogotá.
Un réel difficile à appréhender : ramassant les bobards que pulse la mafieuse oligarchie colombienne, le boulevard médiatique rebaptise les FARC « narco-guérilla ». Et fait de ses commandants des « narcotrafiquants ».
Soixante fronts, dix-sept mille combattants : les FARC atteignent leur apogée. Elles engrangent de mémorables victoires militaires. Las Delicias (1996, 27 tués morts, 60 prisonniers) ; Patascoy (fin 1997, 10 soldats tués, 18 captifs) ; El Billar (mars 1998, 60 soldats morts, plus de 40 prisonniers) ; Tamborales (1998, 42 militaires éliminés, 21 capturés) ; Mitú (1998, 30 membres de la force publique tués, 61 policiers emmenés).
Arrivé au pouvoir en août 1998, le conservateur Andrés Pastrana prend acte de l’intenable situation. L’armée est débordée. Non sans arrières pensées moins altruistes, il avance : « La Colombie ne peut pas continuer à être divisée en trois pays où un pays tue, un pays meurt et le troisième rentre sa tête dans les épaules et ferme les yeux. » En octobre, il accorde aux FARC, dans le Cagüán, la zone démilitarisée de 42000 km2 qu’elles réclamaient pour entamer des négociations. Celles-ci débutent officiellement le 7 janvier 1999. Bien que non membre de l’Etat-major central, l’organe de direction des FARC, Simón Trinidad est élevé au rang de négociateur. Au terme d’un voyage de vingt jours, il arrive le 6 juillet dans le campement guérillero, à proximité de San Vicente del Cagüán.
Dans les allées qui séparent les alignées de « cambuches » – sommaires installations individuelles – où les rebelles s’activent, sanglés dans leurs uniformes aussi impeccables que disparates, Simón Trinidad se fait rapidement remarquer. Membre des « comités thématiques », il discute aussi bien avec les représentants du gouvernement qu’avec les diplomates étrangers arrivés en nombre. Sous la tente du « PC information » où, dans le ronflement discret de groupes électrogènes, une batterie d’ordinateurs connectés sur Internet cliquette à longueur de journée, il échange sans réticence avec les journalistes [6]. Il a une réunion avec les ambassadeurs de trente-et-un pays, de l’ONU, de l’Organisation des Etats américains (OEA) et de l’Union européenne pour aborder le thème des cultures illicites. Il établit une relation étroite avec l’américain James Lemoine, envoyé spécial de Koffi Annam, le Secrétaire général des Nations Unies.
Pour le pouvoir, les pourparlers ont en grande partie perdu leur raison d’être lorsque, le 23 août 2000, en inaugurant le Plan Colombie, le président William « Bill » Clinton a octroyé 1,6 milliards de dollars à Bogotá afin d’en terminer avec le narcotrafic – et surtout une opposition armée renommée, pour les besoins de la cause, « narco-guérilla ». L’avalanche des dollars permet aux Forces armées de commencer à se moderniser et à se renforcer.
Le 20 février 2002, le président Pastrana déclare officiellement la rupture du dialogue. Trois heures après cette annonce, le haut commandement militaire lance une série de missions aériennes depuis la base de Tres Esquinas, dans le département de Caquetá. Des vagues d’avions OV-10, AT-37, DC-34 et Kafir, ainsi que des hélicoptères Black Hawk, bombardent quatre-vingt-sept sites de la zone démilitarisée. Une perfidie. Un délai de quarante-huit heures avait été prévu dans les accords pour que les FARC puissent évacuer la zone en cas de cessation des discussions.
Ce sont des guérilleros sur les dents, rageurs, ulcérés, peu enclins à la mansuétude, qui voient arriver sur un de leurs « retenes » (barrage routier) la sénatrice franco-colombienne Ingrid Betancourt. Malgré les multiples conseils de ceux, civils et militaires, qui savent le moment particulièrement délicat, elle a persisté dans son intention de se rendre dans le Cagüán, en tant que candidate (verte) à la prochaine présidentielle. Elle va payer fort cher son imprudence. Considérée comme membre à part entière de « la classe politique », elle est retenue par la guérilla.
A peine rompu le dialogue, Simón Trinidad est parti pour le Département du Meta. Entre mars 2002 et février 2003, il y est chargé de la formation des guérilleros. De là, il passe dans un campement du Caquetá, où il dicte un cours d’économie politique et où, entre autres nouvelles, il entend parler de la chute d’un avion et de la capture de membres américains de son équipage par les « camaradas ».
Comme nous l’expliquera en janvier 2006 le « ministre des affaires étrangères » de la guérilla Raúl Reyes, dans une jungle au sol marécageux ravagé par les pluies, « les FARC ont, ont eu et auront toujours comme politique l’échange de prisonniers. »
Sous Pastrana, les insurgés ont libéré plus de trois cents militaires et policiers capturés lors de leurs spectaculaires victoires militaires. En échange, le gouvernement n’a rendu que quatorze guérilleros malades.
Depuis le 7 août 2002, le « commandant suprême du paramilitarisme » Álvaro Uribe Vélez, élu sur un mandat de « mano dura » (main de fer), a déclaré une guerre totale aux FARC, à l’ELN, à leurs sympathisants et à tous les dirigeants sociaux liés ou non aux guérillas. Washington accompagne sans sourciller cette politique du fait accompli.Les FARC, elles, insistent toujours pour l’ « échange humanitaire », dans lequel elles voient, outre la libération de prisonniers, dont ses propres combattants, un premier pas permettant d’ « humaniser le conflit » et d’ « avancer vers la paix ».
Nommé une nouvelle fois « négociateur », Simón Trinidad franchit clandestinement la frontière équatorienne. Raúl Reyes nous expliquera : « Il était à Quito pour chercher à rencontrer James Lemoyne, avec qui on souhaitait se réunir. Alors, comme c’est difficile de le faire ici, car il fallait demander l’autorisation d’Uribe, et qu’on ne veut ni lui devoir ni lui offrir une faveur, il nous fallait chercher une rencontre ailleurs. »
Il s’agit, dans l’esprit des insurgés, de faciliter une intervention de l’ONU dans les négociations.
S’il a été choisi, c’est parce que, depuis le Cagüán, Trinidad entretient d’excellentes relations avec Lemoyne. Un conseiller spécial des Nations Unies bien peu en cour à Bogotá, au demeurant. N’a-t-il pas récemment déclaré, à propos du gouvernement : « S’il ne veut pas s’asseoir avec les FARC, eh bien, qu’il le dise ! Il y a trop de voix officielles disant oui, disant non, disant peut-être, possible, impossible… Cela ne donne pas confiance aux FARC [7]. »
En résumé, Trinidad a donc pour mission : contacter Lemoyne pour chercher un lieu adéquat à une réunion entre les rebelles et le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annam ; rencontrer des représentants du gouvernement français, que coordonne le diplomate Daniel Parfait, pour trouver une solution définitive à la captivité de « Doña Ingrid » (Ingrid Betancourt) et d’une soixantaine de « prisonniers de guerre » (ou « otages politiques », selon le vocabulaire de chacun) ; établir également le contact avec des émissaires suisses. Pour des raisons évidentes, la France a un intérêt particulier dans l’affaire, la Suisse et le Comité international de la Croix Rouge (CICR) voyant pour leur part d’un très bon œil l’accord humanitaire.
En civil et sans arme, Trinidad débarque le 17 décembre 2003 à Quito avec Lucero, la compagne qu’il a rencontrée dans la guérilla et avec laquelle il a refait sa vie. Quelques jours plus tard, celle-ci appelle sa mère, qui arrive le 26 décembre avec Alix, la fille du couple (9 ans), dont elle a la garde.
Alliance trouble entre le président équatorien Lucio Guttiérrez, l’ « ultra » Álvaro Uribe et la Maison-Blanche, dans le cadre du Plan Colombie, Trinidad est localisé et suivi pendant plusieurs jours. Les porte-flingue qui le surveillent peuvent évaluer rapidement l’absence de protection autour de leur cible et préparer une interception totalement dépourvue de risques. L’arrestation a lieu le 2 janvier 2004, à 20 heures, dans une rue peu animée de Quito, où Trinidad se trouve en compagnie de Lucero et d’Alix. « Nous savions qu’il passait souvent en Equateur, déclare alors à la presse un officier colombien. Nous avons donc monté une opération de filature entre les deux pays, avec la collaboration des Etats-Unis. » Ministre colombien de la Défense, Jorge Uribe Echavarria confirme la participation des services de renseignements américains dans la capture, sans donner plus de précisions. Qui seraient de toute façon inutiles. Impossible de ne pas voir dans l’opération la signature de la Drug Enforcement Administration (DEA) [8] et de l’inévitable CIA.
Aucun temps mort. Un hélicoptère Super Puma appartenant à la Force aérienne équatorienne transporte Simón Trinidad jusqu’à Ipiales, sur la frontière, où il est remis aux autorités colombiennes. Il arrive à Bogotá à bord d’un avion militaire, menotté, enchaîné, encadré par un formidable déploiement de soldats. Avant de monter dans le camion qui va le conduire au siège de la « Fiscalía » (le Parquet général), les menottes qui enserrent ses poignets ne l’empêchent pas de faire plusieurs fois le V de la victoire et de crier, à l’adresse des journalistes : « Vive les FARC ! Vive l’armée du peuple ! » Trinidad a 52 ans. Il est, à en croire les médias, « le premier membre de l’état-major des FARC à tomber aux mains des autorités ». Il prend le chemin de la prison de haute sécurité de Combita, située à 165 kilomètres de Bogotá, à proximité de la ville de Tunja.
Poursuivi pour, entre autres, « terrorisme, rébellion, extorsion, homicide et recrutement de mineurs », Trinidad est condamné début mai 2004 à 35 ans de prison pour « enlèvements et rébellion ». La justice colombienne doit encore le juger pour « assassinat et terrorisme ». Mais Álvaro Uribe veut davantage. Il veut faire un exemple de ce trophée.
Dès le 4 janvier 2004, trois jours à peine après l’arrestation de l’émissaire de la guérilla, William Wood, l’ambassadeur des Etats-Unis à Bogotá, a expédié un câble classé « confidentiel » (dont on aura connaissance grâce à Wikileaks) à Washington : « De hauts responsables du gouvernement colombien, dont le président Uribe, ont demandé aux Etats-Unis d’envisager l’extradition de Palmera. De toute évidence, ils préféreraient le voir enfermé dans une prison américaine plutôt que poursuivi devant le système judiciaire colombien, peu fiable. Leur demande a un caractère d’urgence. Cependant, Palmera ne fait actuellement l’objet d’aucune accusation criminelle aux Etats-Unis. L’ambassade n’est au courant d’aucune enquête en cours contre ce narcoterroriste renommé par les agences officielles des Etats-Unis [9]. »
Aucune charge contre Simón Trinidad ! Il faut donner aux « States » un os à ronger. L’opération va prendre un an. Procureurs, faux témoins et émissaires multiplient les navettes Bogotá-Washington, Washington-Bogotá. Un obstacle doit être contourné : tant les traités d’extradition entre la Colombie et les Etats-Unis que la législation internationale mentionnent que les personnes accusées ou condamnées pour « délit politique » (rébellion, sédition, émeute) ne peuvent être soumises à une extradition. Et alors ? Uribe et son procureur général Camilo Osorio n’en sont pas à un « faux positif » près [10] : le dossier qu’ils montent de toutes pièces accuse Trinidad d’avoir œuvré, lorsqu’il se trouvait dans le Cagüán, à envoyer des tonnes de cocaïne aux Etats-Unis.
Narcotrafiquant ! Voilà qui est totalement imparable dès lors qu’il s’agit d’alimenter la vindicte des « Yankees ».
Uribe masque son dessein véritable en annonçant qu’il extradera le guérillero si soixante-trois « otages » aux mains des rebelles – cinquante-neuf Colombiens, trois Américains, un Allemand et Ingrid Betancourt – ne sont pas libérés unilatéralement avant le 30 décembre 2004. Ce qui, bien entendu, n’a rien à voir avec un échange de prisonniers. Les FARC ne donnent aucune suite à la provocation. La voie est libre. En novembre, la Cour suprême de justice (CSJ) a fait ce qui lui était demandé : en violation de toutes les dispositions légales, elle a levé le dernier obstacle en autorisant la déportation.
Le 31 décembre, un hélicoptère mène Trinidad de la prison de Combita à Catam, une base militaire proche de Bogotà. De là, escorté par quatre agents du FBI, le révolutionnaire entame le voyage vers l’Aéroport Ronald Reagan de Washington, à bord d’un avion de la DEA.
Réceptionné par une impressionnante opération policière, Trinidad disparaît dans le premier des culs-de-basse-fosse où la vengeance de l’Etat paramilitaire et de l’Empire vont le maintenir pendant une durée infinie.
Ce qui suit rappelle trait pour trait la répugnante histoire des « Cinq Cubains de Miami » – cinq agents de renseignement envoyés par La Havane infiltrer sans violence les réseaux terroristes anticastristes de Miami et qui, repérés, furent arrêtés par le FBI le 12 septembre 1998 [11]. Le genre de vindicte à l’état pur que réservent les « démocraties exemplaires » à ceux qui ont osé les défier – Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal, Julian Assange (en France, Georges Ibrahim Abdallah), sans parler de la punition collective irrationnelle imposée par plus de 60 ans de blocus aux Cubains.
Jamais, pendant les trois années que vont durer ses procès, Simón Trinidad ne verra le soleil, confiné qu’il est dans une cellule de 3m20 sur 1m80. « A cet isolement interne sans contact personnel, visuel ou écrit avec les autres prisonniers, témoignera-t-il à travers celui qui va devenir son biographe, Jorge Enrique Botero, s’ajoute un isolement du monde extérieur puisque je ne peux pas écouter la radio, voir la télévision ou recevoir des journaux. Non seulement on m’interdit de parler à mes avocats américains par téléphone (…) mais, depuis 2004, je ne me réunis pas avec eux parce que le juge [Thomas] Hogan conditionne les réunions à la présence d’un agent du FBI pour qu’il surveille les conversations (…) Derrière tout ça existe l’intention voilée et subtile de générer un supplice psychologique qui est pire que le physique, qui ne laisse pas de trace visible et qui prétend miner mon moral, briser mon courage et ma volonté de lutter [12]. »
Le premier procès se déroule entre le 3 octobre et le 21 novembre 2006, deux ans après l’extradition. A la question initiale « comment souhaitez-vous être appelé, Ricardo Palmera ou Simón Trinidad ? », le rebelle répond sans une seconde d’hésitation : « Simón Trinidad ! » Comme pour les procès qui suivront, le juge refuse systématiquement la participation des témoins convoqués par les trois avocats commis d’office. En revanche, l’accusation peut déployer une véritable petite mafia. Venus de Colombie, logés dans des hôtels de première catégorie, trente-et-un témoins coûtent plusieurs millions de dollars au gouvernement américain. Soigneusement « briefés » par les policiers et militaires colombiens ainsi que par les agents de la DEA, la plupart sont des délinquants, des corrompus et des déserteurs de la guérilla, bénéficiaires du programme de « protection des témoins », qui va leur permettre une nouvelle vie aux Etats-Unis. Il s’agit donc pour eux de ne pas décevoir leurs bienfaiteurs. De leur côté, les procureurs et les agents du FBI donnent l’exemple en inventant des charges et en mentant cyniquement.
Pour autant, la volonté forcenée d’en finir avec Trinidad ne donne pas les résultats escomptés. Ce premier procès pour « terrorisme » se termine par une annulation. Malgré les artifices, les subterfuges et les menteries, les jurés n’ont nullement été convaincus ! Très contrariés, les procureurs annoncent qu’ils vont demander l’ouverture d’un nouveau procès.
Juin et juillet 2007. Six semaines à nouveau devant la Cour du District de Columbia [13]. Le 7 juillet, encore un coup de théâtre : les jurés notifient qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord pour un verdict. Sortie de la manche de l’accusation, cette histoire d’ « Américains séquestrés », dont Trinidad serait responsable, ne les inspire pas vraiment.
Mais de quoi s’agit-il ?
Retour au 12 février 2003.
Ce jour-là, un monomoteur Cessna 208 décolle de l’aéroport de Catam et atterrit pour faire le plein de combustible sur la base militaire de Larandia. A bord, cinq hommes. Le pilote Tommy Janis (retraité de l’US Air Force), Luis Alcedes (sergent colombien du renseignement) et trois « contractors » américains, Thomas Howes (co-pilote), Keith Standell (analyste systèmes, chef de mission) et Marc Gonsalves (dix ans au sein de l’US Air Force). Ce ne sont pas des touristes. Les Étatsuniens travaillent pour California Microwave Systems, filiale de Northrop Grumman, troisième entreprise mondiale d’armement, elle-même sous-traitante du Pentagone. Il y a alors 279 civils « contractors » en Colombie. Leur présence permet de dépasser la limite imposée par le Congrès – 400 militaires étatsuniens présents dans le pays – pour la mise en œuvre du Plan Colombie.
Tous les matins, à bord du Cessna, l’équipage photographie et filme officiellement les « cultures illicites », moins officiellement le Front 15 des FARC, dont il cherche à repérer les positions. Les informations sont immédiatement envoyées au Southern Command (le commandement sud de l’armée des Etats-Unis), au Département de la Défense, à la DEA et à l’ambassade US à Bogotá.
L’appareil redécolle de Larandia. Quatorze mille pieds, niveau de croisière habituel, au-dessus du Caquetá. Soudain, le moteur crachouille, l’hélice tourne par à-coups. Puis s’immobilise. Impossible de regagner une piste d’atterrissage. Le pilote aperçoit un semblant de clairière dans la forêt. Il amorce une descente improvisée. Devenu hors de contrôle, l’avion s’écrase au sol et se casse en deux.
A proximité des débris, les secours découvriront les cadavres de Janis et Alcedes, avec des impacts de balles. Howes, Standell et Gonsalves sont portés disparus.
Le 21 février, les FARC informent qu’une des unités de son Bloc Sud a en son pouvoir les trois « agents de la CIA » survivants. Trois jours plus tard, elles les déclarent « prisonniers de guerre » et assurent qu’ils ne retrouveront la liberté qu’en cas d’échange humanitaire. Celui-ci étant écarté par Uribe, Howes, Standell et Gonsalves demeureront captifs jusqu’à ce que, le 4 juillet 2008, l’ « Opéración Jaque », montée par les forces armée colombiennes, ne les libère en même temps qu’Ingrid Betacourt et douze autres prisonniers [14].
Qu’a à voir Simon Trinidad avec l’ensemble de ces événements ? Strictement rien. Contrairement aux allégations des médias, il n’appartient pas à l’état-major central de la guérilla. Au moment de la capture des « contractors », il n’opérait pas dans la zone et n’y exerçait aucune responsabilité. L’accusation en est consciente. Elle sait que la comédie qu’elle va jouer ne rime à rien. Elle décide donc de truquer le jeu. Réfutant que les FARC soient les protagonistes d’un conflit armé interne, le juge empêche la présentation de dizaines de preuves attestant de leur caractère insurgé. Il interdit également de mentionner que l’espionnage aérien auquel se livraient les trois Américains, dans une zone de guerre, pour le compte final du Southern Command, constituait une action à caractère militaire faisant d’eux non des « otages » mais des « prisonniers ».
De qui se moque-t-on ? Même les jurés américains tiquent devant cette histoire à dormir debout. Pour emporter le morceau, les procureurs doivent se livrent à un dernier tour de passe-passe : ils accusent Trinidad de « conspiration » pour séquestrer Stansell, Goncalves et Howes. En droit étatsunien, une conspiration est « un accord illégal établi entre deux personnes ou plus pour commettre un délit. Point n’est besoin que le délit soit commis. Tout ce que doit faire l’accusation est de démontrer, sur la base d’une preuve circonstancielle, qu’un accord « doit avoir existé » ». En d’autres termes : aucune preuve irréfutable n’a besoin d’être présentée. C’est la technique qui fut utilisée pour faire condamner à des peines exorbitantes les cinq Cubains précédemment évoqués.
Mais, quand bien même, s’agissant de Simón Trinidad… Comment parler de « conspiration » quand la capture des trois « contractors » ne fut rendue possible que par le hasard d’une panne de moteur de leur avion ?
Pendant une pleine semaine, une membre du jury refuse catégoriquement de déclarer Trinidad coupable. Des pressions particulièrement agressives la font finalement céder. « Guilty » ! Plus tard, le 28 janvier 2008, pour l’enlèvement de « trois civils américains » en Colombie, le juge Royce Lamberth annoncera le verdict : 60 ans de prison (20 pour chaque « otage séquestré »).
Entre la condamnation et l’énoncé de la peine, un troisième et un quatrième procès ont eu lieu, les 20 août et 4 octobre 2007. Cette fois, sept des douze jurés ont estimé Trinidad « non coupable » de l’exportation de drogues illégales vers les Etats-Unis. Les procureurs ont dû retirer l’accusation de « narcotrafic ». La raison « officielle » pour laquelle le rebelle a été extradé !
Dans un courrier envoyé avant la fin des procès à sa compagne Lucero pour évoquer son futur, Trinidad, la tête haute, écrivit : « Je suis déjà préparé psychologiquement pour ça. Si c’est le prix à payer pour nos idéaux et pour les principes qui nous poussent à la lutte et qui donnent sa raison d’être à notre existence, que cela se fasse, et vive la prison ! D’autres feront usage de leur liberté physique pour construire nos rêves d’un monde sans exploiteurs ni exploités. »
Ensuite, le calvaire prévu a commencé.
Florence SuperMax, au milieu des montagnes du Colorado, la prison de haute sécurité la plus crainte du pays. « L’Alcatraz des Rocheuses » l’ont baptisée ses détenus – particulièrement dangereux [15]. Condamné sous « mesures administratives spéciales », Simón Trinidad, matricule 27896-016, est enterré vivant dans une cellule souterraine de 2,60 m sur 3 mètres – lourde porte coulissante, étroite couchette encastrée dans le mur, grille d’arrivée d’air, banc et cuvette des toilettes en acier…
Pas de soleil ni de contact avec les autres détenus, aucuns livres, revues ou téléviseur. La lumière, 24 heures sur 24 – impossible de savoir s’il fait jour ou s’il fait nuit. On refuse à Trinidad tout matériel pour apprendre l’anglais. A l’exception de celui échangé avec quelques membres de sa famille, préalablement lu par le FBI, on lui interdit d’envoyer ou de recevoir du courrier. Il ne peut pas plus accéder aux dossiers des procès ouverts contre lui dans son pays ni rencontrer ses avocats colombiens. Seule une poignée de personnes, préalablement autorisées par l’administration, peuvent, très rarement, le visiter. Attention médicale ? Néant.
« Il se trouve dans des conditions infrahumaines, dénoncera en 2017 l’un de ses avocats, Mark Burton. Il est seul depuis près de onze ans… Les normes internationales disent qu’il est préférable de ne pas garder une personne à l’isolement pendant plus de… soixante jours parce que cela endommage l’esprit, l’humeur d’une personne. Beaucoup deviennent fous (…) avec de nombreux problèmes psychologiques [16]. »
ien n’a fait plier Simón Trinidad. Même pas le pire. Même pas l’annonce de la plus terrible des nouvelles.
En 2012, sa fille Alix a 18 ans. Elle passe son baccalauréat. Pour fêter l’événement, elle obtient l’autorisation exceptionnelle de visiter Lucero, sa mère « guérillera », la compagne follement aimée de Trinidad, dans le campement du Front 48 des FARC.
Le 19 septembre, le bourdonnement de plusieurs avions de combat précède le largage de quinze tonnes de bombes. Lucero et Alix périssent sous l’avalanche, de même que vingt guérilleros.
L’épouvantable douleur transperce Trinidad de part en part. Mais il ne flanche pas. C’est un « Homme de fer » dira de lui le journaliste Jorge Enrique Botero.
Les conditions de détention de l’ex-guérillero ne se sont légèrement améliorées qu’après treize années de cet isolement infernal. Trinidad peut désormais sortir deux ou trois heures par jours de sa cellule, parler avec quelques prisonniers, faire de la gymnastique et étudier. Ses contacts extérieurs se limitent néanmoins à quelques proches : le fils issu de son premier mariage avec Margarita Russo, qui réside en Floride, son frère, des membres de la famille vivant à Valledupar auxquels s’ajoutent les avocats Robert Tucker et Mark Burton. Il n’a droit qu’à quatre appels téléphoniques de 15 minutes par mois, uniquement à des membres de sa famille.
Uniques exceptions, en octobre 2007, lorsque la sénatrice colombienne Piedad Córdoba, infatigable avocate de l’ « échange humanitaire » de prisonniers, a pu rencontrer son compatriote, puis, en janvier 2016, quand le sénateur de gauche Iván Cepeda et l’avocat et conseiller juridique des FARC Enrique Santiago ont été autorisés à le visiter. On était alors en pleines négociations de paix entre gouvernement et guérilla. Tous faisaient partie des personnalités cherchant à le faire libérer.
Le Plan Colombie a inversé le rapport de forces. Les FARC ont subi à leur tour de durs revers. Après le décès de leur « ministre des Affaires étrangères » Raúl Reyes sous un bombardement (mars 2008), la mort naturelle du leader historique Manuel « Tirofijo » Marulanda (mars 2008), la disparition au combat du chef militaire Mono Jojoy (septembre 2010), l’assassinat du nouveau « numéro un », Alfonso Cano, favorable au dialogue, mais néanmoins sommairement exécuté alors qu’il avait été blessé (novembre 2011), aucune issue militaire au conflit n’apparaît possible – l’armée, malgré ses succès, n’étant pas non plus en situation de l’emporter.
Menés à La Havane, terminés en 2016, les pourparlers amenant à la signature d’un accord de paix ont débuté en 2012. Durant ces quatre années, les représentants des FARC ont insisté pour que Simón Trinidad rejoigne leur équipe en tant que porte-parole et négociateur. « Il me semble que l’absence de Simón à cette table priverait le pays d’un des plus grands esprits que nous ayons en Colombie, expliqua dès 2012 l’un des responsables de l’organisation insurgée. C’est un guérillero, mais pas seulement, il est issu de la haute classe dirigeante colombienne. » On suggéra qu’au minimum Trinidad pourrait participer aux discussions par vidéoconférence. Présenté comme un « symbole de la dignité des lutteurs populaires d’Amérique latine », nommé membre de la délégation de paix de la guérilla, Trinidad apparut tous les jours dans le Palais des conventions de La Havane, sous forme d’un mannequin à son effigie, au milieu de ses camarades Iván Márquez, Rodrigo Granda, Andrés París, Marcos Calarcá, Jesús Santrich et Pablo Catatumbo.
nterrogé pendant les négociations, le président Juan Manuel Santos prétendit qu’il était « ouvert » à un retour de Trinidad, mais, ajouta-t-il, « la décision ne dépend pas du gouvernement colombien ». Moyennant quoi, les FARC envoyèrent à Barack Obama un courrier dans lequel ils demandaient la grâce de Simón.
Ils attendent encore la réponse…
C’est que, au même moment, les sénateurs républicains Marco Rubio (Floride) [17] et Lindsay Graham (Caroline du Sud) demandaient publiquement au président étatsunien de refuser tout rapatriement de l’ex-guérillero dans son pays, suggérant qu’une telle incongruité mettrait en péril l’octroi de 450 millions de dollars sollicités par le chef de l’État au Congrès pour appuyer le processus de paix en Colombie.
Toutefois, même en fin de mandat, alors que, les Accords ayant été signés entre FARC et pouvoir colombien, Obama aurait pu défier les faucons étatsuniens, il refusa d’accorder une telle grâce à Simón Trinidad. Avec l’entrée tonitruante de Donald Trump à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2017, la question ne mérita même plus d’être posée.
Système de justice transitionnelle créé en Colombie après l’historique poignée de mains de 2016, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a pour objet d’enquêter, juger et éventuellement condamner (à des peines substitutives à la prison) toute personne responsable d’avoir commis des violations des droits humains pendant un demi-siècle d’affrontements. Pour sa part, la Commission de la vérité est chargée de faire toute la lumière sur les tenants et aboutissants d’un conflit qui a impliqué guérillas, paramilitaires et forces armées.
« J’ai conversé avec la Commission Vérité, révéla en décembre 2019 l’avocat Mark Burton, et ils veulent parler avec Simón. Ils croient que Simón est une personne très importante, qui a beaucoup à apporter au peuple colombien sur son histoire et son avenir. J’ai également rencontré Patricia Linares, présidente de JEP et cette juridiction souhaite également que Simón soit là pour faire partie du processus. »
Trinidad, en ce qui le concerne, exprime régulièrement avec force son désir d’être entendu par la JEP.
Quatre ans plus tard, alors que pour la première fois de son histoire la Colombie a un président progressiste, Burton donne l’impression de bégayer : « Nous avons besoin d’un dialogue entre le président Petro et le président Biden sur le rôle important que Simón peut jouer [au sein de la JEP]. Sa connaissance institutionnelle de la guerre civile peut mobiliser et unir de nombreux Colombiens pour soutenir le processus de paix chancelant [18]. »
En septembre 2023, sous la présidence de Petro, la JEP a annoncé qu’elle accepte Trinidad dans son programme. Ministre des Affaires étrangères à ce moment, Álvaro Leyva, avocat très engagé, depuis 1984, dans le processus de paix, a publiquement apporté son soutien à un éventuel retour de l’ex-guérillero et, tout en estimant la situation « difficile », a affirmé que des canaux étaient ouverts à cet effet. Depuis, dans le cadre de l’offensive permanente de la droite « radicaloïde » contre les réformes sociales de Petro, Leyva a été suspendu pendant trois mois, puis six, puis définitivement, par le Bureau du procureur (« Procuraduría ») pour de supposées irrégularités – qu’il conteste – dans un appel d’offres destiné à choisir l’entreprise chargée d’imprimer les passeports neufs du pays. Leyva fut remplacé provisoirement, puis définitivement par Luis Gilberto Murillo, jusque-là ambassaeur de Colombie aux Etats-Unis. Ex-ministre de Santos, appartenant à l’aile la plus à droite du gouvernement Petro, Murillo, après avoir purgé le ministère des fonctionnaires proches de Leyva, se distingue particulièrement, ces derniers temps, par son ingérence dans les affaires internes du Venezuela et par ses attaques incessantes contre le gouvernement du président Nicolás Maduro.
Quant à Simón Trinidad, il semble n’en avoir jamais entendu parler.
Dans ce domaine comme dans bien d’autres, autant de protagonistes, autant de traitements différents…
Après avoir signé avec un Etat qu’ils n’avaient jamais affronté et dont ils étaient les supplétifs un « accord de paix » en 2015, à El Ralito, quatorze chefs paramilitaires furent expédiés manu militari par leur « ami » Álvaro Uribe, le 13 mai 2008, aux Etats-Unis. Des têtes devaient tomber pour éviter que d’autres ne subissent le même sort, plus haut placées. Jugés et emprisonnés là-bas pour « narcotrafic », ils ne pouvaient plus l’être en Colombie pour crimes de guerre et crimes contre l’Humanité, ni révéler leurs liens, dans le cadre de la « guerre sale » avec les Forces armées, l’élite politique, la crème économique et le « para-président ». Magnifique opération pour Uribe, infâme trahison pour les « saigneurs de la guerre » extradés.
Considérés comme de moindre importance, d’autres furent jugés en Colombie et condamnés à la peine maximum de huit ans de prison prévue dans la Loi 975 de 2005, négociée dans le cadre des « accords de paix » dits de Ralito. C’est ainsi que, le 22 juillet 2014, un premier criminel « paraco », José de Jesús Pérez Jiménez, alias « Sancocho » (13 condamnations, 231 crimes de guerre et de lèse-humanité), retrouva la liberté. Un an plus tard, le sanguinaire Freddy Rendón Herrera, alias « el Alemán » (1500 assassinats dans le Choco) fut à son tour libéré. En mai, l’ex-chef du Bloc central Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, l’avait précédé.
Avant la fin 2014, onze leaders paramilitaires également incarcérés en Colombie et ayant fait chacun entre 144 (Manuel Pirabán, alias « Pirata ») et 5639 victimes (Uber Enrique Banquez) avaient retrouvé la liberté. En y rajoutant les hommes de rang, un total de 161 bourreaux du mouvement populaire arpentaient alors à nouveau les rues.
Qui ne connaît Ramón Isaza Arango, dit « El Viejo », en Colombie ? Il fut l’un des fondateurs et des chefs les plus importants du paramilitarisme. Commandant général des Autodéfenses paysannes du Magdalena Medio, il a déclaré, quand il s’est soumis à la justice, avoir « des problèmes de mémoire » et ne pas vraiment se souvenir des crimes commis par ses hommes et lui. Des centaines de monstruosités, probablement des millliers. Il fut pour sa part libéré début février 2016 et placé sous bracelet électronique au terme de dix années d’incarcération.
Aux Etats-Unis, la condamnation de Juan Carlos « el Tuso » Sierra pour narcotrafic ne lui a valu que… cinq années d’emprisonnement. Relâché le 14 mai 2013 et devenu informateur de la DEA, il obtint un permis de séjour et put rester, avec sa famille, au « pays de la liberté » (dans un cas aussi exemplaire, comment l’appeler autrement ?). Même mansuétude pour Gustavo Álvarez Téllez, alias « Gordo Tavo ». Considéré un temps comme « l’un des dix délinquants les plus recherchés de Colombie » par le président Santos, arrêté dans l’île d’Aruba le 11 mai 2011, au terme d’une enquête et d’une poursuite qui coûtèrent des sommes considérables, il fut condamné par la Cour du District est de New York, pour avoir exporté 120 tonnes de cocaïne au cours des deux années précédentes, à… 36 mois de prison. Au terme de sa peine, converti en « délateur professsionnel », il solda sa dette envers la société en subissant une épouvantable « liberté surveillée » de cinq ans [19].
Le plus connu de tous, et peut-être le plus inhumain à l’époque, s’appelle Salvatore Mancuso. Commandant de deux des groupes paramilitaires les plus féroces – les blocs Nord et Catatumbo –, il a été l’un des stratèges de la « guerre sale ». Et pour l’animer, il l’a animée : plus de 5000 victimes, dont environ 500 ont été incinérées dans des fours crématoires après leur assassinat et sont officiellement « disparues ».
Mancuso fait partie de la charrette expédiée en 2008 par Uribe aux Etats-Unis. « Avec moi, il a extradé la vérité », s’exclama-t-il alors, avant d’intégrer un établissement pénitentiaire de haute sécurité d’Atlanta. Condamné à quinze ans et huit mois pour « narcotrafic » par la Cour du District de Columbia, il a terminé sa peine en 2020, douze ans après son extradition. Ne sachant trop qu’en faire, la justice américaine le confina dans un centre de détention pour migrants où il resta jusqu’à février 2024.
Depuis sa cellule, aux Etats-Unis, par vengeance contre Uribe ou parce que réellement repenti, Mancuso n’a jamais cessé de collaborer en visio avec la JEP, « parlant » beaucoup et, par ses révélations, paniquant l’« establecimiento ». Le 26 août 2022, au cours d’une vidéoconférence organisée par la Chambre de Justice et Paix, il a demandé pardon aux familles de plus de 400 victimes réunies dans le Département de l’Atlantique avant de déclarer, interrogé par Caracol Radio : « Avec [mon] expérience, je peux contribuer à parvenir à une paix totale, après des années pendant lesquelles ceux qui ont bénéficié des groupes d’autodéfense ont réussi à accumuler le pouvoir et ont essayé par tous les moyens de nous faire taire et de nous laisser sans droits politiques. » Ce qu’il ajouta immédiatement provoqua un fort émoi : « Si le gouvernement de Gustavo Petro veut nous appeler pour tout travail visant à parvenir à une paix totale, ici nous sommes prêts à tout lui apporter. »
Finalement rentré en Colombie en février 2024, Mancuso a retrouvé la liberté le 10 juillet après que le Tribunal supérieur de Bogotá, estimant respectées les conditions imposées par la Loi Justice et paix de 2005, ait levé les 57 mandats d’arrêt le concernant.
En août 2023, avant même le retour de l’ex-paramilitaire au pays, le président Petro, sensible à sa proposition d’œuvrer au succès des négociations avec les groupes encore insoumis, l’a nommé officiellement « gestionnaire de paix ».
Une libération n’arrivant jamais seule, un autre « massacreur » notoire des années 1990 (3000 crimes confessés), Hébert Veloza García, alias « HH », est sorti le 25 juillet de la prison d’Itagüí (Antioquia) où il séjournait depuis le 26 décembre 2017, date de son retour du Metropolitan Correctional Center de New-York, au terme d’une peine de huit années pour « narcotrafic ».
Bref, pour le paramilitarisme d’extrême droite et le terrorisme d’Etat [20], tout est souvent bien qui finit bien.
Dans de telles circonstances, l’interminable détention de Simón Trinidad, déjà profondément inique, devient une véritable honte, impliquant aussi bien Washington que Bogotá. Rescapé du massacre des militants de l’UP et à ce titre victime du terrorisme d’Etat, protagoniste du conflit armé, Simón a droit au même traitement que les autres acteurs – guérilleros ou « paracos » – qui ont signé la paix ou purgé leur peine. Révolutionnaire, il a abandonné une vie confortable pour sauver sa vie, mais aussi parce qu’il souhaitait une Colombie humaine pour ses compatriotes. Innocent du crime par ailleurs inexistant pour lequel il a été condamné, il doit être libéré. Si elle va à son terme, sa lourde peine de 60 ans ne lui permettra pas de sortir de captivité vivant. Les administrations des présidents colombien Gustavo Petro et américain Joe Biden doivent donc prendre les mesures juridiques pertinentes et nécessaires pour que Trinidad soit rapatrié en Colombie dans les plus brefs délais afin d’y participer à l’élaboration du Plan de paix. Et il y a urgence. Le retour au pouvoir de Donald Trump laissant peu augurer d’un surplus d’équité, une telle mesure d’amnistie doit être arrachée avant la fin du mandat de Biden, le 20 janvier 2025.
[1] Propriétaires terriens disposant de pouvoir politique.
[2] Ayant réintégré le Parti libéral, Galán sera assassiné durant la campagne présidentielle de 1989. Devenu ministre de la Justice sous la présidence de Belisario Betancur, Lara l’avait été par le narcotrafic le 30 avril 1984.
[3] Rodrigo Santofimio Ortiz, « La izquierda y el escenario político en Colombia : el caso de la participacion política de la Unión patriótica (UP) » – http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes9_7.pdf
[4] Jorge Enrique Botero, Simón Trinidad. El hombre de hierro, Ocean Sur, La Havane, 2014.
[5] Voir Alain Labrousse (2001) : https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=31516
[6] Lire Maurice Lemoine, « En Colombie, une nation, deux Etats », Le Monde diplomatique, mai 2000.
[7] El Tiempo, Bogotá, 18 mai 2003.
[8] Agence fédérale étatsunienne chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues.
[9] https://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA85_a.html
[10] « Faux positifs » : déguisés en guérilléros par l’armée colombienne afin de gonfler ses statistiques, 6 402 innocents ont été enlevés et assassinés, présentés comme des morts au combat, entre 2002 et 2008, pendant l’administration Uribe – d’après la Justice spéciale pour la paix (JEP), le 18 février 2021).
[11] En décembre 2001, René González sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement ; Fernando González à dix-neuf ans ; Ramón Labañino, Antonio Guerrero et Gérardo Hernández à perpétuité. Ils seront finalement libérés entre 2011 et 2014, en partie grâce à un échange de prisonniers. Leur histoire romancée a été racontée dans Cinq Cubains à Miami (Maurice Lemoine, Don Quichotte, 2010) et dans le film d’Olivier Assayas, Cuban Network (2020).
[12] Jorge Enrique Botero, op.cit
[13] Situé sur la côte Est, baigné par le fleuve Potomac, le District de Columbia abrite Washington, la capitale fédérale américaine.
[14] Le gouvernement colombien et les Américains ont négocié la libération des « otages » en payant les deux chefs guérilleros qui en avaient la garde.
[15] L’un des « Cinq », le cubain Antonio Guerrero, a été incarcéré dans cette prison jusqu’en janvier 2012.
[16] https://prensarural.org/spip/spip.php?article22323#nb11
[17] A l’heure où nous bouclons cet article, Marco Rubio est pressenti pour devenir le Secrétaire d’Etat (ministre des Affaires étrangères) de Donald Trump.
[18] https://fightbacknews.org/articles/el-abogado-de-simon-trinidad-habla-en-la-convencion-de-sds
[19] https://www.elcolombiano.com/historico/narcos_buscan_jubilarse_en_eu-NXEC_299958
[20] D’après le rapport de la Commission de la vérité rendu public le 28 juin 2022, la responsabilité des morts incombe pour 45 % aux paramilitaires, 12 % aux forces de l’ordre (soit 57 % au terrorisme d’Etat) et 27 % aux guérillas.


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)