
Le 24 août 1944, Léon Landini, âgé d’à peine 18 ans, s’évadait de la sinistre prison du Fort-Montluc, après un mois de tortures. Ce jour-là, l’insurrection de ses camarades à Villeurbanne lui permit de se sauver. Voici un court extrait du livre de Gilda Landini-Guibert, « Le fil rouge », racontant son évasion.
Ce 24 aout 2024, se souvenir de ce 24 aout 1944, avec Léon Landini résistant d’aujourd’hui, président du PRCF, c’est ensemble poursuivre avec force le combat de la résistance.
L’évasion de Léon Landini du Fort-Montluc.
Toute la journée, la prison a vécu au rythme des coups de fusil et des rafales de mitraillette. Les cœurs des détenus bondissent dans leur poitrine ! Sûr que c’est la fin des haricots pour les Boches ! Ce qui se passe derrière les murs de la prison, ce n’est pas une escarmouche isolée : le peuple français a enfin pris les armes contre les bourreaux ! Ils vont devoir fuir les salauds !
D’ailleurs, depuis ce matin, les couloirs résonnent d’aboiements gutturaux, d’ordres et de contre-ordres, de va et vient précipités dans les escaliers. Les prisonniers ne savent pas trop ce qui se passe, mais de toute évidence, les Allemands préparent leur départ.
– Eux pas partir et laisser nous dedans ! Nous trop connaître les horreurs d’eux ! Nous pouvoir trop raconter ! Eux faire sauter nous dedans ! Tu avoir entendu bruits dessous prison ?
Nicolas, le Russe fait retomber d’un seul coup l’atmosphère de liesse qui règne dans la cellule. C’est vrai, que depuis plusieurs jours, des bruits étranges parviennent des fondations et cela ressemble bien à des marteaux piqueurs. Mais il semble impensable de croire, qu’afin d’effacer toute trace de leur crime, les nazis soient capables d’en perpétrer un plus ignoble encore : faire sauter la prison avec presque un millier d’hommes à l’intérieur ! Ce n’est que bien des années après la guerre que Léo apprendra que des travaux de minage avaient bel et bien été commencés sous Montluc afin de faire disparaître à la fois les preuves et les témoins du massacre. Les Allemands n’ont pas eu le temps de finir leur sinistre ouvrage…
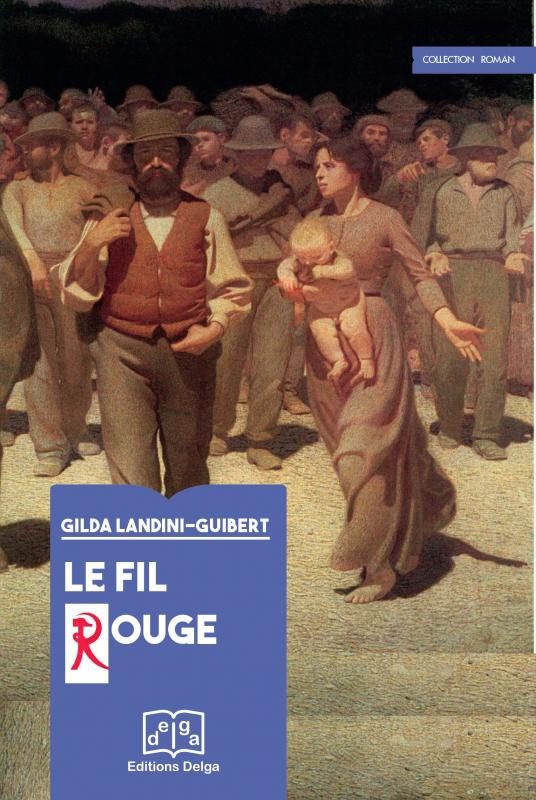
– Vouaï ! J’ai entendu ! » répond Léo. « Va pas falloir moisir ici ! D’une façon ou d’une autre il faut sortir ! Si les Allemands s’en vont et que personne ne nous ouvre, moi je défonce la porte ! Je vais pas attendre qu’ils nous fassent sauter !
Les autres le regardent surpris et amusés. Décidément ce gamin ne doute de rien. Il est à peine plus haut que trois pommes et ne pèse pas plus lourd qu’une poignée de pépins, et il parle de démolir une solide porte de prison ! Il a vu trop de films américains dans lesquels tout est en carton-pâte et où le héros d’un seul coup d’épaule fait voltiger tout le décor.
Soudain, alors que les derniers rayons flamboyants du soleil ont déjà disparu derrière les toits et que la pénombre s’étend sur la ville, un véritable tohu-bohu fait sursauter les prisonniers.
– Soulevez-moi ! Je vais regarder ce qui se passe par la fenêtre ! » Léo, étant le plus petit et le plus léger, est bien évidemment celui qui est le plus aisément soulevable. C’est donc toujours lui qui donne des nouvelles de la cour à ses compagnons. Nicolas et le Père Martin, un grand mutilé de la première guerre mondiale qui n’en reste pas moins avec le Russe l’un des plus baraqués de la cellule, lui font la courte échelle. Comme d’habitude, il aperçoit en premier le baraquement de bois dans lequel les Juifs sont entassés comme des sardines. Mais cette fois-ci, ils sont tous agglutinés aux étroites fenêtres et il semble à Léo qu’ils sourient.
– Oh ! Qu’est-ce- qui se passe ? » Leur crie-t-il.
– Les Allemands quittent la prison ! Ils s’en vont ! Lui lance une voix.
Il n’en croit pas ses oreilles ! Il se hisse en tirant de toutes ses forces sur les barreaux et tend la tête sur le côté. Là, il voit des soldats en file indienne, sacs à dos, tête baissée et le pas lourd, en train de sortir de la prison.
– Ils foutent le camp ! Ils foutent le camp ! Hurle Léo. A ce cri, une immense clameur de joie s’élève de toutes les cellules. Il saute au sol et se jette dans les bras du père Martin qui commence doucement à sangloter.
– Oh ! Bon Dieu ! J’y croyais plus ! Je pensais qu’on allait tous crever ici ! Merci mon petit ! Merci !
– Merci de quoi Père Martin ? J’y suis pour rien, moi !
Le regard larmoyant du vieux se fait plus malicieux.
– Merci pour tous ceux qui se sont battus contre ces salauds et qui ont permis qu’aujourd’hui ils soient chassés…
Léo baisse les yeux et sans rien dire le serre fort contre lui. Il a la gorge serrée. Sacré vieux, va ! Il a toujours eu l’air de ne rien comprendre à ce qui se passait dans ces murs et soudain, en un mot, il dévoile ce que son flair de paysan lui avait fait pressentir.
Nicolas happe le gamin et le soulève comme une plume.
– C’est fini ! On va être libérés ! Libres ! Enfin libres !
Ses « r » roulent comme un torrent chargé de cailloux et ses yeux bleus scintillent comme l’eau sous le soleil. L’émotion est à son comble. Partout dans la prison, on entend les mêmes cris d’allégresse, les mêmes pleurs de joie. Au bout d’un moment, dans la cour restée éclairée, monte du baraquement des Juifs, de ces « sous-hommes », de ces rebuts de l’Humanité, de ces « ennemis de la France », les premières notes du « Chant du Départ ».
La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons mourir
Un Français doit vivre pour elle
Pour elle un Français doit mourir
Au travers de ce chant, les Juifs viennent de rappeler à tous, contrairement à ce que vitupèrent les Vichystes depuis des années, qu’ils sont d’ardents patriotes et qu’ils ont bien conscience que ce n’est pas la France qui les a rejetés tels des pestiférés, mais le régime mis en place par Pétain et ses sbires.
Alors que les dernières notes s’élèvent dans l’air du soir, une voix grave venue d’une cellule voisine entonne la Marseillaise. Combien de suppliciés attachés à leur poteau d’exécution ont lancé, par ces paroles de combat, un ultime défi à l’occupant ! Immédiatement, toute la prison reprend le refrain. Il n’y a plus ni Juifs, ni Etrangers. Il n’y a plus que des Hommes qui redressent leur corps meurtri et se tiennent le plus droit possible, comme au garde-à-vous, la tête fièrement levée. Ni les chaînes, ni les coups n’ont pu rompre ce formidable sentiment de dignité, d’humanité qui émane de chacun d’entre eux.
Léo, sentant combien ces chants sont d’immenses réservoirs de combativité, entonne l’Internationale. Plus que tout autre, lui semble-il, cet hymne aux damnés de la terre à la fraternité du genre humain signe « l’éruption de la fin » et vole par-dessus les toits pour porter un dernier coup aux bourreaux en déroute. De toutes les cellules, monte alors un chœur unique, car communistes ou pas, tous puisent là le courage et la volonté de se battre jusqu’au bout. Lorsque les dernières voix s’éteignent, la prison retombe dans le silence. On n’entend plus que les rumeurs habituelles des cellules, mais dehors, aucun bruit. Les Allemands sont donc partis ?
– Remontez-moi les gars !
De nouveau Nicolas et le Père Martin hissent Léo à la lucarne. En se penchant, il voit un vieux monsieur barbichu qui va et vient dans la cour, sous le halo des projecteurs restés exceptionnellement allumés.
– Oh ! Barbette, lui crie Léo qui a retrouvé sa verve coutumière, qui tu es toi ?
– Je suis général et j’étais en prison avec vous.
– Alors dépêche-toi d’ouvrir les portes, Barbette, sinon j’enfonce la mienne.
– Ce n’est pas possible. J’ai donné ma parole aux Allemands que je ne vous ouvrirai que dans une heure !
– C’est pour faire sauter prison ! répète Nicolas sous les pieds de Léo.
– Bon ! Ben alors, moi je vais casser la porte ! Quel con ce vieux ! C’est pas étonnant qu’on ait perdu la guerre avec des « couns d’ail » pareils ! crie Léo en sautant au sol.
Il commence à donner des coups de pied dans le bas de la porte, en dessous des deux croisillons destinés à la renforcer.
– Arrête ! Tu vas casser pied, pas porte, lui dit Nicolas, je te montrer.
Il s’empare du seau d’excréments et vide dans un coin le liquide malodorant du jour. Puis il prend une des couvertures, infectée de punaises qui est roulée sur la vieille paillasse, et l’enfonce au fond du seau.
– Voilà, ça être plus solide que ton pied et même si casser, faire moins mal que pied ! observe Nicolas avec un grand bon sens. Léo le lui arrache avec fougue et commence à taper de toutes ses forces, jusqu’à ce que les planches se mettent à craquer. La rage au ventre, il s’acharne tant et si bien que l’une d’entre elles finit par céder. Des coups semblables retentissent dans toute la prison. Il glisse sa tête au travers du trou. Un coup d’œil à droite. Un coup d’œil à gauche. Personne. Le couloir est vide. Mais de tous côtés les portes volent en éclats. Léo, tout maigrelet, réussit à se glisser dehors par l’étroit orifice. Se redressant comme un sprinter, il détale vers les escaliers malgré la douleur qui fouaille encore ses parties génitales écrasées par les coups reçus. Au moment où il saute les premières marches, il entend des pas monter quatre à quatre. Saisi, il stoppe net dans son élan. Merde ! Les Allemands reviennent ? Il n’a pas le temps de faire un geste qu’il voit jaillir des jeunes gars avec des clefs. Ce sont probablement des détenus du rez-de-chaussée, qui, ayant cassé leurs portes, ont dû s’emparer des clefs du pauvre général et remontent courageusement ouvrir les cellules de leurs compagnons.
Obsédé par les bruits des marteaux-piqueurs entendus les jours précédents et par les propos de Nicolas « Boches faire sauter prison nous dedans », Léo descend en sautant les marches trois par trois. Lorsqu’il débouche dans la cour, il fait nuit noire, mais les projecteurs éclairent d’une sinistre lumière blanchâtre, des groupes d’hommes un peu perdus, qui se rassemblent. Il court comme un dératé vers le portail de la sortie resté grand ouvert après le départ des Allemands.
En arrivant à proximité, il entend des voix parvenant de l’extérieur. Son regard cherche rapidement un coin sombre dans lequel se terrer. Les voix parlent français.
– Qui va là ?
– C’est des Français.
– Venez à la lumière.
Il voit s’avancer un homme, une hache à la main. Il est entouré de femmes et d’enfants. Léo se redresse et s’approche d’eux.
– On vous a entendu chanter. Et on s’est dit : Tant pis si on meurt ! Il faut qu’on aille les aider à se libérer !
Léo sent de nouveau sa gorge se serrer et des larmes lui montent aux yeux. Etreint par l’émotion, il serre dans ses bras amaigris ce solide gaillard qui le dépasse d’au moins deux têtes. Les femmes s’avancent à leur tour et embrassent tendrement ce gamin au visage tuméfié, au col de veste noirci de sang séché. Il est à peine plus âgé que leurs petits et il a déjà pourtant tellement souffert.
Il les tire par les mains vers l’intérieur de la cour.
– Venez. Suivez-moi.
Il les dirige vers la lumière des projecteurs sous laquelle, tels des papillons désorientés, les prisonniers volètent à droite, à gauche, s’étreignent, s’embrassent, pleurent. Ils n’arrivent pas à croire à ce miracle. Ainsi c’en est vraiment fini de toute cette peur, de toute cette souffrance… Les cellules se vident et la cour se remplit. La porte grande ouverte du baraquement des Juifs laisse encore s’échapper des grappes d’hommes hébétés.
– Oh ! Les gars ! Voici des gens qui sont venus pour nous libérer ! Je crois qu’on peut les remercier pour leur courage !
Le petit groupe est immédiatement entouré par des dizaines de détenus qui serrent ces gamins contre leur cœur comme si c’était les leurs. Tandis que tous s’embrassent en mêlant leurs larmes, Léo se coule de nouveau vers la sortie. […]
Les 950 survivants des massacres nazis s’agglutinent dans la cour et discutent. Eux, qui ne se connaissaient pas quelques heures auparavant, ne tarissent plus de paroles. Ils ont dû garder le silence trop longtemps : se taire sous les injures, se taire sous les coups, se taire sous la torture. Ils éprouvent maintenant un insatiable besoin de parler. Entre eux, ils se comprennent. Les mots les plus simples sont chargés de tragédie : « baignoire », « cigarette » … d’autres sont porteurs d’espoir : « combat », « peuple », « maquis » … Pourtant, certains n’arrivent même plus à ouvrir la bouche : leurs visages ne sont plus qu’une plaie béante, leurs jambes ne les portent plus. Des compagnons d’infortune les soutiennent.
Léo voit tout cela en un instant, mais il ne veut pas s’attarder. Et si c’était vrai que la prison allait sauter ? Et si les Allemands revenaient ? Allez ! Zou ! Faut filer !
Il ne s’est écoulé que quelques minutes depuis qu’il a fracassé la porte de sa geôle, mais il a l’impression que cela fait des heures. […] La grande place extérieure est, comme toute la ville, plongée dans le noir. Léo s’y engage prudemment, un peu dérouté, en cherchant de quel côté il faut aller pour retourner chez lui, à Monplaisir la Plaine. Il doit d’abord retrouver la voie ferrée. Il se souvient, pour être souvent passé en train, qu’elle est sur la gauche du Fort Montluc en allant vers Lyon. Il fait quelques pas de course dans l’obscurité.
Soudain, devant la prison, il entend un ronronnement de moteur et voit surgir un camion chargé de soldats ! Instinctivement, il se plaque au sol dans la pénombre. Les Allemands descendent, mitraillette à la main. Sans une seconde d’hésitation, Léo se redresse et part en courant dans la nuit noire. Il se sent des ailes aux pieds. Il n’a jamais couru aussi vite de toute sa vie. Emporté par son élan, il s’écrase comme une grosse mouche sur une frise de barbelés ! Le choc est rude ! Surpris, mais pas sonné, il commence à escalader à toute vitesse ce mur hérissé de ferrailles piquantes.
Arrivé au sommet de cette herse rouillée, il saute dans le vide. Il a l’impression de tomber d’une maison de quatre étages. Malgré les coups, la peur au ventre lui donne des ailes. Il n’a rien perdu de sa souplesse ni de son agilité. Des graviers lui râpent la paume des mains, mais il ne le sent pas. Il se redresse et part en courant, penché en avant. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il se rend compte qu’il est sur une voie de chemin de fer. Une centaine de mètres plus loin, un peu essoufflé, il se couche sur le bord de la voie. […]
Au loin les lumières de la prison semblent irréelles. Les éclats de voix et de rires qui en émanent, tranchent avec le lourd silence qui pèse sur la ville. Léo […] scrute les ténèbres pour voir où est passé le camion allemand. A sa grande surprise, il l’aperçoit en train de faire demi-tour. Le ronronnement cahotant du véhicule s’éloigne dans la nuit.
[…] Vers vingt-deux heures, Léo arrive près du garage au-dessus duquel il a sa petite chambre. En s’approchant du porche, il entend des voix dans la courette.
Souvent, le soir, les habitants des maisonnettes environnantes viennent s’y asseoir, quand il fait chaud, pour prendre le frais et bavarder un peu. Ils ont entendu dire à la radio que Paris et même Lyon ont été libérées et certains ont vu des camions chargés d’Allemands sortir de Lyon. Il règne donc ce soir-là une atmosphère extrêmement fébrile. Les conversations vont bon train quand, soudain, des pas résonnent sous le porche. Qui ose sortir le soir ? Qui ose braver le couvre-feu ?
Tous se retournent. […] Léon s’avance et la lumière blafarde de la lune l’éclaire.
– ça alors ! Le Marseillais ! D’où tu viens à cette heure-ci ?
– Je sors de Montluc, répond Léo de sa voix devenue nasillarde.
C’est alors qu’ils remarquent son nez gonflé, ses yeux encore tuméfiés et sa veste toute tâchée de sang noir.
– Oh ! Mon pauvre petit ! Qu’est ce qu’ils t’ont fait ces sauvages ? La femme rousse qui vient de parler se lève et vient le serrer contre elle.
– Mais ça fait combien de jours que tu n’as pas mangé ? ajoute-t-elle en palpant les épaules maigrelettes du « pauvre petit ». Vous devez avoir bien faim tous les deux, non ? On n’a pas grand-chose, mais on va sûrement te trouver quelque chose à grignoter. Assieds-toi là, on revient.
Les femmes se sont déjà levées et elles remontent vers leur cuisine à la recherche d’un quelconque aliment susceptible d’apaiser la faim de ces deux jeunes. Pendant ce temps Léo pressé de questions, raconte le départ des Allemands, les portes défoncées, les pleurs de joie, la fuite éperdue, le cœur battant. Et ils voient ces gens simples qui les écoutent bouche bée, laisser sans honte des larmes rouler sur leurs joues. A leur tour, les hommes évoquent les convois de la Wehrmacht couverts de branchages, roulant à tombeau ouvert à travers les avenues lyonnaises, la libération de Paris et celle de Lyon…
– Si ! Si ! C’est Radio-Genève qui l’a annoncée !
Et les mêmes mots égrènent tout leur discours.
– C’est fini ! C’est la Libération ! C’est la fin de la guerre !






