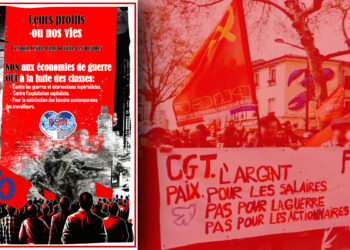Initiative Communiste vous propose ici un dossier spécial, publié par les jeunes camarades des JRCF, sur le capitalisme de plateforme. Cette structuration des rapports de production et de salariat, prétendument moderne, mais qui s’appuyant sur les nouvelles technologies renvoie les travailleurs au XIXes.
Un dossier spécial de Quentin (JRCF)
- http://jrcf.over-blog.org/2019/10/le-capitalisme-de-plateforme-1/2-les-sources.html
- http://jrcf.over-blog.org/2019/10/capitalisme-de-plateforme-2/2-les-differents-types-de-plateformes.html

Le capitalisme de plateforme (1/2) : les sources
Dans un passé proche, une sorte de rêve merveilleux nous était compté par tous, médias, « intellectuels » au service du patronat, la grande bourgeoisie et tant d’autres personnes intéressées, sur la nouvelle organisation du marché du travail. Pensez donc ! Maintenant, tout le monde pourrait être son propre patron, un self-made-man ! Comment ? Essentiellement grâce au développement d’internet et de certaines plateformes, qui abolissaient la barrière entre l’usager et le fournisseur, voire attaquant carrément la propriété privée en permettant le partage d’informations et de produits plus rapidement, tout en restant dans une organisation économique de type capitaliste. En somme, un capitalisme de plateforme.
Essentiellement, ce doux rêve ne s’est pas réalisé. Au contraire, le rêve de la nouvelle organisation économique sans propriété privée s’est heurté à l’apparente monopolisation de certaines plateformes à l’instar des GAFAM sur des secteurs importants du marché, ainsi qu’à des pratiques répandues d’évasion fiscale. Quant à l’organisation du travail, dont on disait qu’elle serait idyllique ou « gagnant-gagnant » pour travailleurs et patrons, les désirs sont bien loin de la réalité, l’intensification du travail, un contrôle accru via les applications, la compression salariale et la sous-traitance à outrance étant des cas typiques des plateformes, lorsque ce n’est pas des pratiques délétères comme les bracelet électronique Amazon[1]. Sur les fameux entrepreneurs libres d’eux-mêmes[2], cette fiction est tombée en désuétude face à des plateformes pouvant retirer manu militari un individu de ses services, sans discussion, et baisser le prix du travail de la même façon, tout en contrôlant l’activité des travailleurs, comme le font Uber et Deliveroo, ce qui a mené à des grèves un peu partout dans le Monde, dont en France[3].
Qu’est-ce que ce capitalisme de plateforme ? Quel est son fondement ? D’où vient-il ? A-t-il un avenir ? Autant de questions assez peu posées par les marxistes[4] et dont nous allons essayer d’apporter quelques réponses.
La matière première de ce capitalisme : les données
Tout d’abord une plateforme, bien que la notion soit assez floue, nous pouvons la définir comme une sorte de logiciel, une application informatique ou un système d’exploitation. Lorsqu’on parle de plateforme ici, c’est forcément lié au numérique. Le capitalisme de plateforme se forme autour de l’utilisation d’une matière première particulière : les données.
Afin d’être plus précis, une donnée c’est la représentation d’une information dans un programme. Par définition, afin d’exploiter des données, cela implique un enregistrement de celles-ci, donc un moyen de pouvoir les capter, puis un support pour les stocker. Ce n’est pas tout, car enregistrer et entreposer les données c’est une chose, mais cela n’a pas de valeur en soi. La matière brute exploitable est certes là, mais elle est éparpillée et inutilisable -ou difficilement- sous cette forme. Il faut donc aussi avoir les moyens technologiques et humains pour analyser ces données, et c’est ce travail d’analyse qui donne toute la valeur aux données.
Ce dernier point amène à un véritable débat sur la création de données sur internet : l’utilisateur est-il de la main d’œuvre gratuite pour ces plateformes ? L’économiste Dallas Smythe s’avisait dans les années 70 que le spectateur de la télévision était un travailleur, car la marchandise présente, l’audience, était créé par les téléspectateurs, absolument non rémunéré pour ça. Certains auteurs de reprendre cette théorie au sujet d’internet[5] : en mettant un j’aime, en faisant un tweet, en créant un profil, ou encore en cliquant sur un lien, nous créons une information exploitable par des entreprises comme Google, Amazon ou Facebook. C’est ce qu’on appelle du travail numérique, méritant d’être rémunéré ou a minima réintégré par la collectivité dans le cadre d’un impôt. Le problème de cette théorie, comme l’avance le spécialiste de l’économie numérique Nick Srnicek, c’est que la plupart de nos interactions sur internet ne sont même pas intégrés à un processus de valorisation économique, raison pour laquelle nous assistons à une concurrence accrue entre entreprises pour l’élaboration des plateformes[6]. La « main d’œuvre » dont nous parlons n’est même pas à l’origine de la moitié des sources de données récupérées par les dites entreprises[7]. De plus, ce n’est pas les données en elle-même mais leur traitement qui intéresse les entreprises, c’est avec ça qu’elles peuvent faire du profit, ce qui explique sans doute pourquoi les « travailleurs du clics » (ou turkers)[8] sont classés plus facilement parmi la catégorie de travailleurs, tandis que le terme plus large de « travailleur numérique » et désignant tout usager, fait encore débat. L’auteur de ces lignes penche pour la seconde hypothèse.
Autre conséquence de cette exploitation des données, c’est la mise à mort de la vie privée. En effet, à partir du moment où la source de profit des entreprises a pour origine les informations récoltées sur internet, l’objectif étant (pour les plateformes publicitaires par exemple) de revendre ces informations à des annonceurs ou de cibler plus efficacement un acheteur, les entreprises vont scruter chaque information permettant de se faire une idée du client. Le fait que les entreprises puissent aussi vendre ces données à des gouvernements tentés de surveiller leurs concitoyens et ceux d’autres pays ne changent rien à l’affaire, c’est l’organisation économique du capitalisme de plateforme qui amène à la fin de la vie privée. Les efforts de moralisation du capitalisme, y compris par certains possédants, ne changeront rien.
Revenons maintenant au doux rêve dont nous parlions en introduction : la fin de la propriété privée grâce à internet ! Nous assistons au contraire à un processus de monopolisation du secteur par quelques grandes entreprises, dont les fameuses GAFAM. La grande idée avancée ces dernières années pour annoncer le bouleversement de l’organisation de l’économie, mais pas la fin du capitalisme, c’est la possibilité grâce au numérique de trouver certains produits sans besoin d’intermédiaire et presque gratuitement. On pense souvent à toutes l’industrie de la culture, comme la musique et le cinéma, et ce sera d’ailleurs l’objet d’un point de l’article (plateforme de produit). Or, à quelques exceptions près où le marché est plus volage et la concurrence bien plus rude, les sociétés investissant dans un terrain particulier ont tendance à devenir hégémonique. C’est le système du « premier prend tout », c’est-à-dire que le premier débutant sur un nouveau marché à naturellement tendance à le monopoliser, surtout grâce à l’effet de réseau « où l’utilité d’une plateforme croît avec le nombre d’utilisateurs »[9]. Prenons un exemple concret, si vous cherchez un moteur de recherche internet afin de pouvoir trouver facilement certaines informations, vous allez immédiatement aller voir le plus utilisés par vos amis, connaissances, collègues, etc, et sans doute aujourd’hui ce sera Google, car s’il existe encore des moteurs de recherche à la marge, Google est devenu la référence ayant écrasé ses concurrents. Autre exemple, si vous cherchez à obtenir un emploi et à vous inscrire dans un réseau professionnel, quel réseau social allez-vous choisir ? Un réseau professionnel peut-être plus spécifique et n’utilisant pas vos données abusivement ? Ou bien le réseau Linkedin dont les utilisateurs sont nombreux ? Là encore, à moins d’être entreprenant ou militant, la majorité des personnes se tourneront vers Linkedin. Cette hégémonie par effet de réseau est caractéristique du capitalisme de plateforme.
Nous ne disons pas que la concurrence est annulée – au contraire la concurrence reste accrue, mais il existe une évolution naturelle vers le monopole[10]. Cela ne signifie pas que par suite d’évolutions technologiques les monopoles ne puissent pas disparaître ou changer de main, toutefois une hégémonie dans un domaine et dans le financement des innovations permet d’avoir une longueur d’avance sur les concurrents, à l’instar de Google qui laisse fuiter des informations sur son processus logistique lorsqu’il est sûr d’avoir pris une longueur d’avance sur ses concurrents.

Comment ce capitalisme s’est-il développé ?
L’origine du capitalisme de plateforme vient des Etats-Unis et de la désagrégation du modèle économique d’après seconde guerre mondiale[11], celui du modèle tayloriste et de la concentration des ouvriers dans une usine, avec des syndicats forts protégeant les salariés. C’est aux environs des années 70 avec la fin des accords de Bretton-Woods et une crise de surproduction et de surcapacité, entraînant une pression à la baisse sur les prix des produits manufacturiers que les Etats-Unis commencèrent à ne plus être rentable. La première tentative pour remédier à ce problème fut l’application à la production du toyotisme japonais, c’est-à-dire décomposé le travail en une série de tâches élémentaires afin de réduire au strict minimum les entraves et le temps d’arrêt dans la chaîne de production. L’émergence de logiciels sophistiqués pour gérer l’approvisionnement et la disponibilité des produits facilita cette conversion. Les produits devenaient moins standardisés et plus sur mesure pour certains consommateurs. Cette réorganisation n’empêcha pas les concurrents de l’époque (Allemagne, Japon et les tigres asiatiques) de devenir plus compétitifs que le pays de l’Oncle Sam.
Inutile de le rappeler mais l’un des autres moyens pour améliorer la rentabilité fut de s’attaquer au pouvoir des syndicats dont les adhérents chutèrent. C’est aussi dans les années 70 que commença à se développer la sous-traitance pour les petites productions de consommation.
Avec les années 90, le secteur des technologies de l’information et des communications connu un essor fulgurant permettant de délocaliser bon nombre de services. Internet venait juste d’être commercialisé. Le boom du point-com des années 90 a quelque peu ralenti la chute des économies productives. Nous devons reconnaître surtout qu’il a mis en place l’infrastructure de base de l’économie numérique. L’époque est marquée par une forte spéculation financière, stimulée en retour par des quantités énormes de capital-risque[12] et par les niveaux élevés de valorisation boursière. Le secteur des télécommunications devient vite le débouché favori du capital financier à la fin du Vingtième siècle. C’est environ 50000 entreprises créées pour commercialiser internet grâce à des investissements de plus 256 milliards de dollars et à leur apogée, c’était 1% du PIB américain investit par le capital-risque dans les entreprises de technologies[13].
Ces entreprises n’étaient pas rentables et ne doivent ces investissements que grâce à la stratégie de croissance avant profits : ainsi les investisseurs pariaient sur l’éventuelle domination des entreprises lorsqu’elles mettraient la main sur le marché.
En 1998, une bulle spéculative fini par éclater malgré une série de mesure d’urgence de la Banque centrale américaine (FED) pour réduire le taux d’intérêt. Afin d’éviter d’aggraver le déficit public, il fut décidé de laisser les financiers financé les secteurs de l’économie en difficulté. Les investissements dans les entreprises du point-com ont permis de prolonger la bulle spéculative jusqu’en 2000, lorsque le marché boursier a atteint son sommet, la valeur des sociétés ayant été surévaluées et les projections faites par les investisseurs bien inférieurs aux résultats. Et pourtant la même politique économique et monétaire fut maintenue après le krach de 2001. Lorsque la crise survenue en 2008 avec la disparition de Lehman Brothers et des plusieurs fonds spéculatifs, les Etats-Unis se sont retrouvés avec une dette énorme.
Afin de raviver leurs économies stagnantes, les pays développés se sont tournés vers la politique monétaire, notamment le quantitative easing où une banque centrale crée de l’argent pour acheter une série de produits aux banques. L’idée étant de retrouver une sorte de « canal de rééquilibrage des portefeuilles ». Il fallait bloquer ou restreindre l’offre d’un actif permettant d’affecter la demande d’autres actifs. Une baisse de l’offre en obligations d’Etat devrait faire augmenter la demande pour les autres actifs financiers, devant du même coup diminuer la dette des entreprises, ce qui devrait assouplir le crédit et faire monter le prix des actions, et conséquemment la consommation.
La mobilité des capitaux tel que constatée aujourd’hui a favorisé l’émergence de marché financiers puissants et ainsi permit de renforcer la spéculation déconnectée de la sphère productive. L’explosion des technologies a permis aux employeurs de remodeler profondément l’organisation de leurs entreprises, quitte à procéder à des externalisations et de rendre plus flous les frontières de l’entreprise. Il faut ajouter à cela que beaucoup d’entreprises, dont celles utilisant des plateformes, organisent une grande thésaurisation s’accompagnant d’une évasion fiscale à grande échelle.
[1] « Homme ou esclave ? » Amazon dépose le brevet d’un bracelet électronique pour les salariés », Le nouvel Obs, 3 février 2018.
[2] « Les travailleurs uberisés sont-ils indépendants ? », JRCF, 8 mai 2019.
[3] « Reportage dans la manifestation des livreurs Deliveroo à Paris », Pôle de Renaissance Communiste en France, 12 août 2019.
[4] Il existe l’excellent ouvrage de Nick Srnicek, Capitalisme de plateforme : L’hégémonie de l’économie numérique, dont l’auteur de ces lignes s’est beaucoup servi.
[5] « Données personnelles, une affaire politique », Pierre Rimbert, Le monde diplomatique numéro 750.
[6] Capitalisme de plateforme, page 59.
[7] Ibid. page 59 : « D’un point de vue général, la « main d’œuvre gratuite » ne représente qu’une partie de la multitude de sources de données dont dépendent des entreprises comme Google, qu’il s’agisse de transactions économiques, de données recueillies par les capteurs de l’internet des objets, de données provenant des entreprises ou de l’Etat, (…) ou encore de la surveillance privée et publique ».
[8] « Les « travailleurs du clic » et l’économie », JRCF, 17 juillet 2019.
[9] Emmanuel Reich, « Mondialisation et Révolution numérique et emploi », Colloque 6 décembre 2016 (CGT sociétés d’études) : « L’impact du numérique sur l’emploi et le travail ».
[10] A l’instar de ce qu’expliquait Lénine dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme.
[11] C’est l’objet du premier chapitre du livre Capitalisme de plateforme.
[12] Capital-risque : branche du capital investissement consistant à prendre des participations dans des sociétés non cotées n’ayant pas encore trouvé leur point d’équilibre, par exemple les start-ups ayant besoin d’argent.
[13] Capitalisme de plateforme, page 26.
Capitalisme de plateforme (2/2) : les différents types de plateformes

Après avoir analysé les sources du capitalisme de plateforme et comment il était advenu, analysons cette organisation particulière du capitalisme qui se décompose en plusieurs fonctions que nous allons étudier.
Les cinq types de plateformes
Le spécialiste de l’économie numérique Nick Srnicek réparti les différents types de plateforme en cinq catégories (sachant que certaines entreprises cumulent plusieurs types de plateformes), selon la question « d’où vient le profit » : la plateforme publicitaire, la plateforme nuagique, la plateforme industrielle, la plateforme de produit et enfin la plateforme allégée.
A) La plateforme publicitaire
Les entreprises utilisent ce genre plateforme pour collecter les informations des usagers afin de les vendre à des annonceurs. Les plateformes publicitaires viennent de l’éclatement de la bulle spéculative du point-com, qui avait été gonflé par l’accès facile au crédit. Plus spécifiquement elles proviennent du rôle central dans les entreprises numériques du marketing et de la stratégie « croissance avant profit », ce qui impliquait d’axer leur modèle sur la publicité et la quête d’un maximum d’usager.
Dans les plateformes publicitaires bien connu nous avons Google, Facebook ou Snapchat. A partir de 1998, Google a bénéficié des largesses du capital-risque avant de recevoir en 1999 un financement de 25 millions de dollars. Le parcours de Google éclaire celui des autres plateformes publicitaires. Au départ, l’entreprise collectait les données issues des recherches seulement pour améliorer son outil, le moteur de recherche, et les données n’étaient pas encore des marchandises. Seulement avec l’explosion de la bulle point-com, il était nécessaire de pouvoir dégager des bénéfices, c’est alors que Google a commencé à vendre les données.
Parmi les deux mastodontes de ce secteur, Google et Facebook sont devenu dépendants des revenus de la publicité. Pour Google, cela représente 96,6 % de son chiffre d’affaire en 2016, tandis qu’il s’agit de 89% pour Facebook, montrant bien où se situe les profits pour ces entreprises. C’est pour cela qu’il faut prendre au sérieux la possibilité émise par certaines éminences grises de Google, face à la surutilisation des bloqueurs de pub, de devoir un jour rendre les plateformes payantes afin de ne pas être déficitaire[1].
Ces entreprises fonctionnent ainsi : elles s’approprient les données des usagers comme matière première, puis elles transforment ces données brutes afin de pouvoir les utiliser, ce qui nécessite qu’une personne surveille l’activité des internautes, avant que ce ne travail ne servent à des annonceurs afin de cibler les clients potentiels.
La question que l’on peut se poser, c’est l’utilisation de l’argent récolté grâce au profit de la vente. Selon Nick Srnicek, elles sont de trois catégories : soit il s’agit d’épargne, ce qui inclut l’évasion fiscales, afin de garder un bénéfice ; soit par la fusion et acquisition de certaines entreprises ; soit dans l’investissement dans les entreprises émergentes de technologies, ce que fait Google.
B) La plateforme nuagique
Ce type de plateforme repose sur la propriété d’équipements informatiques et de logiciels loués aux particuliers ou aux entreprises selon leurs besoins. Elles s’occupent essentiellement de l’entreposage de données.
L’exemple par excellence c’est Amazon, de loin l’employeur le plus important du secteur numérique avec 230000 salariés et des dizaines de milliers de travailleurs saisonniers. En 2016, l’entreprise américaine a consacré des investissements majeurs à la construction d’immenses centres de données.
L’instance responsable de cette infrastructure logistique, AWS, avait initialement été développée en interne pour gérer le réseau logistique d’Amazon, puis devant sa performance, il fut transformé en service de location nuagique, incluant des services de serveurs à la demande, de location d’espace de stockage et de puissance de calcul, des outils de développement des logiciels et de système d’exploitation, en plus d’applications prêtes à l’emploi. Et ce système d’être très rentable :
« Il n’est pas surprenant dès lors, qu’on estime actuellement la valeur d’AWS à plus ou moins 70 milliards de dollars et que les concurrents majeurs, comme Microsoft, Google ou l’entreprise chinoise Alibaba, se lancent dans l’arène à leur tour. AWS représente actuellement le département d’Amazon qui connaît la croissance la plus fulgurante et la meilleure rentabilité, et dispose de marges d’environ 30% et de revenus de près de huit milliards de dollars en 2015. Au premier trimestre 2016, les profits générés par AWS ont surpassés ceux de la plateforme en ligne d’Amazon. »
Capitalisme de plateforme, page 69.
Ces plateformes nuagiques permettent aussi de sous-traiter une part du département des technologies de l’information, ce qui a pour tendance l’automatisation du travail des fameux « travailleurs du savoir », soit de plus en plus leur prolétarisation. L’analyse des données, le stockage des informations, client, l’entretien des serveurs d’entreprise, tout cela peut être absorbé dans le nuage et justifier le rôle incontournable de ce modèle dans le capitalisme.
C) La plateforme industrielle
Il s’agit d’une plateforme produisant des logiciels permettant d’adapter la production traditionnelle au processus en ligne. En quelque sorte, il s’agit de faire entrer le numérique dans la production manufacturière traditionnelle.
Cela suppose d’implanter des capteurs et des puces électroniques dans la chaîne de production et d’introduire des dispositifs de traçabilité dans le processus logistique. L’objectif étant que chaque composante du processus de production puisse communiquer avec les autres composantes et les machines d’assemblage, sans passer par une supervision humaine.
Selon les défenseurs de la plateforme industrielle, cela permet de réduire le coût de la main d’œuvre de 25 %, de baisser de 20% la consommation énergétique et de 40% le coût d’entretien, tout en minimisant le temps d’arrêt et le risque d’erreur, mais aussi en augmentant la qualité des produits. Ces plateformes pourraient être un moteur du développement industriel en concevant l’équipement et les logiciels nécessaire à une productivité plus importante. Des entreprises comme Siemens et General electric ont d’ores et déjà commencé à développer ce genre de plateforme, le premier ayant dépensé 4 milliards d’euros pour augmenter ses capacités en matière de fabrication intelligente, tout en créant sa propre plateforme, Mindsphere.
Majoritairement financées par les vieilles entreprises industrielles, les plateformes industrielles doivent savoir gérer les données récoltées. Les entreprises en possédant se targuent d’avoir un accès privilégié aux données sur les procédés de fabrication et disent posséder les moyens nécessaires pour sécuriser leurs systèmes.
D) La plateforme de produit
Il s’agit d’une plateforme avec des services spécifiques en échange de souscription, comme Spotify et Netflix[2]. Ce qui la différencie de la plateforme allégée c’est qu’elle est propriétaire des biens mis en location ou vendu. Dans l’industrie de la musique, annoncée mort il y a une dizaine d’année, les frais d’abonnement à des plateformes comme Spotify ou Pandora sont en passe de supplanter les revenus du téléchargement comme source de revenu numérique[3].
Ce genre de plateforme s’applique aussi en-dehors du secteur culturel : dans le domaine de l’aéronautique avec la vente de moteurs d’avions plus performants, leur entretien (le plus profitable) et le remplacement des pièces, aidés par des capteurs placés sur les moteurs permettant de récupérer des données sur l’usure des pièces et les problèmes potentiels, afin que les entreprises en concurrence gardent la mainmise sur l’entretien des moteurs.
E) La plateforme allégée
Il s’agit d’une plateforme dite allégée car elle externalise au maximum les services qu’elle fournit en confiant la production de certains produits aux usagers et en étant pas propriétaire des outils. C’est cette plateforme que l’on vise en parlant de travail ubérisés, dont on nous dit qu’elle représente l’avenir du travail, même s’il s’agit en tout point d’un retour à un capitalisme du 18ème siècle. Nous allons parler plus amplement de ce phénomène dans la dernière partie.
L’ubérisation de la société : un mythe capitaliste ?
L’uberisation dont a tant parlé désigne essentiellement les entreprises utilisant des plateformes allégées, à l’instar d’Uber, Deliveroo, Aibnb, Mechanical Turk, dont nous avons déjà parlé sur le blog des JRCF. Elles sont dites allégées parce qu’elles jouent le rôle d’intermédiaire entre le fournisseur d’un bien et l’utilisateur, à l’instar d’Airbnb.
En effet, beaucoup d’annonces ont été faites sur le modèle Uber en France, sur la nouvelle organisation du travail que cela impliquait, avec une plus grande indépendance des travailleurs et une plus importante flexibilisation du travail. Certains prédisaient même l’abandon de la subordination juridique (exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements) pour la subordination économique[4], celle d’un indépendant soumis -littéralement- à un client principal. Les juges ne furent pas forcément de cet avis, dans un arrêt Cass. du 28 novembre 2018, un coursier à vélo qui exerçait son activité sous le statut d’autoentrepreneur se vit requalifié en salarié, à cause du faisceau d’indice indiquant un contrat de travail. Cela fut réaffirmé en 2019 à propos d’un coursier Uber car le chauffeur VTC n’avait pas la possibilité de choisir l’organisation de son activité, avoir sa propre clientèle, fixer ses propres tarifs et d’autre part, il était surveillé par la société via l’application. Ceci indiquant manifestement que le travailleur exécutait un contrat de travail sous l’autorité d’une société, que celle-ci pouvait le contrôler, et il est bien connu qu’elle pouvait le sanctionner, les cas d’éviction de la plateforme de certains chauffeurs sans préavis étant connu[5]. Il est donc assez surprenant de parler de fin de la subordination juridique, sauf à prendre ses rêves (de patron) pour des réalités. En tout cas, il est clair que le pouvoir macronien soutient activement ce genre d’entreprise et met en place des réformes pour pouvoir d’autant mieux l’imposer[6]. En France, nous sommes loin de l’essor d’emploi annoncé, pas plus que dans d’autres pays par ailleurs, étant donné que la part des non-salariés dans l’emploi total a légèrement augmenté depuis les années 2000, un peu avant l’arrivée des plateformes. Il a certes augmenté de +184% entre 2006 et 2013, mais il représente moins de 3% des personnes déclarant des revenus d’activité non agricole en 2013[7].
Afin de payer le moins possible et garder le plus de profit pour eux, les capitalistes de ces sociétés reportent plusieurs frais de bilans financiers sur les travailleurs eux-mêmes, comme le coût d’investissement (le travailleur utilise son bien propre au service de la société), le coût d’entretien, les frais d’assurance et d’amortissement. Et quand cela ne suffit pas, ils utilisent la compression salariale (baisse des tarifs par exemple) pour se renflouer.
Les contrats sont précaires et souvent mal-payés, à l’instar des turkers répondant à des questionnaires sur internet afin de tester l’intelligence artificielle, ou celle des juicers qui rechargent les trottinettes électriques. Qui sont bien souvent les travailleurs de ces entreprises ? Des chômeurs de longue durée touché par la crise et des travailleurs précaires ayant besoin d’arrondir les fins de mois. Uber avouait il y a peu que la majorité de ses chauffeurs londoniens venaient des quartiers pauvres de la City. Nous sommes loin du rêve d’indépendance heureuse promis.
Au regard d’autres plateformes, les innovations apportées sont minimes voire inexistantes. Elles sont mêmes dépendantes d’autres plateformes, comme les plateformes nuagiques. Par exemple, Uber est dépendant de Google pour sa messagerie, de Twilio pour ses SMS.
Enfin, il faudrait casser un mythe : ces entreprises ne sont pas rentables. Par elle-même (et c’est la raison du report des coûts et de la compression salariale exposé plus haut), elles font assez peu de profits, leur financement venant surtout des dons de la finance prévoyant leurs rentabilités futures, lorsqu’elles auront une croissance suffisante et qu’elles auront atteint une situation de monopole sur le marché. Monopole quasi impossible à atteindre à cause de l’extrême simplicité du fonctionnement de ces entreprises, qui ne nécessitent pas certaines innovations pour exister, ce qui en fait des modèle sfacilement reproductibles. Nous comprenons mieux la raison pour laquelle en 2017, l’entreprise Deliveroo avait décidé de mettre fin aux contrats des livreurs payés à l’heure (7,5 euros plus 2 à 4 euros par commande), puis avait encore décidé d’adopter un nouveau système de tarification à la distance en 2018, faisant passer le tarif minimum de 5,7 euros à 4,7 euros, avant qu’en 2019 le tarif minimum passe aux alentours de 2 euros, provoquant la protestation des livreurs[8]. Cela s’explique parfaitement par cette course à la rentabilité chez des entreprises soumises à la concurrence et ne dégageant pas encore de profit suffisant pour exister sans perfusion de la finance.
Les fonds viennent bien souvent de capitaux excédentaires cherchant des opportunités de rendements élevés dans le contexte des faibles taux d’intérêt et, comme pour les plateformes publicitaires, l’évasion fiscale est pratiquée afin d’épargner et d’avoir toujours à portée de main une ressource financière permettant de garder une stabilité pour l’entreprise. Mais ces deux moyens sont précaires et dans le cas du capital excédentaire, il risque de provoquer un boom des technologies.
Malgré ce que disent beaucoup de nos médias et penseurs, en plus d’être une régression au niveau des droits sociaux, l’uberisation ne représente pas l’avenir et il est plus que probable que ces entreprises disparaissent dans un futur proche.
[1] Capitalisme de plateforme, pages 126, 127 et 128.
[2] « Le phénomène Netflix d’un point de vue marxiste », JRCF, 10 mars 2019.
[3] Entre 2010 et 2014, le nombre d’abonnés à ces services est passé de 8 millions à 41 millions.
[4] « Redéfinir le contrat de travail à l’ère numérique : de la subordination à la coopération », 2017, Emmanuel Barbara, avocate spécialiste du droit du travail et membre du think thank libéral Génération Libre.
[5] « Opinion : Uber et le travailleur indépendant « subordonnée », Les Echos, Brigitte Pereira, 17 avril 2019.
[6] Et cela fut aussi préparer par les gouvernements précédents, comme celui de François Hollande avec le rapport Mettling, ayant inspiré la loi travail de 2016. Voir Guillaume Etievant dans Colloque 6 décembre 2016 (CGT sociétés d’études) : « L’impact du numérique sur l’emploi et le travail ».
[7] « L’économie des plateformes : enjeux pour la croissance, le travail, l’emploi et les politiques publiques », Dares, Numéro 213, août 2017.
[8] « Deliveroo ou la tarification de la honte », JRCF, 29 août 2019.


![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)