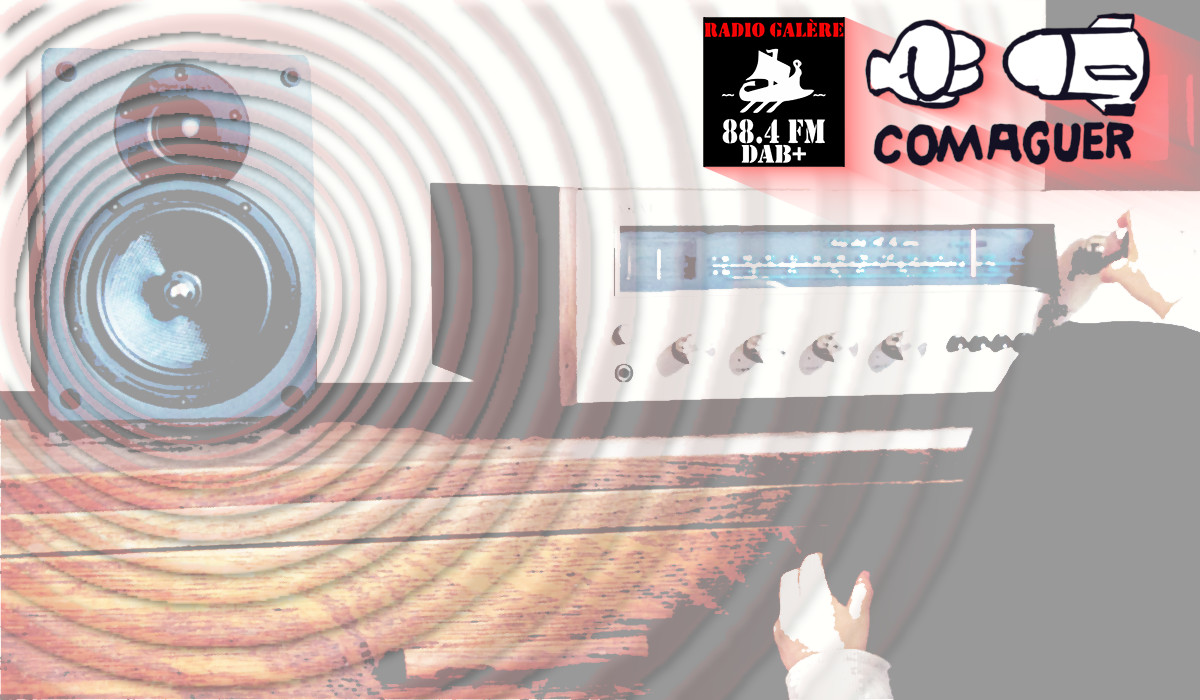dir= »ltr »>
L’histoire se répète.
dir= »ltr »>
Ce discours de Jaurès, le 8 février 1893 est à méditer au vu des affaires et scandales qui se succèdent.
L’affaire de Panama : Le devoir du Gouvernement
Séance du 8 février 1893
M. Jaurès. – Je me félicite que ce débat ait échappé aux tristesses des questions et des insinuations personnelles, pour s’élever à la hauteur d’une discussion de politique générale.
Je ne veux pas, je ne peux pas discuter les idées exprimées à cette tribune par M. le président du conseil, par la raison très simple que je n’en ai pas bien saisi les directions essentielles (Rires à droite et sur plusieurs bancs à gauche) et qu’il m’a même paru qu’on y peut relever certaines contradictions. Car au moment même où, avec l’honorable M. Cavaignac, il réclamait la continuation jusqu’au bout de ce qu’on a appelé ici l’oeuvre de lumière, il paraissait qualifier de manoeuvre une politique qui aurait dû trouver meilleur accueil à ses yeux, puisque c’est par son honorable ami qu’elle venait d’être formulée. (Très bien ! à droite.)
Je n’ai, pour moi, retenu qu’une chose : la double condamnation portée à la tribune, et par M. Cavaignac et par M. le président du conseil, contre l’influence abusive et corruptrice de ces puissances d’argent dont notre raison d’être, à nous républicains socialistes, est de hâter la disparition.
M. François Deloncle. – Voilà Carmaux venant au secours de Panama !
M. Jaurès. – Oui, c’est ainsi que nous posons la question ; car ce n’est pas nous qui avons jeté des questions personnelles dans ce débat ; ce n’est pas nous, républicains, qui pouvons voir avec joie l’atteinte portée à ceux qui avant nous ont lutté pour la République, mais nous voulons qu’une conclusion précise, politique et sociale se dégage du débat douloureux et poignant qui se déroule devant le pays.
M. Emmanuel Arène. – Il y a sept ans, vous étiez centre gauche ! (Mouvements divers.)
M. Jaurès. – Vous monsieur, qui m’interrompez ainsi, – je ne me eus pas comme vous dans la lumière de la gloire, – vous êtes excusable de n’avoir pas suivi le mouvement loyal et sincère de ma pensée ; mais en tout cas, lorsque je vois des représentants de ce qu’on appelait autrefois le centre gauche, comme M. Cavaignac, comme M. le président du conseil, apporter ici une critique socialiste de l’Etat actuel… (Rumeurs à gauche et au centre.)
M. Godefroy Cavaignac. – Vous vous trompez ; je n’ai point fait partie du centre gauche.
M. Jaurès. – … j’ai bien le droit, à mon sens, j’ai bien le droit, moi aussi, de rendre témoignage aux idées qu’en dépit de vous, depuis des années, je soutiens dans le pays.
Je me permets de dire à l’honorable M. Cavaignac et à M. le président du conseil qu’il ne suffit pas d’apporter ici des protestations indignées. Ce n’est pas Juvénal qui est chargé de conduire les affaires du pays ; il ne suffit pas de flétrir et de dénoncer les scandales, il faut dire encore comment on entend les déraciner et en empêcher le retour.
M. Millerand. – Très bien ! très bien !
M. Jaurès. – Eh bien, depuis quelques années, entre les intentions généreuses, honnêtes, qui viennent d’être exprimées ici, et la politique des gouvernements successifs, il y a une contradiction singulière. (Très bien ! à droite.)
Que voyons-nous en effet ? Qu’avons-nous constaté dans cette triste affaire de Panama ? D’abord – je le dis nettement – que la puissance de l’argent avait réussi à s’emparer des organes de l’opinion et à fausser à sa source, c’est-à-dire dans l’information publique, la conscience nationale.
Plusieurs membres à gauche. – Très bien ! très bien !
M. Jaurès. – Or, au moment même où se pratiquait cette sorte de sophistication de la pensée publique, il y avait dans des centres ouvriers des syndicats qui se cotisaient pour fonder des journaux non pas avec de l’argent pris ici ou là à des banques nationales ou cosmopolites, mais avec l’épargne prélevée sur les salaires. C’était là une ébauche de la presse loyale représentant vraiment l’opinion, et cette presse instituée par les syndicats des travailleurs, vous l’avez interdite. (Applaudissements sur quelques bancs à gauche.)
M. Le président du conseil. – Non !
M. Jaurès. – Et puis, que constatons-nous, messieurs ? C’est qu’il a surgi dans ce pays des institutions financières et capitalistes qui se sont emparées des chemins de fer, de la banque, des grandes entreprises, qui ont avoué avoir leurs caisses de fonds secrets avec lesquelles communiquait la caisse des fonds secrets gouvernementaux pour établir l’équilibre.
Je dis qu’au moment où l’on fait une constatation semblable, qu’au moment où l’on voit qu’un Etat nouveau, l’Etat financier, a surgi dans l’Etat démocratique, avec sa puissance à lui, ses ressorts à lui, ses organes à lui, ses fonds secrets à lui, c’est une contradiction lamentable que de ne pas entreprendre la lutte contre cette puissance qui détient les chemins de fer, les banques, toutes les grandes entreprises. (Applaudissements à l’extrême gauche.)
Et enfin quelle est la constatation la plus douloureuse qui ressort du procès qui a été engagé ?
Si dans toutes les affaires qui se sont produites, il était facile de faire le départ entre ce qui est honnête et ce qui est malhonnête, s’il était facile d’absoudre à coup sûr et de condamner à coup sûr, oui, la conscience publique serait aisément satisfaite ; mais ce qui la trouble, ce qui la bouleverse, ce qui vous obligera à chercher des solutions sociales nouvelles pour rétablir la conscience humaine dans son équilibre, c’est précisément que dans l’ordre social actuel, avec le tour nouveau qu’ont pris les entreprises et les affaires, le divorce grandissant de la propriété et du travail, il est impossible de discerner sûrement l’honnêteté et la malhonnêteté, l’entreprise loyale de l’escroquerie ; c’est que nous assistons à une sorte de décomposition sociale, où on ne peut dire que telle nuance s’arrête à la probité légale, tandis que telle autre se rapproche de l’infamie. (Interruptions.)
M. le Président. – Veuillez écouter en silence, messieurs ; toutes les opinions ont le droit de se produire à la tribune.
M. Jaurès. – Et j’espère, monsieur le président, que celle-ci a le droit de se produire ici, car elle est la traduction concrète du sentiment d’honnêteté qui est dans toutes les consciences.
Je dis qu’il ne suffit pas d’apporter de vagues protestations d’honnêteté comme celles qu’apportait à la tribune M. Cavaignac, mais qu’à des solutions morales nouvelles, il faut donner comme sanction et garantie des solutions sociales nouvelles. (Très bien ! sur divers bancs à gauche.)
Oui, M. le président du conseil avait raison de dire que ce n’est pas là, – et c’est le seul point sur lequel je sois pleinement d’accord avec lui, – que ce n’est pas là un étroit procès instruit contre quelques hommes entre les murs étroits d’un prétoire ; c’est le procès de l’ordre social finissant qui est commencé, et nous sommes ici pour y substituer un ordre social plus juste. (Applaudissements sur quelques bancs à gauche. – Mouvements divers.)
Comme sanction à son intervention, M. Jaurès dépose l’ordre du jour suivant :
« La Chambre, convaincue que l’application résolue et méthodique de la politique socialiste est seule de nature à mettre fin aux scandales qui sont la conséquence naturelle et nécessaire du régime économique actuel, passe à l’ordre du jour. »
La priorité en faveur de cet ordre du jour, signé de MM. Jaurès et Millerand, est repoussée par 420 voix contre 87
dir= »ltr »>http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/panama_08021893.asp






![La jeunesse à l’action contre l’embrigadement vers la guerre mondiale [ #JRCF @JRCF_ ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/Capture20250413-jrcf-paix-120x86.jpg)