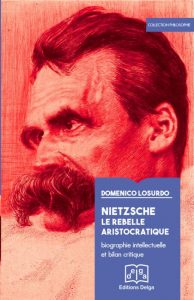 Le philosophe italien Domenico Losurdo vient de faire paraître aux éditions Delga une biographie de Nietzsche fournissant une solide analyse critique de l’oeuvre du philosophe.
Le philosophe italien Domenico Losurdo vient de faire paraître aux éditions Delga une biographie de Nietzsche fournissant une solide analyse critique de l’oeuvre du philosophe.
www.initiative-communiste.fr publie la recension de cet ouvrage par le philosphe Georges Gastaud écrite pour la revue Etincelles (Abonnez vous et demandez le dernier numéro !)
« Ce qui constitue le fil conducteur de l’évolution du philosophe, ce n’est pas la critique de la morale austère mais la lutte contre la révolution, dénoncée dès le début, mais peu à peu interrogée dans ses diverses manifestations et dans ses origines les plus éloignées ». Domenico Losurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique, p. 931.
par Georges Gastaud
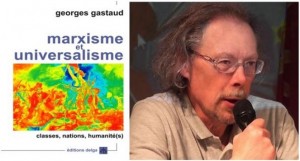 Remarquable travail du philosophe marxiste italien D. Losurdo : après cette étude critique et biographique, nul commentateur de Nietzsche – même Michel Onfray et la troupe oxymorique des « nietzschéens de gauche » – ne pourra plus continuer de bonne foi à présenter Nietzsche comme un sympathique esthète apolitique à l’avant-garde d’une « postmodernité » politiquement correcte… De manière hyper-documentée, en épousant chaque méandre de la trajectoire intellectuelle de Nietzsche et en resituant chacun d’eux dans le panorama politique du temps, Losurdo montre que les propos scandaleux, voire les franches indignités qui parsèment les écrits de Nietzsche (ses appels récurrents à rétablir l’esclavage, à exterminer les malades et les vieux, à écraser le prolétariat, à dominer les femmes, à mépriser le travail et les travailleurs, à liquider la démocratie, à coloniser les pays lointains, à refuser de s’apitoyer sur ceux qui souffrent, etc.) ne sont nullement des scories, et encore moins des « métaphores » à lire au 99ème degré. Oui, après la somme de Losurdo, il sera bien difficile de prendre des poses indignées quand on rappellera aux tenants de la doxa nietzschéolâtre que ce n’est pas par pur malentendu que Nietzsche était l’un des auteurs favoris du Führer – si infidèle que fût sur certains points la lecture hitlérienne de Nietzsche : son flamboyant extrémisme de droite ne prêche en effet ni pour le national-germanisme, ni pour l’antisémitisme racialiste, ni a fortiori pour le pseudo-« socialisme » hitlérien à venir…
Remarquable travail du philosophe marxiste italien D. Losurdo : après cette étude critique et biographique, nul commentateur de Nietzsche – même Michel Onfray et la troupe oxymorique des « nietzschéens de gauche » – ne pourra plus continuer de bonne foi à présenter Nietzsche comme un sympathique esthète apolitique à l’avant-garde d’une « postmodernité » politiquement correcte… De manière hyper-documentée, en épousant chaque méandre de la trajectoire intellectuelle de Nietzsche et en resituant chacun d’eux dans le panorama politique du temps, Losurdo montre que les propos scandaleux, voire les franches indignités qui parsèment les écrits de Nietzsche (ses appels récurrents à rétablir l’esclavage, à exterminer les malades et les vieux, à écraser le prolétariat, à dominer les femmes, à mépriser le travail et les travailleurs, à liquider la démocratie, à coloniser les pays lointains, à refuser de s’apitoyer sur ceux qui souffrent, etc.) ne sont nullement des scories, et encore moins des « métaphores » à lire au 99ème degré. Oui, après la somme de Losurdo, il sera bien difficile de prendre des poses indignées quand on rappellera aux tenants de la doxa nietzschéolâtre que ce n’est pas par pur malentendu que Nietzsche était l’un des auteurs favoris du Führer – si infidèle que fût sur certains points la lecture hitlérienne de Nietzsche : son flamboyant extrémisme de droite ne prêche en effet ni pour le national-germanisme, ni pour l’antisémitisme racialiste, ni a fortiori pour le pseudo-« socialisme » hitlérien à venir…
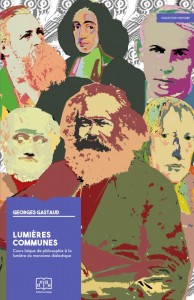
Car s’il existe une ligne noire dans la vie intellectuelle de ce penseur très fin mais démesurément agressif, c’est sa bouillonnante et insurpassable radicalité réactionnaire (on pense au mot de Lénine caractérisant le stade impérialiste du capitalisme comme « réaction sur toute la ligne »). Nietzsche a commencé sa trajectoire de penseur réactionnaire avec son livre très original sur L’Origine de la Tragédie. Il adhérait alors offensivement à la judéophobie de la coterie wagnérienne. C’est sur la droite que F.N. s’est ensuite détaché de R. Wagner et de son antisémitisme germano-
Certes, F. Nietzsche est passé ensuite par une phase plus « lumineuse » ; à l’époque où il publie Humain, trop humain, F.N. s’entiche de certains écrivains français (Voltaire, Chamfort, mais surtout pas Rousseau, ce Satan populacier qui enfanta Marat !) et il fréquente des intellectuels issus de la haute bourgeoisie juive qui l’aident à rompre avec le lourd antisémitisme « chrétien » du clan Wagner. Car encore une fois, Nietzsche prônait un nouveau bloc historique aristocratico-capitaliste qui, à l’échelle minimale du continent, eût intégré les nouvelles élites financières à l’ancienne aristocratie militaro-agraire (les « Junker » prussiens) sans s’encombrer d’affrontements nationaux subalternes, trop susceptibles de gaspiller le sang de l’élite européenne dans des guerres fratricides tout en promouvant dangereusement les plébéiens au rang de « citoyens-soldats » : et du point de vue de classe qui était le sien, F.N. était aussi lucide que le sera Lénine du point de vue de la classe opposée puisque, de son côté, le grand stratège bolchévik appellera le prolétariat à « changer la guerre impérialiste pour « la patrie » en guerre civile révolutionnaire ». Mais là encore, le ressort puissamment critique de Nietzsche était à l’ultra-droite. Les derniers textes de Nietzsche sont de plus en plus violents, pour ne pas dire franchement pré-génocidaires et exterministes (le mot « extermination » revient chez le dernier F N. comme un leitmotiv… wagnérien !) ; se rêvant en chef de parti, notre fulminant auteur méditait même un coup d’Etat contre le Second Reich, n’excluant pas de faire fusiller Guillaume II, trop social-chrétien, trop national-allemand, trop « serviteur de l’Etat », en un mot pas assez aristocrate et trop social-réformiste…
En effet, Nietzsche condamnait les concessions sociales faites par Bismarck à la classe ouvrière (retraites, protection sociale) dans le but de « couper l’herbe sous les pieds » du SPD alors révolutionnaire. Non pas esthète éthéré mais philosophe « Totus Politicus » (politique de part en part) mettant la morale, la science et l’art au service de son projet politique régénérateur, voire carrément eugéniste (là aussi les citations sont accablantes, récurrentes, et leur prise en compte non prévenue récuse d’avance toute interprétation « politiquement correcte » au énième degré…), Nietzsche rêvait d’imposer par la violence insurrectionnelle son ainsi-dit Parti de la Vie, ladite « vie » étant unilatéralement conçue comme une jungle impitoyable où triomphent de manière « dionysiaque » les spécimens surhumains affranchis de la trop « féminine » morale chrétienne : et Losurdo de pointer durement (mais pourquoi faudrait-il s’apitoyer sur un philosophe qui abhorrait la pitié ?) les déclarations de Nietzsche appelant à exploiter à fond les « faibles » ; du moins ceux que l’on n’aurait pas préalablement « castrés » (sic), voire « exterminés par millions » s’ils affichaient un trop grand déficit vital (on dirait de nos jours une trop faible productivité ?)… ou s’ils manifestaient une trop grande propension à la révolte…

A lire ce qui précède on pourrait penser que Losurdo reprend telle quelle la critique lukàcsienne du nietzschéisme (cf La destruction de la raison, Delga). Sur le fond, Losurdo converge bien avec le grand marxiste hongrois : il est impossible de ne pas rapprocher le « rebelle aristocratique » que fut Nietzsche de la dégénérescence socio-historique de la bourgeoisie moderne qui, après avoir accédé au pouvoir sur des bases progressistes (Lumières, droits de l’homme, etc.) et au prix d’une alliance antiféodale avec le petit peuple, en arriva rapidement quand elle fut au pouvoir à vouloir figer la situation sociale à son profit avec l’obsession de prévenir un éventuel 89 des prolétaires, quitte à se rapprocher pour cela de la réaction féodale domestiquée[1]. Si juste qu’elle soit sur son fond historico-social, la problématique de Lukàcs est cependant trop germano-centrée et Losurdo montre que le glissement ultraréactionnaire du bloc aristocratico-bourgeois – qui accompagne la montée de l’impérialisme, est en fait paneuropéen et étatsunien : les théoriciens de l’ultra-réaction se recrutent alors partout, du Français Gobineau à l’Etats-unien Emerson. L’historien décapant du libéralisme qu’est par ailleurs Losurdo montre d’ailleurs, citations accablantes à l’appui, l’extrême perméabilité des thématiques libérales (cf les horreurs esclavagistes qu’ont pu écrire Locke ou Tocqueville…) avec les thématiques esclavagistes. Mais enfin, pour des raisons historiques que Marx et Engels dessinent en pointillés dès L’Idéologie allemande (1846), c’est bien l’Allemagne qui sera le point de confluence de la radicalité réactionnaire paneuropéenne, tout entière cabrée contre 1793 et ses séquelles communardes ; car, dernière arrivée à l’unification nationale-bourgeoise et tard venue au partage colonial du monde déjà opéré par d’autres (Angleterre, Allemagne, Espagne, USA…) bien avant 1871, l’Allemagne bourgeoise s’est unifiée contre Napoléon et la Révolution française et pour cela, elle a dû faire bloc derrière ses monarques nationaux ralliés aux Hohenzollern si bien que sa construction en tant qu’Etat national-bourgeois unifié s’est effectuée au moment même du virage militaro-impérialiste du mode de production capitaliste… Si bien que la grande lignée progressiste allemande qui va, philosophiquement parlant, de Lessing à Marx en passant par Kant, Fichte, Hegel et Feuerbach (et celle qui va, « musicalement », de Bach à Beethoven en passant par Mozart) s’inverse quelque peu à la charnière des deux siècles avec ces génies ténébreux que furent tour à tour Schopenhauer, Nietzsche et Heidegger (Wagner en musique), la part progressiste de l’héritage allemand basculant très largement du côté du marxisme et du prolétariat social-démocrate.
On pourrait croire alors que la lecture sans complaisance de Losurdo « flanque à la poubelle » le nietzschéisme. Il n’en est rien, et pour deux raisons majeures :
- d’abord parce que l’étude losurdienne de la trajectoire théorique de Nietzsche est seule capable de respecter la cohérence forte de la pensée nietzschéenne en montrant que Nietzsche n’est pas un penseur décomposé livrant des « fragments » éclectique, tournicotants et a-doctrinaux, mais qu’il est un vrai philosophe qui, porté par un grand mouvement historique, pense le sens de l’histoire et de la vie en connectant de manière construite, ou plutôt, sans cesse reconstruite, une riche moisson de matériaux méthodologiques, scientifiques, esthétiques, éthiques et avant tout, politiques. La lecture historico-politique de Losurdo permet en effet de rendre compte de la cohérence de l’œuvre nietzschéenne en dégageant le point de vue (la radicalité réactionnaire) à partir duquel cette pensée ne cesse de s’approfondir et de se « cohérer », y compris à travers les ruptures tactiques que lui impose sa stratégie de confrontation radicale avec le progressisme, lui-même en constante évolution. En témoigne en particulier l’intérêt « dionysiaque » jamais démenti que Nietzsche portait aux Présocratiques[2]; comme on sait, cette fascination antihumaniste, post-rationaliste et néo-païenne pour la Grèce préclassique idéalisée ressurgira chez Heidegger pour s’affranchir de la rationalité métaphysique, judéo-chrétienne et technique – bien trop favorable à l’égalitarisme servile et plébéien dont a fini par émerger l’horrifique Révolution française et qui menace de se transformer en Commune universelle… En ce sens, la « déconstruction » losurdienne du nietzschéisme suivie de sa reconstruction pièce par pièce, est mille fois plus respectueuse du corpus nietzschéen que tant de lectures « aphoristiques » de Nietzsche qui font de cet auteur une sorte d’Arlequin théorique, une auberge bavaroise où chacun trouve ce qu’il veut… pourvu bien sûr que cela puisse le conduire à la terre promise du post-progressisme ! En l’occurrence, la méthode de Losurdo en impose bien au-delà du Cas F. Nietzsche. Dépassant l’opposition antidialectique entre « lecture externe » et « lecture interne » d’une œuvre, entre approche matérialiste « réductrice » et approche axiologique émerveillée, Losurdo va sans trêve du dehors au-dedans de l’œuvre (à ses conditions historiques générales de production) et du dedans au dehors du corpus nietzschéen sans jamais lâcher le fil conducteur de l’ultra-réaction qui, tel l’anneau de Mœbius, dessine la continuité d’une pensée théorique sans la couper de l’incontournable question matérialiste : quelles classe, quelle cause cette pensée sert-elle en dernière analyse ? Qui est-elle encore aujourd’hui en état de servir ?
Dans la foulée de cette analyse, D. Losurdo montre que, contrairement à une légende postmoderniste tenace, F.N. ne nous a nullement délivré des « grands récits » : il y a bien chez lui une grandiose réflexion sur le sens millénaire de l’histoire humaine même si sa vision du temps n’est pas linéaire, ni d’ailleurs purement circulaire – malgré la référence à l’éternel retour ; en effet, le « retour » nietzschéen au premier hellénisme, celui des origines de la Tragédie et de la Grèce présocratique, ne se conçoit pas comme un retour à la case-départ du trop rural localisme grec, encore moins comme une nostalgie de l’Allemagne des principautés, mais comme une « grande politique » menée à l’échelle continentale et mondiale. Etonnante « modernité » d’une telle régression, mais aussi – soit dit en passant – terrifiante régressivité de cette modernité foncièrement anti-progressiste et contre-révolutionnaire !
- ensuite parce que la critique historico-génétique du nietzschéisme mise en œuvre par Losurdo n’en révèle que davantage les subtils réquisits théoriques que la stratégie nietzschéenne, en raison même de sa radicalité – et notamment de sa critique fouillée de l’héritage socratico-judéo-chrétien – a fournis à la pensée critique… universelle. Pas seulement dans les domaines éthique et esthétique ni même dans la critique radicale des naïvement progressistes philosophies du sujet, etc., mais surtout dans l’étiologie de ce nihilisme que Nietzsche n’a cessé de pourfendre en révélant la parenté insoupçonnée qui unit le nihilisme ordinaire (notamment, le rejet des valeurs transcendantes par ces nihilistes russes qui, « ne respectaient rien ») au nihilisme ascético-religieux (ces « valeurs transcendantes » supérieures à l’être – donc foncièrement identiques au néant, au nihil = rien en latin – auxquelles les dominants invitent les dominés à sacrifier leur vie et leur santé) et plus secrètement encore, au nihilisme radical : à l’idée pessimiste que le néant vaut mieux que l’être. A ceci près que, comme le montre l’Appendice ci-dessous, ce nihilisme radical qui ne demande qu’à déboucher sur un exterminisme sanglant, n’est pas le fait des classes populaires structurellement attachées à la vie, au travail, à la paix et au devenir sensé, mais de l’aristocratie toute entière vouée à l’otium et au bellum (loisir et guerre). Rien d’étonnant si Nietzsche cite et révère le vieux poète grec (abhorré du matérialiste Epicure), Théognis de Mégare : pessimiste et aristocrate dans l’âme, Théognis préférait le néant à l’être (« le mieux est de ne pas naître ou, si l’on est né, de franchir au plus tôt les portes d’Hadès ») et n’en fulminait que davantage contre la trop plébéienne démocratie grecque émergente.
Conclusion provisoire :
Bien que menée avec une grande impartialité, la lecture losurdienne de Nietzsche comporte aussi des conclusions directement politiques : car trop souvent, les critiques bien-pensants du nietzschéisme commettent deux erreurs complémentaires. D’une part, ils confondent le fascisme avec le national-étatisme qui n’en est qu’un support transitoire, quand ce n’est pas un pur leurre idéologique (Politzer démontrait déjà que les nazis ou les fascistes français méprisaient leur pays respectif) ; et sur la base de cette première erreur, ces lecteurs complaisants de F.N. en déduisent logiquement une seconde erreur : ayant rompu avec le national-étatisme prussien, Nietzsche ne pourrait DONC être classé parmi les précurseurs du fascisme. Mais outre que le légitime attachement de chaque peuple à sa propre existence (qui est proprement le patriotisme) n’a en soi rien de fasciste (sans lui, ni souveraineté populaire, ni lutte anti-impérialiste, ni même existence plurielle des peuples), outre que le fascisme historique a passé son temps à broyer les nations au nom de la « race », de la « communauté », de la religion ou déjà, de l’ « Europe unie », il est très possible que l’appel à la violence sans limite des dominants contre les travailleurs, les femmes, les peuples colonisés et les formes démocratiques, prenne déjà de tout autres formes que celle d’un renforcement des Etats-nations : et c’est ce que montre aujourd’hui ce « libertarisme » bourgeois dont on ignore s’il veut transformer en société la jungle ou s’il veut faire jungle la société. Et c’est surtout ce que montre le nietzschéisme en tant qu’il en appelle à une forme radicalisée de violence des « élites » – une violence d’essence post-nationale et transcontinentale – contre les classes et les peuples subalternes revendiquant leur droit imprescriptible au bonheur commun.
En ce sens, on peut aisément prévoir deux choses : d’une part, que la décapante lecture losurdienne sapera l’attachement naïf des étudiants progressistes à l’esprit revanchard, voire exterministe, du nietzschéisme… Et symétriquement, que la mise en lumière des vues complémentairement pré-libertariennes et « euro-atlantiques » avant la lettre de Nietzsche devrait logiquement rendre ce penseur encore plus cher aux tenants du futur Empire « post-national », euro-atlantique et mondialement contre-révolutionnaire. Et ce vertige nietzschéen des classes dominantes agira d’autant plus fortement que la « construction » euro-atlantique abandonnera ses oripeaux sociaux-démocrates et « sociaux-chrétiens » d’origine pour afficher sa brutale nature de classe : celle d’un bloc otanien et prédateur tourné vers la guerre contre la Russie, la Chine, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe du sud (France incluse ?), celle d’une guerre civile impitoyable contre le mouvement ouvrier, celle d’un démontage rapide des Etats-nations européens hérités de la Révolution française, celle d’une éradication négationniste du legs de Stalingrad, Valmy et Marathon ; celle, en un mot, d’une nouvelle domination fasciste violente, éhontée, mondialisée, « surhumaine », exterministe s’il le faut, de l’oligarchie capitaliste, inhumaine, trop inhumaine… « Blancs » d’Europe et du monde entier, unissez-vous contre les Rouges et les « Bleus » (néo-jacobins et autres patriotes anti-impérialistes) de chaque pays ! Le programme géopolitique de la contre-révolution nietzschéenne pourrait ainsi s’interpréter comme le symétrique objectif de celui que dessinèrent, d’une part, le Contrat social, et de l’autre le Manifeste du parti communiste et L’impérialisme, stade suprême du capitalisme…
*En résumé, comme l’établit Losurdo, la ligne nietzschéenne ne consiste pas à faire nation avec les ouvriers et autres gens de rien, mais à faire caste à l’échelle continentale (Europe), voire transcontinentale (Europe + USA : on ne peut s’empêcher de penser à l’Union transatlantique que le MEDEF veut substituer à l’Etat-nation français) contre l’ensemble des dominés : « nationaux » et bien entendu, Asiatiques, Africains, etc.. Car le nationalisme fait la part trop belle aux dominés et le prix de l’illusion qu’il leur propose (l’union nationale) est trop élevé car il débouche sur un militarisme de masse qui apprend aux ouvriers à manier des armes et qui les prépare involontairement à la révolution prolétarienne (on l’a vu avec la Commune, puis en 1917 !).
On comprend parallèlement pourquoi F.N. abandonnera assez vite la judéophobie racialiste sans jamais rompre totalement avec une forme nuancée d’antijudaïsme culturel. Surtout, F.N. pourfendra sans relâche cette quintessence de judaïsme plébéien qu’est à ses yeux l’esprit évangélique. Si la haine du juif peut être un puissant dérivatif permettant de détourner les masses de l’anticapitalisme tout en cimentant la « nation social-chrétienne » dans un antisémitisme partagé, elle perd son intérêt tactique quand la classe dominante se fixe pour tâche de créer un Empire euro-mondialisé intégrant classe contre classe l’ensemble des dominants contre l’ensemble des dominés, mais aussi contre les (néo-)colonisés, contre les femmes (d’abord celles du Sud !) et contre les prolétaires européens.
Comme on le voit, F.N. est très « moderne » et, s’il est injuste de le rabattre sur le fascisme pseudo-national et pseudo-« socialiste » des années trente, ce n’est nullement parce que F.N. était « plus gentil » que ses futurs et enthousiastes lecteurs nazis. C’est surtout parce que sa vision stratégique supranationale, euro-atlantique et long-termiste avait beaucoup d’avance sur les formes encore localistes de la fascisation impérialiste… Que Losurdo soit remercié de nous confronter à ces terribles évidences si longtemps occultées ! Die Faschisierung ist wieder vor der Tür !




![Sur les marchés, la jeunesse communiste informe et mobilise pour la paix et le social, en vendant la presse communiste [ @JRCF_ ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250330-marches-journaux-350x250.jpeg)
![Fuir le progrès ? Climat, biodiversité, genre, IA, transhumanisme… [Café Marxiste – 12/04 14H30 – Paris ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20240412-Cafe-marxiste_Suing-120x86.jpg)
![4 avril, Marseille débat pour la sortie de l’OTAN et se libérer des cages de l’impérialisme [ PRCF – FUIQP – Supernova]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250404-sortiedelotan-marseille-120x86.jpg)
